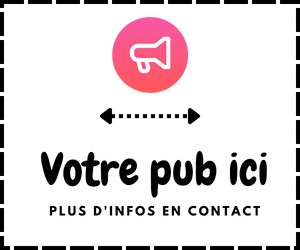CRITIQUE, opéra. ZÜRICH, Opernhaus, le 13 déc 2022. CAVALLI : Eliogabalo. La Scintilla, Dmitry Sinkovsky – On attendait beaucoup de cette nouvelle production du chef-d’œuvre de Cavalli. Hélas, une mise en scène ratée, une direction et des voix poussives, une méconnaissance totale du style vénitien, ont anéanti nos espoirs.
Jamais donné du vivant du compositeur, cette sublime partition, hommage à son maître Monteverdi, a connu une résurrection tardive à Crema, sa ville natale en 1999, puis par René Jacobs à Bruxelles et Innsbruck en 2004, avant qu’elle ne pénètre dans le temple du Palais Garnier en 2016 défendu par Leonardo García Alarcón et Thomas Jolly / LIRE notre critique d’ELiogabalo au Palais Garnier ici. La production zurichoise tranche par sa laideur et l’absence totale de nuances, nécessaire à mettre en scène ce « dolce misto d’allegro e tristo » (La Calisto), qui fait tout le prix (et la difficulté) d’un genre à l’équilibre fragile. Dans la lecture de Calixto Bieito, tout est tiré vers la vulgarité, tandis que l’hystérisation permanente des voix obère la plus élémentaire compréhension du texte. Le décor présente un plateau coulissant constitué de barres de fer et de rideaux en plastique ; un canapé blanc, sur lequel se déchaînent les personnages féminins, une moto suspendue et un taureau, symbole de l’empereur-Jupiter, cible d’un Giuliano forcené. Un bric-à-brac peu cohérent, loin des voluptés et du faste d’un César mégalomane, si bien rendus par la vision à la fois spectaculaire et raffinée de Thomas Joly.
Hystérisation, vulgarité… déception à Zürich
Cavalli, à corps et à cri
Exit la scène capitale du vol de hiboux à la fin du second acte, un air de Nerbulone à l’acte I (« Gran maghe d’amor ») a été escamoté et au début du 3e acte, le chef, qui est aussi contre-ténor, se tourne vers le public et chante (plutôt bien) un lamento tiré d’Artemisia (« Dammi morte, o libertà ») qui n’a rien à voir avec l’intrigue.
La distribution était pourtant prometteuse. Dans le rôle-titre, le contre-ténor ukrainien Yuriy Mynenko a la tessiture et la présence scénique adéquates. Un souffle certain, une élocution sans faille, mais comme presque tous ses congénères et moins pire qu’eux, il stridule plus qu’il ne chante et ses airs envoûtants ne laissent que rarement transpirer l’émotion.
Dans le rôle du frère vertueux Alessandro, David Hansen frise la caricature : la mise en avant d’un physique avantageux ne fait pas oublier un chant proche du cri hystérique, à l’élocution inaudible dans le registre aigu ; lui aussi en fait des tonnes, sans se soucier le moins du monde du sens de ce qu’il chante. Son magnifique lamento (« Misero, così va ») qui devait faire pleurer les pierres est chanté sans empathie. Les deux rivales, Anicia Eritea et Flavia Gemmira, respectivement chantées par Siobhan Stagg et Anna El-Khashem, rivalisent elles aussi dans l’hystérisation vocale, guère aidées par une voix plutôt verte et acide, manquant de mordant (l’air sublime « Non fia amor che mai disciolga » manque cruellement de pathos), qualité qu’on retrouve en revanche chez Sophie Junker dans le beau rôle d’Atilia Macrina, l’amante éplorée, qui sort vraiment du lot : une diction remarquable, un timbre chaleureux et enfin un personnage investi dans son rôle à qui échoient les plus beaux lamenti de la partition (« Amami vago mio »). Le Giuliano de Beth Taylorpouvait séduire sur le papier : un timbre viril et puissant, gâché par un histrionisme pathétique et une constante agitation débridée qui en fait un personnage ridicule à rebours de toute logique dramaturgique. Mark Milhofer est, comme toujours impeccable, dans la diction comme dans le style musical, mais campe une Lenia un peu trop sage, trop élégante et raffinée. Dans le rôle du favori Zotico, Joel Williams possède un timbre chaleureux, une belle projection et sauve les meubles par une présence scénique conforme au personnage. Quant au Nerbulone de Daniel Giulianini, son très bel organe de baryton-basse est à son tour perverti par un jeu excessif et des coups de glotte de dindon glapissant qui sont autant de tortures pour les oreilles. Le Tiferne de Benjamin Molonfalean et les deux consuls d’Aksel Daveyan et Saveliy Andreev complètent sans relief la distribution.
Dans la fosse, Dimitri Sinkosky mène la phalange pourtant experte de La Scintilla tambour battant, mais sans se préoccuper vraiment de ce qui se passe sur scène ; il méconnait manifestement le style de l’opéra vénitien, abuse des vents et des castagnettes, brode excessivement dans une partition pourtant impeccablement claire ; l’ouverture magnifique (qui contient la première mention d’un rythme de tarentelle à l’opéra) est bavarde, excessivement prolixe, préludant la suite d’une direction outrancière qui a oublié que le théâtre à Venise est tout aussi sur scène que dans la fosse.
___________________________________________
CRITIQUE, opéra. ZÜRICH, Opernhaus, le 13 déc 2022. CAVALLI : Eliogabalo. Yuriy Mynenko (Eliogabalo), Siobhan Stagg (Anicia Eritea), Beth Taylor (Giuliano Gordio), Anna El-Khashem (Flavia Gemmira), David Hansen (Alessandro Cesare), Sophie Junker (Atilia Macrina), Joel Williams (Zotico), Mark Milhofer (Lenia), Daniel Giulianini (Nerbulone), Benjamin Molonfalean (Tiferne), Aksel Daveyan (Un console), Saveliy Andreev (Altro console), Calixto Bieito (mise en scène), Anna-Sofia Kirsch, Calixto Bieito (décors), Ingo Krügler (costumes), Franck Evin (lumières), Adrià Bieito Camì (vidéo), Beate Breidenbach (dramaturgie), Dmitry Sinkovsky (direction). Photos : Monika Riiterhaus / Zürich Opernhaus
PLUS D’INFOS sur le site de l’Opéra de Zürich / Opernhaus Zürich : https://www.opernhaus.ch/en/spielplan/calendar/eliogabalo/