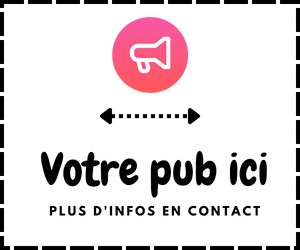En 1879, la ville de Genève inaugure son Opéra. Quel ouvrage pouvait être davantage approprié pour ce premier lever de rideau que le testament lyrique de Rossini, symbole cher au cœur du pays helvète ? Nous voulons bien entendu parler de Guillaume Tell. En outre, voilà près d’un quart de siècle que ce Grand-Opéra n’avait plus été représenté à Genève, c’est dire ce retour était attendu avec impatience.
Ce Guillaume Tell aura-t-il été une réussite ? Incontestablement oui. Aura-t-il comblé toutes attentes et nos espoirs ? Seulement en (grande) partie. Une bonne raison de faire la moue : les coupures. L’œuvre intégrale, en conservant tous les ballets, est longue, on le sait, près de 5 heures de musique.
Fallait-il pour autant retirer plus d’une heure à cette partition foisonnante ? La construction dramatique s’en ressent douloureusement, notamment dans le dernier acte, au dénouement confus. Néanmoins, la qualité musicale demeure pleinement au rendez-vous, défi d’autant plus brillamment relevé que le théâtre genevois s’est offert le luxe d’une double distribution pour certains des rôles principaux. A la tête d’un Orchestre de la Suisse Romande en plein forme, aux cordes soyeuses et aux cuivres brillants, Jesús López-Cobos dirige l’ensemble du plateau avec un amour évident pour cette musique, toujours élégant dans le geste et le phrasé mais jamais à court de dramatisme.
L’Helvétie retrouve son héros
Dans le rôle-titre, on salue la performance de Jean-François Lapointe, qui incarne pour la première fois le héros suisse. Un Tell tel qu’on peut se l’imaginer, tendrement paternel mais grondant d’une sourde colère qui ne s’apaisera qu’une fois son pays libéré. L’incarnation vocale se révèle sans reproche, aux graves certes pudiques mais à l’aigu vainqueur et au legato de haute école, notamment dans son air « Sois immobile », teinté d’une belle émotion. L’émission sonne enfin plus haute et plus claire que par le passé, ce que nous vaut un texte magnifiquement dit, surtout lors de la seconde soirée, le souci de la seule ligne vocale nous privant parfois de consonnes durant la première.
Face à lui se dressent deux Arnold affrontant crânement les pièges tendus par leur partie. Désormais familier de ce rôle réputé inchantable, John Osborn apparaît à l’aise dans cette écriture impossible, seul le bas de la tessiture manquant parfois de largeur. La diction, remarquable de précision, n’apparaît jamais sacrifiée au profit du seul aigu ; et pourtant, les notes hautes se projettent avec facilité, permettant jusqu’à des nuances osées : ainsi un crescendo périlleux mais réussi sur l’ut cadentiel refermant « Asile héréditaire ». La cabalette qui suit, arrogante et éclatante, achève de dresser un portrait en tous points convaincant du personnage.
Le lendemain, c’est au tour d’Enea Scala, qui chantait la veille les lignes du Pêcheur, de porter les habits d’Arnold. Et force est de constater que, s’il n’a pas encore la fière assurance de son aîné, le jeune ténor italien se révèle parfaitement à la hauteur des enjeux tant dramatiques que vocaux. Si la prosodie française mériterait d’être affinée, on salue une belle maîtrise de cette tessiture meurtrière, jusqu’à un registre aigu jamais forcé – émis étrangement toutefois, comme une voix mixte serrée pour lui donner de l’impact – et une palette de couleurs qui augurent du meilleur pour l’avenir.
La belle Mathilde se voit partagée entre deux profils vocaux très dissemblables, mais ces deux portraits se rejoignent dans notre déception… que la grande scène, ouvrant le troisième acte, qui incombe à la jeune héritière des Habsbourg, ait été purement et simplement coupée, alors que les deux interprètes auraient pu y faire merveille.
Le premier soir, on tombe en quelques phrases sous le charme de la biélorusse Nadine Koutcher, dotée d’un magnifique instrument de soprano lyrique aigu : somptuosité d’un timbre opalin, maîtrise technique totale, pianissimi suspendus, son « Sombre forêt » demeure l’un des grands moments de la soirée. On enrage vraiment face cette coupure aussi inexplicable que regrettable, qui réduit ainsi le rôle à sa portion congrue, d’autant plus que la chanteuse manque un peu d’autorité pour exister pleinement lors de son affrontement avec Gessler, quelques scènes plus tard – et ce malgré quelques aigus insolents qui traversent le chœur achevant l’acte –.
Avec l’espagnole Saioa Hernandez, qui incarne la princesse le lendemain, le rôle retrouve la vocalité de soprano dramatique qui était d’usage jusqu’à une époque encore récente. De larges moyens certes, mais pliés à la discipline belcantiste. On est ainsi heureux de réentendre cette artiste qui nous avait fait grande impression lors du Concours Bellini de Puteaux voilà cinq ans. La voix n’a rien perdu de son velours corsé ni de sa terrible puissance, sachant pourtant se parer de nuances quand il le faut. Ce qui nous vaut un magnifique « Sombre forêt », d’une souplesse étonnante et serti d’une très belle diction. Le duo avec Arnold la trouve au contraire moins à l’aise dans cette écriture rapide et le texte s’en ressent fortement, soudain difficilement compréhensible, toute entière concentrée qu’elle est à assurer sa ligne de chant.
En revanche, l’interprète explose littéralement à la fin du troisième acte, déployant toute l’ampleur de ses immenses moyens, allant jusqu’à paraître menaçante et dangereuse pour Gessler lui-même ! Son magnétisme scénique faisant le reste, elle concentre sur elle tous les regards et occupe le plateau avec une intensité rare. Ce n’est plus Mathilde, c’est Norma !
Aux côtés de ce trio – ou quintette –, les seconds rôles sont globalement très bien tenus. Doris Lamprecht trouve enfin un rôle à sa mesure, le premier depuis bien longtemps. Fière, généreuse, vocalement percutante, son Hedwige prouve qu’elle est encore une artiste de premier plan, et qu’elle mérite bien mieux que les rôles comiques dans lesquels on la cantonne trop souvent.
Son fils, le courageux Jemmy, trouve en Amelia Scicolone une interprète de choix, plein de fraicheur et d’énergie, d’une crédibilité sans faille.
Parfaitement détestable, le Gessler de Franco Pomponi, davantage baryton que basse, ne quittant jamais son fauteuil roulant, sadique autant qu’haineux.
D’abord Melchthal, puis Watler Furst, Alexander Milev remplit son office, mais d’une voix souvent rocailleuse et fruste, et au français perfectible.
Protagoniste essentiel et véritable cœur de la partition, le chœur maison offre une prestation remarquable d’homogénéité, de style et de souci du texte.
On se souviendra longtemps de cette fin du troisième acte où le flot sonore véritable torrent vocal autant qu’orchestral, emporte tout sur son passage, sur ces simples mots vengeurs : « Anathème à Gessler ! ».
Saluons également les danseurs qui, grâce aux chorégraphies à la fois drôles et violentes d’Amir Hosseinpour, réussissent à traduire les états d’âmes d’un peuple oppressé et ivre de liberté.
Tous évoluent avec justesse dans la mise en scène à la fois dépouillée et très évocatrice de David Poutney, faite de glace et de métal, au sein de laquelle les couleurs de la fraternité du peuple suisse habille peu à peu la triste grisaille de son existence. Car le message principal de cette scénographie se voit tout entier résumé dans la célèbre scène de la pomme : point d’effet spectaculaire pour représenter l’exploit de Tell, mais simplement une flèche qui passe de main en main, le temps paraissant suspendu, comme si cette victoire n’était pas simplement celle de l’archer, mais également celle de l’Helvétie toute entière.
Et nous voulions garder pour la fin le soliste central de cette production : Stephen Rieckoff, violoncelle solo au sein de l’OSR. C’est sur lui que le rideau s’ouvre, pour son superbe solo ; c’est son instrument qui représente le destin de la Suisse, d’abord volé par les Autrichiens puis disloqué et suspendu depuis les cintres. C’est encore lui, depuis le fond de la scène, qui accompagne Guillaume Tell durant son air, comme un duo à l’émotion poignante. Et c’est lui, véritable double du héros, qui le rejoint une fois le pays délivré.
Deux très belles soirées, qui confirment la place que tient cet ouvrage dans le paysage lyrique actuel et la nécessité de le monter dans son entièreté.
Genève. Grand Théâtre, 11 et 13 septembre 2015. Gioachino Rossini : Guillaume Tell. Livret d’Etienne de Jouy et Hyppolyte-Louis-Florent Bis, d’après la pièce du même nom de Friedrich von Schiller. Avec Guillaume Tell : Jean-François Lapointe ; Arnold : John Osborn / Enea Scala ; Mathilde : Nadine Koutcher / Saioa Hernandez ; Hedwige : Doris Lamprecht ; Jemmy : Amelia Scicolone ; Gessler : Franco Pomponi ; Walter Furst / Melchthal : Alexander Milev ; Rodolphe : Erlend Tvinnereim / Jérémie Schütz ; Ruodi : Enea Scala / Erlend Tvinnereim ; Leuthold : Michel de Souza ; Un chasseur : Peter Baekeun Cho. Chœur du Grand Théâtre de Genève ; Chef de chœur : Alan Woodbridge. Orchestre de la Suisse Romande. Jesús López-Cobos, direction musicale. Mise en scène et décors : David Poutney ; Assistant à la mise en scène : Robin Tebbutt ; Décors : Raimund Bauer ; Costumes : Marie-Jeanne Lecca ; Lumières : Fabrice Kebour ; Chorégraphie : Amir Hosseinpour.