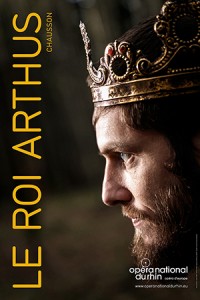 De mémoire de lyricophile, on aura rarement été aussi mal à l’aise au moment de l’évocation d’une soirée, tant l’attente était grande et tant les éléments ont paru in fine se liguer contre la réussite de ce qui promettait d’être un des grands évènements de la saison en cours. Le retour en France du rare Roi Arthus d’Ernest Chausson, belle initiative de l’Opéra National du Rhin – avant l’entrée de l’ouvrage à l’Opéra de Paris l’an prochain –, était le moyen de jeter une oreille nouvelle sur la voie tracée par l’opéra français du début du vingtième siècle, après Massenet et avant Debussy.
De mémoire de lyricophile, on aura rarement été aussi mal à l’aise au moment de l’évocation d’une soirée, tant l’attente était grande et tant les éléments ont paru in fine se liguer contre la réussite de ce qui promettait d’être un des grands évènements de la saison en cours. Le retour en France du rare Roi Arthus d’Ernest Chausson, belle initiative de l’Opéra National du Rhin – avant l’entrée de l’ouvrage à l’Opéra de Paris l’an prochain –, était le moyen de jeter une oreille nouvelle sur la voie tracée par l’opéra français du début du vingtième siècle, après Massenet et avant Debussy.
Ecrit entre 1886 et 1895, mais créé seulement le 30 novembre 1903 à la Monnaie de Bruxelles, plusieurs années après la mort du compositeur en 1899, l’unique ouvrage scénique de Chausson trouve sa source dans le choc que représenta pour lui la découverte de la musique de Wagner. Neuf ans de gestation pour une fresque centrée autour des trois personnages principaux : Arthus bien entendu, sa femme Genièvre et le chevalier Lancelot, amant de la reine. Dans ce triangle amoureux, impossible de ne pas voir un reflet du Tristan wagnérien, tandis que le bon Lyonnel protège les amours adultères comme le fait Brangäne chez Wagner. En outre, au-delà d’évocations appuyées au maître de Bayreuth – comment ne pas sourire lors des premiers accords, hommage plus qu’explicite à la Chevauchée des Walkyries ? –, Chausson apporte aux leitmotivs et à la vocalité large, typiques de l’écriture musicale de cette époque en mutation, son sens des couleurs très français, fondant les harmonies et cultivant une pâte sonore héroïque et onirique tout à la fois.
Un coup de la fée Morgane ?
Il est ainsi d’autant plus regrettable de devoir déplorer que tant de promesses n’aient pu être tenues à Strasbourg ce soir-là. Peut-être un (mauvais) coup de la fée Morgane, absente de l’ouvrage.
Considérant le cadre moyenâgeux originel impossible à représenter sérieusement depuis les Monty Python, et désireux d’ancrer sa mise en scène dans un cadre temporel précis – plutôt, dit-il, que de choisir un cadre symboliste hors du temps –, Keith Warner décide de célébrer le centenaire de la Première Guerre Mondiale et de prendre ce cadre guerrier comme toile de fond et moteur de l’action. Las, force est de constater que cette scénographie ne fonctionne pas et que les lourds décors très réalistes – une salle de commandement, un entrepôt d’obus et un hôpital militaire – ridiculisent l’intrigue davantage qu’ils la servent.
Plus encore, la sensualité demeure désespérément absente des duos unissant Lancelot et sa Genièvre, alors que la musique déborde de la passion des cœurs et des corps emmêlés. Seul le pommier renversé descendant des dessus et annonçant l’apparition de l’enchanteur Merlin possède cette part de poésie qui semble avoir abandonné la scène.
Le suicide de la reine, tristement illustratif, laisse l’œil sec, le traitement scénique de cette scène ne flattant ni la chanteuse ni l’esprit de ce moment censément poignant. Et la conclusion de l’ouvrage ne convainc pas davantage, malgré un retour à une certaine imagerie arthurienne – le souverain revêt son armure argentée pour son élévation finale –, mais la statue érigée en son honneur et les pétales de roses tombant des cintres achèvent la soirée dans une sucrerie si soudaine qu’elle en devient déplaisante.
Cette scénographie semble ne pas inspirer davantage les chanteurs, tous s’acquittant de leur tâche avec professionnalisme mais sans flamme.
Seconde malchance de la représentation, la Genièvre d’Elisabete Matos. Habituée des rôles wagnériens et verdiens les plus redoutables, la soprano portugaise semble, malgré sa voix encore puissante, avoir fait les frais de ces emplois risqués, l’instrument ne sonnant plus que métallique, toute nuance devenant périlleuse et un vibrato creusé envahissant l’ensemble de la tessiture.
Dans les quelques moments de vaillance dévolus au rôle, on entend l’Abigaille qu’elle a dû être, mais en dépit d’un français digne d’éloge, la vocalité de la chanteuse demeure étrangère au style propre à cette partition, sans parler de costumes peu seyants et d’une présence scénique manquant terriblement de la féminité et la volupté requises. Chaque mouvement semble précautionneux, et on ne parvient jamais à croire à la passion de cette reine amoureuse.
Son Lancelot paraît pousser Andrew Richards dans ses retranchements, l’écriture du chevalier demandant une solidité et une endurance outrepassant les moyens du ténor américain. Le chanteur livre néanmoins une prestation honnête, payant comptant et osant nuancer, mais trop souvent en force pour enthousiasmer vraiment.
Remplaçant Franck Ferrari initialement prévu, le baryton Andrew Richards retrouve avec Arthus un rôle qu’il connaît bien pour l’avoir déjà chanté et enregistré. Néanmoins, on reste surpris dès ses premières notes par un médium et un grave sans couleur, tandis que l’aigu, facile et solaire, accuse une position vocale typique d’un ténor. Au fil de la représentation, l’instrument paraît prendre du corps et du soutien malgré un manque de projection et un léger engorgement, gagnant en rondeur, le musicien incarnant avec conviction ce roi par trop incrédule et offrant une belle scène finale.
Excellent Merlin de Nicolas Cavallier, son timbre profond de basse offrant une majesté bienvenue à ce rôle pourtant écrit pour baryton.
Les seconds rôles demeurent bien tenus, du Mordred percutant de Bernard Imbert au Lyonnel efficace et sonore de Christophe Mortagne, toujours excellent dans ce type d’emplois. On saluera également le Laboureur poétique et au chant bien conduit de Jérémy Duffau.
D’ordinaire irréprochables, les Chœurs de l’ONR apparaissent ce soir-là parfois mal à l’aise dans la mise en place de leurs interventions, hésitation due peut-être à un temps de répétitions insuffisant.
Quant à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, c’est du côté de la magie que le bât blesse. Non que la prestation des musiciens mulhousiens soit indigne, loin de là. Au contraire, leur professionnalisme dans l’exécution de leurs parties, redoutablement difficiles, est à saluer. Mais l’effort que leur a demandé la préparation de cette partition riche et complexe se sent trop en ce soir de première pour que les sortilèges contenus dans la musique puissent opérer pleinement. Cet orchestre démontre des progrès constants, mais fallait-il pour autant leur confier d’ors et déjà un ouvrage d’un tel niveau, non moins ardu que les compositions de Wagner ? A leur tête, Jacques Lacombe prêche sa foi en cette musique et apporte à cette entreprise tout son savoir-faire dans le répertoire français, paraissant porter l’orchestre à bout de baguette.
C’est donc des applaudissements très timides qui ont accueilli cette redécouverte au rideau final, un comble pour la maison alsacienne qui a tant de réussites à son actif. Espérons que les représentations suivantes permettront, l’assurance et la confiance aidant, pour les instrumentistes comme pour le public, davantage de plaisir.
Une soirée dont nous sommes sortis sincèrement attristés, mais qui aura néanmoins laissé pressentir la nécessité de redécouvrir ce Roi Arthus.
Strasbourg. Opéra National du Rhin, 14 mars 2014. Ernest Chausson : Le Roi Arthus. Livret du compositeur. Avec Genièvre : Elisabete Matos ; Arthus : Andrew Schroeder ; Lancelot : Andrew Richards ; Mordred : Bernard Imbert ; Lyonnel : Christophe Mortagne ; Merlin : Nicolas Cavallier ; Allan : Arnaud Richard ; Le laboureur : Jérémy Duffau. Chœurs de l’ONR ; Sandrine Abello, chef de chœur. Orchestre Symphonique de Mulhouse. Jacques Lacombe, direction musicale. Mise en scène : Keith Warner ; Décors et costumes : David Fielding ; Eclairages : John Bishop




