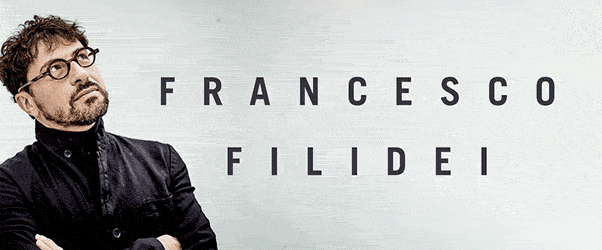L’art de l’apothéose semblait réservé à la peinture. Du Grand Duc de Florence par Vasari à Louis XIV par Charles Le Brun, les souverains montant aux cieux ont recouvert nombre de palais. Transposer ce thème en musique, tel est l’exercice auquel s’est voulu adonner François Couperin. Son amour pour les « goûts réunis », la réconciliation du style français et italien qui s’opposent alors avec virulence, le poussent en à célébrer à la fois Jean Baptiste Lully et Arcangelo Corelli.
Ces deux apothéoses, composées en 1724 (plus de dix ans après la mort de Corelli et trente ans après celle de Lully) se répondent et même se complètent admirablement. A chaque fois, le compositeur prie les muses ou Apollon de l’emmener au Parnasse, s’enthousiasme et célèbre les dieux en jouant de la musique. L’impression de narrativité des œuvres est renforcée dans ce disque par les interventions de François Morel qui récite les titres de chacun des mouvements et permet d’en suivre la logique. Pourtant, la musique elle-même est très peu descriptive : il ne s’agit ni plus ni moins que Grandes Sonades en Trio (la francisation du mot « sonate » est importante !).
Les goûts réunis
Le Parnasse ou l’Apothéose de Corelli, tente déjà une fusion entre les styles français et italien, par ce ton frais et léger mais aussi des formes plus savantes, telles que la fugue à trois voix finale.
La synthèse sera encore plus aboutie dans le pompeusement nommé Concert Instrumental sous le Titre d’Apothéose composé à la mémoire immortelle de l’incomparable Monsieur de Lulli (lui-même d’origine italienne, faut-il le rappeler). L’ancien Sur-intendant de la Musique du Roy est accueilli au Parnasse par Corelli (la vraisemblance chronologique n’a que peu d’importance) et tous deux sont priés par Apollon de jouer ensemble car « la réünion des Goûts François et Italien doit faire la perfection de la Musique ». Couperin alterne alors des mouvements ou Lully jouerait le sujet et Corelli l’accompagnerait, et inversement. Les deux lignes de violon, l’une dans le style français et l’autre dans le style italien, se superposent alors avec une virtuosité contrapuntique incroyable.
La dernière section de cette apothéose est une nouvelle sonade en trio, à quatre mouvements, synthèse finale des deux styles, titrée non sans malice : « La Paix du Parnasse, faite aux Conditions – sur la Remontrance des Muses françoises – que lorsqu’on y parleroit leur langue, on diroit dorénavant Sonade, Cantade, ainsi qu’on prononce Ballade ou Sérénade ». Au grand malheur de Couperin, cette exhortation n’aura été suivie par aucun de ses héritiers…
Entre les deux apothéoses se glisse le Tombeau de Lully écrit en 1695 par son élève Jean-Féry Rebel. La tradition des tombeaux musicaux est également ancienne, mais ne constitue pas une musique funèbre puisqu’elle peut être composée du vivant de la personne honorée. Cet hommage à Lully, grave et lent, est ainsi entrecoupé de mouvements plus brillants et gais. Certaines pages rappelleront des tragédies lyriques comme Armide, mais aussi avec des inspirations plus italiennes.
Le Ricercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot à la basse de viole, livre une interprétation qui semble longuement mûrie, davantage attachée à la musique pure qu’à une recherche de théâtralité par des effets artificiels. Chaque page des partitions, et tous les styles qu’elles mêlent, sont exécutées avec goût et avec application.
Apothéoses. François Couperin: Apothéose de Corelli, Apothéose de Lulli ; Rebel, Tombeau de Monsieur de Lully. Ricercar Consort, dir. Philippe Pierlot. Mirare. ref MIR150. Parution le 3 avril 2012. Compte rendu rédigé par Raphaël Dor.