Héritier d’une lignée prestigieuse de musiciens au service du Roi, Joseph Chanceau de La Barre, né parisien en 1633, est organiste de la Chapelle du roi (1656). Ses « concerts spirituels » sont particulièrement réputés, car s’y produit aussi sa sœur Anne, chanteuse très réputée (qui d’ailleurs est la première femme musicienne obtenant un brevet à la Musique de la Chambre du Roi en 1661).
Les deux De La Barre se dédient en particulier pour les airs à la mode, ceux amoureux, bénéficiant entre autres, des textes de Mademoiselle de Scudéry, entre autres, qui tient elle aussi l’un des salons parisiens les plus convoités du moment. « Le tendre et le plaintif » sont les deux sujets de cette nouvelle lyre sentimentale qui évoque le labyrinthe des sentiments. La courtoisie et la galanterie inspirent nombre d’airs « sérieux », eux même hérités de l’air de cour, mais à présent non plus polyphonique mais monodique : autant de morceaux collectés dans le « recueil des vers mis en chant », publié entre 1661 et 1680 par Bertrand de Bacilly. Au moins 9 airs de Joseph y paraissent dans un subtil mélange entre tradition française et teintes italiennes (dont témoigne l’air en italien, ici intégré « Sospiri, Ohimé » pour soprano) ; dont « il faut aimer une bergère » (ce dernier à 2 parties) ; De La Barre invente et développe pour le second couplet (dit « double »), l’art de la diminution selon les possibilités du chanteurs, roulades, coulades, ports de voix et autres cadences… telle ornementation devait demeurer élégante et naturelle, soit de bon goût selon l’agilité du vocaliste (dont les plus réputés furent alors Michel Lambert ou le Bacilly précité).
Se distinguent entre autres des éléments de danse qui enrichissent l’allant et l’énergie rythmique des airs (chaconne pour « Si c’est un bien que l’espérance » / passacaille dans « Quand une âme est bien atteinte » / sarabande dans « Vous demandez pour qui mon coeur soupire… », sommet à 2 voix dans l’art de l’élégance suggestive).
Les Épopées et Stéphane Fuget cisèlent la verve inspirée de 19 airs parmi les plus beaux du Grand Siècle. L’accord clavecin / viole de gambe s’avère idéalement calibré dans l’exploration des sentiments des couples éprouvés par la passion : Sylvie, Amaranthe, Phillis, et même Climène errent, se perdent, et se réalisent aussi dans la tension et les vertiges d’émotions contraires.
Le travail des interprètes soigne en particulier l’articulation d’une déclamation la plus respectueuse des images émotionnelles de chaque texte ; voix non vibrée, droite, claire, longue, profonde (Claire Lefilliâtre, dessus, soliste dans « Forêts solitaires » d’une couleur essentiellement lacrymale voire désespérée, avec son « double », variation ornementée de la première strophe qui en définitive creuse davantage l’ampleur doloriste de la plainte). L’équilibre et le dosage du geste vocal servent la caractérisation dramatique, tout en permettant aux deux chanteurs de diversifier les effets dans l’art d’éclairer, de commenter, d’exprimer tous les registres signifiants du texte.
Tout cela va dans le sens d’un approfondissement très convaincant du sens (langueur elle aussi doloriste du berger trahi par l’ingrate Sylvie, d’ « Ah je sens que mon coeur » où la basse Luc Bertin-Hugault sait articuler en souplesse, maîtrisant ports de voix et legato). D’une délicate expressivité au clavecin, Stéphane Fuget veille à l’équilibre global entre expressivité, intelligibilité, grande pudeur intérieure.
Autant de qualités qu’exige une réalisation dans le cadre éduqué d’un salon raffiné à Paris dans les années 1660-1680. Tourments, soupirs, impuissantes larmes… aucun affect ne manque dans ce parcours du Tendre où toujours c’est la palpitation du cœur qui se consume. Seul l’air « Récit sur la convalescence du Roy », en hommage à Louis XIV (pour soprano) tempère ici les vertiges doloristes et cette vallée de langueurs suspendues.
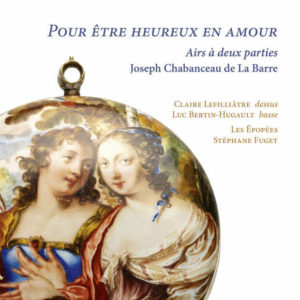 Instrumentistes (délectable théorbe de Nicolas Watinne dans la pièce purement instrumentale « Cessez Climène… ») et chanteurs sont tous au diapason d’une éloquente sensibilité ; et c’est toute l’ambiance des airs chantés dans les salons du XVIIème qui se révèle ainsi, sur-expressive, élégantissime. Comme il l’a développé dans l’articulation des Grands Motets de Lully, mais aussi dans la tenue des récitatifs des opéras italiens (Monteverdi, Haendel…), Stéphane Fuget dévoile sa passion pour l’articulation de la langue vocale, véritable geste dramatique,toujours au service de l’intelligibilité du texte. Très convaincant.
Instrumentistes (délectable théorbe de Nicolas Watinne dans la pièce purement instrumentale « Cessez Climène… ») et chanteurs sont tous au diapason d’une éloquente sensibilité ; et c’est toute l’ambiance des airs chantés dans les salons du XVIIème qui se révèle ainsi, sur-expressive, élégantissime. Comme il l’a développé dans l’articulation des Grands Motets de Lully, mais aussi dans la tenue des récitatifs des opéras italiens (Monteverdi, Haendel…), Stéphane Fuget dévoile sa passion pour l’articulation de la langue vocale, véritable geste dramatique,toujours au service de l’intelligibilité du texte. Très convaincant.
___________________________________
 CRITIQUE CD événement. JOSEPH CHABANCEAU DE LA BARRE : Airs à deux parties. Les Epopées, Stéphane Fuget (1 cd Ramée, enregistré en juin 2023 à Sens) – CLIC de classiquenews hiver 2024-2025.
CRITIQUE CD événement. JOSEPH CHABANCEAU DE LA BARRE : Airs à deux parties. Les Epopées, Stéphane Fuget (1 cd Ramée, enregistré en juin 2023 à Sens) – CLIC de classiquenews hiver 2024-2025.




