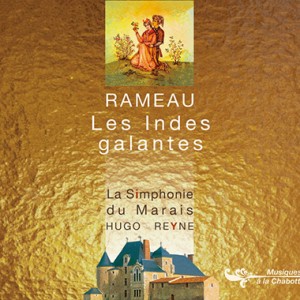 CD. Rameau : Les Indes Galantes (Hugo Reyne, 2013)… Parlons de l’œuvre d’abord. S’il y a bien un « cas » Hippolyte et Aricie, scandale retentissant et coup de génie sur la scène lyrique et tragique en 1733, il y eut bien un nouvel accomplissement tout autant capital dans l’art français avec Les Indes Galantes de 1735/1736…. Au début des années 1730, le quinqua Rameau y renouvelle considérablement le genre de l’opéra ballet légué par Lully et Campra (L’Europe Galante de 1697), mais le Dijonais va plus loin et ose plus fort : la galanterie ici unit les parties disparates (les quatre entrées), et la danse unifie le propos avec l’essor du ballet héroïque et d’action.
CD. Rameau : Les Indes Galantes (Hugo Reyne, 2013)… Parlons de l’œuvre d’abord. S’il y a bien un « cas » Hippolyte et Aricie, scandale retentissant et coup de génie sur la scène lyrique et tragique en 1733, il y eut bien un nouvel accomplissement tout autant capital dans l’art français avec Les Indes Galantes de 1735/1736…. Au début des années 1730, le quinqua Rameau y renouvelle considérablement le genre de l’opéra ballet légué par Lully et Campra (L’Europe Galante de 1697), mais le Dijonais va plus loin et ose plus fort : la galanterie ici unit les parties disparates (les quatre entrées), et la danse unifie le propos avec l’essor du ballet héroïque et d’action.
Hugo Reyne souligne l’éclat poétique des Indes Galantes de Rameau
Live viennois enthousiasmant
Mais, exigence du sens oblige, et soucieux d’une dramaturgie pas que décorative, Rameau et son librettiste Fuzelier, développent aussi une satire de la société française (comme l’a fait Montesquieu dans ses Lettres persanes de 1721) : sous couvert de badinerie exotique (Les Indes sont orientales donc persanes, mais aussi occidentales, donc des Amériques), les deux satiristes pourfendeurs tendent le miroir (comme dans Platée) à leurs contemporains, et Rameau si peu courtisan et frappé de lucidité quant à la comédie humaine, y épingle les travers les plus ignobles du genre humain. L’homme en société est un monstre que la candeur et l’innocence du bon sauvage sait dénoncer par contraste. La sociabilité corrompt le coeur humain que la musique de l’enchanteur Rameau sait retrouver à sa source : le prétexte exotique et le registre amoureux et tendre permettent de réaliser cette miraculeuse redécouverte. Un retour aux sources d’une certaine manière que la magie d’une musique enchanteresse réactive.
Au désir et à la magie de l’effusion partagée, Rameau imagine un délire naturaliste pur avec l’entrée des Fleurs où l’orientalisme persan du propos (la rose éprouvée par Borée est guérie par Zéphire) offre un canevas poétique absolu. De même, dans Le Turc généreux, le compositeur sait glisser une tempête naturelle : aboutissement des recherches de Rameau sur l’évocation des phénomènes qu’il a observés (vent, éclairs, orage…). Expression des miracles de la nature et dénonciation de la perversité vénale des colons européens se conjuguent idéalement dans l’entrée des Incas où Rameau caractérise le personnage clé de Huascar qui pour écarter vainement son aimée Phani (qui aime l’envahisseur espagnol Carlos), suscite en sorcier démiurge, l’irruption d’un volcan, preuve que les dieux Incas sont en colère contre l’union d’un indigène et de l’étranger… Ici, Fuzelier par son livret se place aux côtés de Las Casas, défenseur de la cause indienne lors de la controverse de Valladolid : l’harmonie des bons sauvages est détruite par l’appétit des européens qui sous couvert d’une évangélisation abusive, ciblent tout l’or de l’Inca.
On comprend dès lors que Les Indes Galantes sont l’aboutissement du Rameau le plus exigeant comme le plus raffiné ; sa haute conscience morale égale l’exigence de l’esthète artiste. C’est dire la valeur des Indes Galantes.
Que pensez de cette nouvelle réalisation qui s’appuie sur un édition originale conçue par Hugo Reyne, le chef fondateur de la Simphonie du Marais (la partition nouvelle demeure accessible gratuitement sur la toile) ?
Difficile pour les connaisseurs de passer après l’indiscutable William Christie et l’excellence de ses Arts Florissants qui les premiers ont su défendre l’âme et l’esprit de la musique ramélienne, qu’il s’agisse d’opéras et de ballets. Leur production au Palais Garnier reste mémorable comme Atys de Lully à l’Opéra Comique. Et que dire encore parmi les nouveaux interprètes, du geste millimétré, architecturé comme peu, du claveciniste et chef Bruno Procopio, qui récemment a démontré sa science intuitive, particulièrement irrésistible dans le même répertoire (Chaconne des Sauvages entre autres), mais de surcroît avec instruments modernes (avec les musiciens du Simon Bolivar Orchestra, l’orchestre de Gustavo Dudamel)?
 S’agissant de la lecture d’Hugo Reyne, l’impression globale est favorable malgré d’évidents déséquilibres. D’abord, nos réserves. Maillon faible de la production, le chœur qui manque de sûreté comme de subtilité dans l’élocution d’un français le plus tendre ou le plus expressionniste : pas assez de précision ni d’intonation pleinement maîtrisée. Le plateau des solistes se hisse honnêtement face à un massif de perfections multiples dont il ne restitue que quelques fragments.
S’agissant de la lecture d’Hugo Reyne, l’impression globale est favorable malgré d’évidents déséquilibres. D’abord, nos réserves. Maillon faible de la production, le chœur qui manque de sûreté comme de subtilité dans l’élocution d’un français le plus tendre ou le plus expressionniste : pas assez de précision ni d’intonation pleinement maîtrisée. Le plateau des solistes se hisse honnêtement face à un massif de perfections multiples dont il ne restitue que quelques fragments.
Entre autres, emblématique de toute l’approche et des moyens mis en œuvre, la soprano Stéphanie Révidat, excellente vocaliste au demeurant, aux aigus pas toujours clairement et fermement tenus, semble manquer encore d’aise comme de naturel. Manque de temps de répétition ? Probablement. La Zima de Valérie Gabail déçoit dans Les Sauvages (ratant toute sa partie finale par une justesse aléatoire et une maniérisme linguistique qui gomme des décennies de pratique baroqueuse antérieure), et même Aimery Lefèvre que l’on a connu plus élégant et fluide, écrase son timbre avec un vibrato qui devient systématique… (son Huascar reste monolithique quand Fuzelier et Rameau ont conçu un personnage complexe, fier et tendre, attachant à force de souffrance amoureuse et d’impuissance malgré le volcan qu’il maîtrise). Le haute-contre François-Nicolas Geslot doit impérativement mieux contrôler ses lignes et sa justesse (Tacmas) : avec plus de maîtrise, son sens du phrasé pourrait réserver de belles surprises dans les prochaines années. En revanche, le français impeccable de Reinoud Van Mechelen est le pilier de la production, mais le ténor n’est-il pas passer par le Jardin des Voix de William Christie justement ? Son style, son élégance naturelle restent un modèle pour chacun des solistes réunis à Vienne. Que n’a-t-il ici chanté justement le rôle de Tacmas ?
Mais en dépit des défaillances ici et là relevées, l’engagement global des solistes relève la tenue générale d’une prise live qui se révèle à l’écoute réellement entraînante, touchante même par sa tension nerveuse, son allant dansant : autant de qualités que souligne l’écoute et qui doit sa réussite au seul tempérament du chef fédérateur.
Le vrai personnage revendiquant ici l’éclat du genre symphonique en germe, c’est évidemment l’orchestre. Symphoniste dans l’âme, et dramaturge pour les instruments, Rameau redouble d’invention comme souvent, d’éclairs géniaux. La tendresse suave et exquise du ballet des Fleurs (premier véritable ballet d’action où brilla -outre la flûte enchanteresse souvent en solo-, l’étoile de la danse Marie Sallé) ou la sublime chaconne des Sauvages, pleine d’une majesté nostalgique…. d’un feu à la fois guerrier et tendre (trompettes et hautbois/bassons), montrent assez le soin et la passion que cultive Hugo Reyne dans un répertoire qu’il aime sincèrement et dont il aime à transmettre l’éclat comme la vitalité. Le chef de La Simphonie du Marais a publié nombre de disques dédiés à l’émergence et l’évolution du ballet de cour et des premiers opéras baroques français. Sa connaissance affûtée et analytique du genre s’en ressent ici.
Défenseur depuis des années du patrimoine baroque français, en cela parfait héritier de William Christie, le chef flûtiste détaille, caractérise, swingue aussi avec une énergie de bout en bout enthousiasmante. La vitalité (rehaussée par la prise live de l’enregistrement) est ici la marque de fabrique de cette réalisation dont le charme envoûté sait communiquer son amour de l’œuvre, l’une des plus fascinantes du grand Rameau. Le disparate des quatre entrées chorégraphique est effacé sous le flux, le souffle coûte que coûte que sait instiller Hugo Reyne. Live attachant et très impliqué, d’autant plus opportun en cette année Rameau où, pour le moment les nouveautés discographiques sont étrangement plutôt rares.
Rameau : Les Indes Galantes, nouvelle édition complète. Solistes, chœur et orchestre de La Simphonie du Marais. Hugo Reyne, direction. Version intégrale enregistrée au Konzerthaus de Vienne en 2013. Coffret 3 cd, Editions « Musiques à la Chabotterie ». Parution annoncée le 22 mai 2014




