CD. Rameau : Zoroastre (Christie, 2001) … En ces temps de célébration Rameau (2014 marque le 250ème anniversaire de sa mort en 1764), où les grands projets lyriques se font rares – aucune grande tragédie lyrique du Dijonais n’est à l’affiche ni l’Opéra de Paris, héritière de l’institution pour laquelle le compositeur a écrit tous ses opéras (Académie royale de musique), ni même à l’Opéra de Dijon (qui ne manque pas de moyens pour célébrer son plus grand génie musical et patrimonial), le disque remplit opportunément notre soif et comble d’une certaine façon notre attente.
D’autant qu’avec la renaissance du label Erato en 2013, nous voici en présence de deux références absolues dans l’histoire de l’interprétation des opéras de Rameau : Zoroastre (2001) et Hippolyte et Aricie (1996) par William Christie et ses Arts Florissants.
Zoroastre (version 1756)
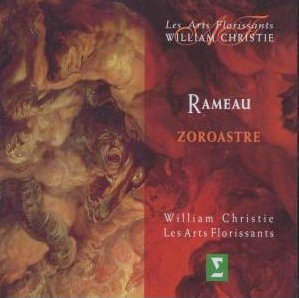 En 2001, Les Arts Florissants frappent un grand coup et démontre des affinités incroyables avec la science et la passion du théâtre de Rameau.
En 2001, Les Arts Florissants frappent un grand coup et démontre des affinités incroyables avec la science et la passion du théâtre de Rameau.
Il ne faut écouter que l’ouverture, formidable machine infernale dès le début avec ses pointes sardoniques (annonçant le rituel noir et démoniaque de l’acte IV) pour comprendre le propos de Rameau sublimé par l’enchanteur » Bill » : une impressionnante architecture musicale et dramatique, des ténèbres vers la lumière.
Le compositeur met en pratique dans Zoroastre, sa conception encyclopédique des passions humaines (l’opposition noire et si maléfique du couple haineux et cynique Abramane et Érinice, et leurs pendants lumineux Zoroastre et Amélite), mais aussi sa propre théorie du théâtre musical : une formidable machinerie suscitant émerveillement, spectaculaire voire féerie tout au moins onirisme. Le théâtre d’opéra suscite chez Rameau, une série de visions recomposant les phénomènes de la nature. C’est aussi fidèle à son génie polymorphe une très fine approche de caractères, ajoutant au souffle de la fresque, l’acuité de situations psychologiques brûlantes : ainsi, Érénice comme la Vittelia de La Clémence de Titus, bascule soudain de la cruauté barbare à la compassion la plus humaine … car elle aime certes vainement Zoroastre ; mais touchée par la valeur morale du héros, l’héroïne se métamorphose à son contact (début du V).
Le fondateur des Arts Florissants comprend si bien la langue de Rameau qu’il en exprime cette magie élégante, ce raffinement si tendre : toute la part de l’humain sous le feu de la science. Et sous la fureur du sujet démoniaque, le chef des plus inspirés en distille l’essence tendre et humaine. La nervosité trépidante et l’allant irrépressible des danses pointées, l’élégie qui se révèle soudain en un rondeau d’une ineffable nostalgie, toute l’articulation organique d’une vivacité aérienne qui semble toujours inspiré par le sentiment de l’innocence font la valeur de la vision d’un William Christie qui sait avec quelle justesse révéler sous la machinerie ramélienne, sa riante facétie, une gaieté souveraine qui transcende le sérieux apparent du drame originel. C’est une compréhension unique à ce jour de l’univers ramélien.
La même intelligence veille ici sur la distribution, finement caractérisée comme toujours avec ce respect palpitant de l’éloquence linguistique, travail central de toute l’esthétique de William Christie. Anna Maria Panzarella éblouit dans le rôle machiavélique d’Érinice : âme implacable et rien que haineuse qui suscite les démons et les génies cruels contre sa rivale Amélite… Voilà bien le rôle central de l’opéra. Malgré son accent british, Mark Padmore demeure exactement et continûment dans la vérité du rôle héroïque de Zoroastre, touché par la grâce de l’amour, conduit par Oromasès, véritable instance paternelle. Mais c’est comme pour son Hippolyte et Aricie, une science incomparable de la vitalité orchestrale qui restitue à Rameau sa formidable imagination pour l’orchestre : un foisonnement singulier et une activité complexe que le maestro démêle avec subtilité et un naturel irrésistible. Ecoutez cette nervosité incandescente des instruments et ce dès l’ouverture (décidément à tomber) et vous succomberez comme nous à la poétique ramélienne. Mozart, celui de La Flûte y à puiser toute la fascination de son théâtre : les forces maléfiques à l’oeuvre, le couple des élus pourtant éprouvés, la figure juste de la grâce paternelle (Oromasès)… Tout cela est magnifiquement exprimé par le plus grand ramélien à ce jour. Du très grand Rameau. Décidément inégalé. Rameau : Zoroastre, version 1756. Enregistrement réalisé en 2001. 3 cd Erato




