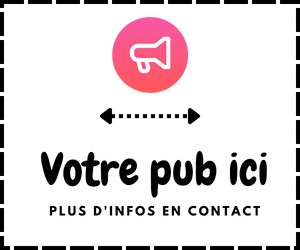L’être schubertien à travers la solitude
D’abord, ce soir, Schubert a 26 ans en une Sonate D.784 , « écho du lied désespéré Der Zwerg », rappelle Brigitte Massin dans son indispensable Somme qui ne quitte jamais le schubertien en voyage. Franz, vraisemblablement, vient aussi d’apprendre la grave « maladie d’amour » dont les soins immédiats vont le stigmatiser dans Vienne-la-pudibonde et surtout la menace de fin terrible va le hanter. Dès que s’ouvre l’allegro, un appel humble, une basse impérieuse avertissent, du tremolo furieux qui « répond » au chant suppliant. Elisabeth Leonskaïa prend la mesure de ce mouvement décisif (dans l’histoire du romantisme, ainsi qu’ « on » ne l’a pas toujours saisi !), dialoguant avec le créateur, devant nous, en cette absence de théâtralité qui émeut au plus profond parce qu’elle retient et montre l’essentiel : messagère de crainte, d’espoir, toute entière abandonnée, mais sans nulle impudeur, à ce qui saisit l’être schubertien à travers sa solitude. Elle jauge le poids de ces silences, de ces butées sur le vide, et dans l’instant on se promet d’aller voir au pays d’Hölderlin ce qui est aussi « chanté » là. Eh oui : « Il ne sert à rien, dieux de la mort, de chercher, de gémir ou de vous insulter… Mais il faut que de très loin me soit venu un signe, et je dois sourire, surpris, de nous sentir ensemble dans la douleur. » Schubert n’a écrit aucun lied sur les poèmes d’Hölderlin, et pourtant comme ils eussent été dignes et heureux de « se rencontrer », ces deux errants de l’art, de la pensée, de la pure poésie ! C’est un peu comme si la pianiste se laissait envahir par cette coexistence imaginaire mais à laquelle – peut-être (on eût aimé le lui demander, lui poser au moins cette nature de questions, mais n’avait-elle pas mieux à faire en ce Voyage d’Eté aux Montagnes ?), elle songe en explorant les fureurs articulées sans complaisance, jusqu’à cette coda qu’envahit la miséricordieuse paix du soir, apaisement aux harmoniques résonnant interminablement dans notre mémoire. C’est aussi dans son andante, tout d’ambiguïté dans l’être pour toujours partagé, chez qui d’un pianissimo peut naître une colère que la nostalgie – sinon l’espoir, ce serait trop beau…- sait à son tour calmer et du moins entrer dans l’absence de souffrance, son anesthésie provisoire et ardemment désirée. Alors on peut s’élancer en une nouvelle fuite en avant que seule rompra l’inattendue petite danse de nostalgie, mouvement perpétuel qui transcende aussitôt sa tentation de virtuosité. Parfois, un arpège roule et entraîne un tourbillon qui disparaît dans un silence : on pense à ces cavités criblant les hauts plateaux calcaires où se précipite la pluie d’orage qui semble y disparaître mais va « résurger » des centaines de mètres plus loin et plus bas, pour irriguer la future plaine de son voyage secret, métaphore de l’œuvre parcourant le Temps… Elisabeth L. a des gestes-virgules, des suspensions brutales à couper le souffle, presque des gifles sur le clavier qui sont le reflet visible d’une invisible lutte avec l’Ange. Quatre accords scellent cette intensité tragique.
Rends-toi mon cœur nous avons assez lutté
Alors peut commencer – 31 ans – le 2nd acte d’une Tragédie terminale, celle des trois Sonates de 1828 qu’on pourrait appeler « Au bord du silence ». Dès l’orée de la D.959, la pianiste fait rouler, sur les piliers d’accords d’un orage au lointain, d’énigmatiques arpèges, et en fait émerger une petite chanson –inquiète ? innocente ? interrogatrice des mystères criblés de son suspendu ? -. Elle va bientôt nous aider à poser la question schubertienne par essence : qu’est-ce qu’une phrase, qui tourne inlassable dans la lumière des modulations, avec cet épisode enchanteur et hors de toute règle constructrice ? Oui, le motif essaie avec elle toutes les teintes saisonnières d’un cercle enchanté où tout finit par se refermer sur soi-même et la mémoire qu’on en saura conserver : fermement articulé pour mieux s’évader en un temps préservé de l’érosion, après avoir fait le tour heureux de cette boîte à regards et miroirs. Pour finir, la source tarit, se fractionne en minuscules gouttelettes, des accords arpégés encore, et le monde se tait. Peut advenir le chant du désespoir (in-espoir serait plus juste ?), cet andantino du Mal dans l’univers et de l’Innocence broyée. E.Leonskaïa y entre sans nulle forfanterie de trop d’éloquence, elle se contente d’énoncer ce constat désolé, qui se ponctue et avance, ancré au passé et pourtant cherchant le comment-s’évader. On se récite Michaux : « Rends-toi, mon cœur. Nous avons assez lutté, Et que ma vie s’arrête. On n’a pas été des lâches, On a fait ce qu’on a pu… Seigneurs de la Mort Je ne vous ai ni blasphémés ni applaudis. Ayez pitié de moi, voyageur déjà de tant de voyages sans valises… ».
Pourquoi ? Parce que c’est ainsi.
Et on se « repasse » le génial et terrible « Au hasard Balthazar » où Robert Bresson, – le premier dans l’histoire du cinéma ? -, fit de cette mélodie schubertienne le leitmotiv de son film sur le malheur d’un âne chargé de raconter la condition et la persécution humaines…. La force interprétative de Leonskaïa, c’est de dire cela dans la tranquillité : le « parce que c’est ainsi » qui « répond » à tous les «pourquoi ? » inlassables des enfants, au sans- langage des animaux, aux plaintes argumentées et furieuses des adultes, toujours tombant dans le vide. Quand dans l’épisode central un orage surgi du néant fond sur nous, la pianiste en atténuerait presque la fureur initiale, mais c’est sans doute pour mieux se plonger – tout le corps frémissant, et la tête secouée en tous sens, « non, ce n’est pas possible ! » – en ce passage terrorisé qui ne finira qu’avec le retour symétrique, annoncé par le trille à la basse, du chant désolé. La rivière remonte le Temps, mais au bout il n’y plus rien à dire, à faire, c’est une coda prodigieuse d’anéantissement dans la gravité du silence. Ce que Schubert vient d’inventer là, et qui aveugle de sa clarté, ni Mozart, ni Beethoven, ni Schumann, ni Chopin n’y eussent seulement songé en leur désir de perfection, et la pianiste russe, mieux que quiconque, a su nous lover au cœur de l’énigme.
Au-delà du Styx…
Plus loin, transparence dansée d’un scherzo et vite l’agitation et la fureur mal contenues, avant qu’un trio, un peu chaloupé, attendri, hésitant ne soit porté par E.L. – qui le joue en un apparent détachement – à l’altitude raréfiée. Enfin s’engage l’allegretto terminal : le Wanderer sort à 5 heures, sans la marquise de l’ironie valéryenne ni la philosophie du rituel kantien à Koenigsberg, car c’est un fragment du voyage vital qui peut-être se continuera au-delà du Styx. Schubert l’accomplit en une logique tranquille – une des plus étonnamment « continues » qui aient jamais été notées par un musicien -, en une appropriation du Temps comme si le héros-promeneur parti pour rencontrer son Destin trouvait ce personnage-là non point le long du chemin, mais en lui-même. Comme si le Destin était lui-même, et qu’il n’y eût point à s’en étonner. Le secret d’interprétation est ici de suivre longtemps, également, le flux – chemin en encorbellement, ruisseau, qu’importe la matière -, qui grandit ou s’apaise, fait croiser les mains vers les basses du clavier d’un mouvement harmonieux de balancier, d’épouser les transitions si paisibles en apparence. Jusqu’à cette butée ultime où tout de même un silence s’ouvre, laissant le chant de ce flux repartir, s’interrompre aussitôt, s’étonner, dialoguer avec son devenir qui semblait assuré, accélérer de tempo et d’une intensité soudaine qui trouble ce jeu, balayant les pièces sur l’échiquier, mais finit par se stabiliser sur des accords devenus solennels pour que le rideau tombe.
Il fait un temps à n’y pas croire
 Comme les autres soirs, revenue des coulisses en cette démarche altière et naturelle à la fois – non pas la statue de marbre ou la marche précipitée ou la mécanique un rien fantastique de certains -, Elisabeth Leonskaia, cette fois acclamée par une assistance toute de ferveur et – si on se l’avoue – au bord des larmes, offre un bis. Ce sera – sauf erreur – l’allegretto en ut mineur, de 1827 (celui qui figure en fin du disque signé par Artur Schnabel quand il « révélait » en 1939 la grandeur de l’ultime Sonate alors appelée 21e) : de simple énoncé, de douceur déchirante, en interrogation aux subtils ralentis, pathétique ou simplement nostalgique, on ne saurait en décider, sauf qu’il s’agit d’un adieu pour ceux qui ne pourront demeurer ici pour la fin de ce cycle enchanté. On voit bien qu’il n’y a ici ni camera ni même micro, seulement la mémoire si vive de spectateurs qui pourtant oublieront peu à peu. On se scandalise une fois encore de cette salle presque vide – et pourtant si habitée de respect, de ferveur, de gratitude rassemblés -, on se remémore le seul concert consacré à Franz pour ses seules œuvres, en mars 1828, et où il ne manquait que … la Critique Officielle, puisque Paganini jouait ce soir-là et que donc il y avait ordre des priorités. Et puis on se plaît à imaginer : peut-être Elisabeth Leonskaïa souhaitait-elle cette presque solitude, à l’image de Schubert dans la Cité, et pourtant peuplée d’amitié, d’admiration ? Tout à l’heure, la pianiste « recevra » dans les coulisses de la salle quelques personnes qui auront osé lui dire leur gratitude : là encore simple, souriante, attentive, comme « si de rien n’était ». Bien sûr, elle n’est pas seule dans ce Voyage d’Eté qu’elle aura dans cinq jours mené à son terme, et cela vaut mieux que des foules agitées et tout en surface. Tout de même, c’était pour Schubert ? Justement, c’était pour lui, et d’une certaine façon, c’était bien ainsi. Dehors, sur l’esplanade, quelques fervents demeurent. La lune sort des nuages, les glaciers apparaissent dans la lumière bleutée. On pourrait chanter « Nacht und Traüme ». « Il fait un temps à n’y pas croire », hasardait un poète français qui n’aimait guère la musique mais en écrivit comme malgré lui….
Comme les autres soirs, revenue des coulisses en cette démarche altière et naturelle à la fois – non pas la statue de marbre ou la marche précipitée ou la mécanique un rien fantastique de certains -, Elisabeth Leonskaia, cette fois acclamée par une assistance toute de ferveur et – si on se l’avoue – au bord des larmes, offre un bis. Ce sera – sauf erreur – l’allegretto en ut mineur, de 1827 (celui qui figure en fin du disque signé par Artur Schnabel quand il « révélait » en 1939 la grandeur de l’ultime Sonate alors appelée 21e) : de simple énoncé, de douceur déchirante, en interrogation aux subtils ralentis, pathétique ou simplement nostalgique, on ne saurait en décider, sauf qu’il s’agit d’un adieu pour ceux qui ne pourront demeurer ici pour la fin de ce cycle enchanté. On voit bien qu’il n’y a ici ni camera ni même micro, seulement la mémoire si vive de spectateurs qui pourtant oublieront peu à peu. On se scandalise une fois encore de cette salle presque vide – et pourtant si habitée de respect, de ferveur, de gratitude rassemblés -, on se remémore le seul concert consacré à Franz pour ses seules œuvres, en mars 1828, et où il ne manquait que … la Critique Officielle, puisque Paganini jouait ce soir-là et que donc il y avait ordre des priorités. Et puis on se plaît à imaginer : peut-être Elisabeth Leonskaïa souhaitait-elle cette presque solitude, à l’image de Schubert dans la Cité, et pourtant peuplée d’amitié, d’admiration ? Tout à l’heure, la pianiste « recevra » dans les coulisses de la salle quelques personnes qui auront osé lui dire leur gratitude : là encore simple, souriante, attentive, comme « si de rien n’était ». Bien sûr, elle n’est pas seule dans ce Voyage d’Eté qu’elle aura dans cinq jours mené à son terme, et cela vaut mieux que des foules agitées et tout en surface. Tout de même, c’était pour Schubert ? Justement, c’était pour lui, et d’une certaine façon, c’était bien ainsi. Dehors, sur l’esplanade, quelques fervents demeurent. La lune sort des nuages, les glaciers apparaissent dans la lumière bleutée. On pourrait chanter « Nacht und Traüme ». « Il fait un temps à n’y pas croire », hasardait un poète français qui n’aimait guère la musique mais en écrivit comme malgré lui….
17e Festival de Verbier. 25 juillet 2010. Salle des Combins. 6e concert de l’intégrale des Sonates pour piano. Franz Schubert (1797-1828) : D.784 et 959. Elisabeth Leonskaïa, piano.