 Même malade, à 49 ans, Gustav Mahler ne manque ni d’énergie créatrice ni d’envie de composition. Et déjà, l’activité qu’il mène pour la première saison des concerts philharmoniques de New York, en 1909, atteste d’une hyperactivité stupéfiante.
Même malade, à 49 ans, Gustav Mahler ne manque ni d’énergie créatrice ni d’envie de composition. Et déjà, l’activité qu’il mène pour la première saison des concerts philharmoniques de New York, en 1909, atteste d’une hyperactivité stupéfiante.1907 fut une année terrible : fin de sa direction à l’Opéra de Vienne, après dix ans de fonction, décès de sa fille, Maria, âgée de quatre ans, diagnostic affectué sur son état physique alarmant : Mahler souffre d’une « insuffisance mitrale ». Chaque pas lui est désormais compté, pas ‘émotions ni de chocs. Entre deux répétitions au Metropolitan Opéra, il s’allonge, reprend son souffle et ses esprits. L’ombre de la mort semble planer à chaque minute.
En 1908, Alma loue une villa à Alt-Schluderbach et fait même construire un ermitage de bois afin que son époux retrouve le contact avec la nature qui l’avait tant inspiré jusque là. A Bruno Walter qui lui demande de préciser son état, Gustav Mahler exprime la convalesnce d’un être terrassé, atteint parce que désormais ce qu’il aimait le plus au monde, la marche, la rame, la randonnée, lui sont à présent interdits: « Car depuis que m’a saisi cette terreur panique à laquelle j’ai un jour succombé, je n’ai rien tenté d’autre que de regarder et d’écouter autour de moi. Si je dois retrouver le chemin de moi-même, alors il faut que je me livre encore aux terreurs de la solitude.(…) En tout cas, il ne s’agit absolument pas d’une crise hypocondriaque de la mort, comme vous avez l’air de le croire. J’ai toujours su que j’étais mortel. Sans essayer de vous expliquer ni de vous décrire quelque chose pour quoi il n’existe sans doute pas de mots, je vous dirai que j’ai perdu d’un seul coup toute la lumière et toute la sérénité que je m’étais conquises et que je me trouve devant le vide, comme si, à la fin de ma vie, il me fallait apprendre de nouveau à me tenir debout et à marcher comme un enfant. »
L’écriture dans un cadre naturel proche, qui lui permet de vivre à nouveau d’inestimables contemplations, lui offre la possibilité de se reconstruire.
Quinze mois après la mort de sa fille Maria, il compose tout d’abord le Chant de la terre, à la fois cycle de lieder et symphonie. De sorte que si l’on inclut le Chant de la terre dans le cycle des symphonies, la 9ème est bel et bien un dixième opus.
Genèse. Esquissée dès 1908, la 9ème est quasiment achevée à l’été 1909. Mahler occupe l’hiver suivant à la mettre au propre. Il écrit à Bruno Walter : « Qu’est ce donc en nous qui pense et qui agit? Comme c’est étrange! Lorsque j’écoute de la musique ou lorsque je dirige, j’entend très précisément la réponse à toutes ces questions et j’atteins alors une sécurité et une clarté absolues. Mieux, je ressens avec force qu’il n’existe même pas de questions! ».
Mahler a déposé dans la 9ème symphonie, la somme des dernières années douloureuses et éprouvantes. Pourtant jamais il n’a laissé un témoignage aussi lumineux sur sa pleine maturité. Est-il arrivé à un nouveau plan de conscience ?
Alban Berg donne peut-être la clé : « Je viens de rejouer la Neuvième Symphonie de Mahler. Le premier mouvement est les plus admirable qu’il ait jamais écrit. Il exprime un amour inouï de la terre et son désir d’y vivre en paix, d’y goûter encore la nature jusqu’à son tréfonds, avant que ne survienne la mort. Car elle viendra inéluctablement. Ce mouvement tout entier en est le pressentiment. Sans cesse elle s’annonce à nouveau. Tous les rêves terrestres trouvent ici leur apogée (et c’est là la raison d’être de ces montées gigantesques qui toujours se remettent à bouillonner après chaque passage tendre et délicat), surtout à ces moments terrifiants où l’intense désir de vivre atteint à son paroxysme (Mit höchster Kraft), où la mort s’impose avec le plus de violence. Là-dessus les terrifiants solos d’altos et de violons, les sonorités martiales: la mort en habit de guerre. Alors il n’y a plus de révolte possible. Et ce qui vient ensuite ne semble que résignation, toujours avec la pensée de l’au-delà ».
La Neuvième est bien la prière d’un homme qui souhaite dire « adieu », de la manière la plus apaisée. Symphonie crépusculaire, traversée par l’idée de l’au-delà, la paritition est suivie par les premiers mouvements de la 10ème symphonie dont le caractère donne la clé sur les oeuvres du dernier Mahler.
Pendant l’été 1910, Mahler sait qu’Alma lui préfère un autre. Leur couple s’est définitivement fissuré. Malade, atteint dans sa vie privée, Mahler n’en est pas pour autant un condamné, comme on l’a dit. C’est un homme courageux qui garde un sens de l’action et une détermination toujours plus affûtée.
Il a besoin d’absorber la tension et les conflits incontournables de la vie, la musique remplit cet office. Tout en approfondissant ses souvenirs rétrospectifs, dans la matière des symphonies, il prend du recul, il s’en échappe en y puisant aussi, une nouvelle énergie salutaire.
D’ailleurs en prenant la hauteur qui s’impose, celle dont Mahler nous a révélé qu’il était capable, dans ses Deuxième et Troisème symphonies, ne s’agit-il pas après tout, non des souffrances d’un homme qui se lamente sur son propre destin, que l’évocation du destin de l’humanité confrontée à sa propre fin ?
Le Scherzo délivre des sourires devenus grimaces, rictus de douleur incontrôlé, mais aussi un sens de la dérision sauvage, amer et sombre.
En quatre mouvements comme la Quatrième sypmphonie, la Neuvième, mêle quatre épisodes d’une profondeur de vue et de ressentiment bouleversant, d’autant que chaque mouvement développe presque indépendamment des autres, sa propre tonalité. Ainsi traversant ce vaste de champs des métamorphoses où l’âme ressent toutes les peines et toutes les joies de ce monde, Mahler nous fait passer du ré majeur initial au ré bémol majeur.
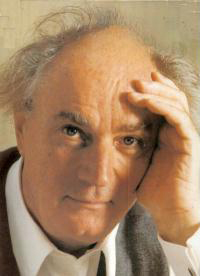 La vision de Rafael Kubelik. Dans l’Andante du début, Kubelik inverse avec une clarté et une hauteur de regard les deux versants de la quête mahlérienne, les adieux en majeur, l’énergie reconquise en mineur. Ce qui est frappant c’est le poids de l’inéluctable, parfaitement assumé par l’auteur qui ne réalise presque aucune réexposition de thème ; ici, le flux se déroule sans possible retour en arrière, ce qui accentue le sens profond de la distanciation, et la maturité d’un Mahler philosophe. C’est tout un monde auquel les trois Viennois, Berg, Webern, Schönberg puiseront les matériaux de l’avenir. Kubelik souligne ce rythme de marche lente où se pressent nostalgie, tristesse et résignation, mais l’épisme qu’il instaure donne son ouverture au mouvement, non pas un repli désespéré mais une porte vers l’infini. Le mouvement entier n’esquisse pas un chant de fin, plutôt l’amorce d’une nouvelle existence.
La vision de Rafael Kubelik. Dans l’Andante du début, Kubelik inverse avec une clarté et une hauteur de regard les deux versants de la quête mahlérienne, les adieux en majeur, l’énergie reconquise en mineur. Ce qui est frappant c’est le poids de l’inéluctable, parfaitement assumé par l’auteur qui ne réalise presque aucune réexposition de thème ; ici, le flux se déroule sans possible retour en arrière, ce qui accentue le sens profond de la distanciation, et la maturité d’un Mahler philosophe. C’est tout un monde auquel les trois Viennois, Berg, Webern, Schönberg puiseront les matériaux de l’avenir. Kubelik souligne ce rythme de marche lente où se pressent nostalgie, tristesse et résignation, mais l’épisme qu’il instaure donne son ouverture au mouvement, non pas un repli désespéré mais une porte vers l’infini. Le mouvement entier n’esquisse pas un chant de fin, plutôt l’amorce d’une nouvelle existence.
Pour le second mouvement, « dans le tempo d’un Ländler confortable » (Im tempo eines gemächlichen Ländler), l’orchestre exprime les sauts et les aspérités des mouvement de danse (au départ Mhaler avait pensé à un menuet) : cynisme et aigreur mènent ici le rythme. Tranchant expressionnisme échevelé d’une valse précipitée à laquelle s’oppose la lenteur étirée d’un menuet à l’ancienne.
Le Rondo Burleske, allegro assai. Sehr trotzig (très décidé) pointe ses arêtes grotesques et acides. Kubelik montre combien Mahler ici en usant et abusant même, mais avec expertise de la polyphonie, se moque du contrepoint, principe d’imitation parodique dont il est spécialiste. Il s’y délecte à jouer des niveaux de lectures. Les citations se font ici course à l’abîme.
L’Adagio final, indiqué « sehr langsam und noch zurückhaltend (très lent et encore retenu) est le plus pénétrant : ascensionnel, le chant des cordes semble étirer à l’extrêmité de la conscience et de l’espace, toute notion de temps. C’est une ample respiration/aspiration/expiration, une fin totalement apaisée qui aurait tout réconciler, absorber conflits et douleurs, pour s’éteindre au plus haut. Les fondements de la philosophie mystique de Mahler sont exposés dans cette ample prière : l’homme aspire à la paix divine en recherchant à fusionner avec la Nature, mère nourricière, mère protectrice, mère consolatrice. Kubelik tient son orchestre, une phalange de rêve où cordes, cuivres, vents, fusionnels, dessinent un somptueux accomplissement.




