Schubert le timide tente vainement de s’attirer reconnaissance et gloire à Vienne… Entreprise des plus incertaines tant malgré ses rencontres décisives avec le chanteur adulé Vogl et l’écrivain qui se rêve dramaturge, Franz von Schober, ses œuvres restent continûment incomprises. Même Weber avec lequel il finit par se brouiller, et Goethe à qui il envoie ses lieder de jeunesse des mieux inspirés (Le roi des Aulnes, Marguerite au rouet) ne daignent même pas répondre, mais lui retourne son paquet de lieder ! Tous écartent le musicien maladroit, malassuré. Accueilli, hébergé ici et là, tel un vagabond dépendant de la générosité de ses hôtes, Schubert parvient néanmoins à composer son opéra abouti Alfonso et Estrella, sur le livret de son complice Schober (1821).
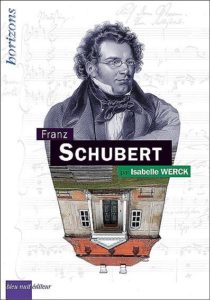 Aux côtés des événements d’une vie assez terne et construite contre les projets du père, l’auteure évoque de façon exhaustive les principales œuvres de Schubert : ses lieders, sa musique de chambre, les oeuvres pour piano, ses symphonies… Rien n’est laissé de côté ; mieux, la période viennoise qui donne alors l’ambiance où Schubert s’évertue, est remarquablement restituée : époque Biedermeier (1814 – 1848) donc où le traumatisme des guerres de Napoléon est sagement recyclé sous le règne d’un gouvernement conservateur et petit-bourgeois (en cela conforme à la politique de François II, le souverain de l’époque de Schubert), … gouvernants qui préfèrent l’écrin feutré des salons en famille plutôt que le spectaculaire des salles de théâtre.
Aux côtés des événements d’une vie assez terne et construite contre les projets du père, l’auteure évoque de façon exhaustive les principales œuvres de Schubert : ses lieders, sa musique de chambre, les oeuvres pour piano, ses symphonies… Rien n’est laissé de côté ; mieux, la période viennoise qui donne alors l’ambiance où Schubert s’évertue, est remarquablement restituée : époque Biedermeier (1814 – 1848) donc où le traumatisme des guerres de Napoléon est sagement recyclé sous le règne d’un gouvernement conservateur et petit-bourgeois (en cela conforme à la politique de François II, le souverain de l’époque de Schubert), … gouvernants qui préfèrent l’écrin feutré des salons en famille plutôt que le spectaculaire des salles de théâtre.
Schubert, les Schubertiades,
Vienne, 1810
sous le règne policier du chancelier Metternich
Schubert l’intimiste et l’introspectif correspond en réalité exactement à ce caractère, fait de repli et de discrétion. Ses lieder ont rencontré et trouvé leur public à Vienne dans les années 1820 : voilà qui s’avère lumineux et relativise quand même son isolement supposé. Quoiqu’il en soit, Schubert incarne une parenthèse enchantée et sincère dans un empire qui se replie sur de vieux rouages, particulièrement préservés par le chancelier Klemens Metternich, arbitre de la conformité la plus pétrifiée, bigot tyrannique, qui sur le plan sociétal, se méfie des bourgeois, musèle la société, suspecte chaque citoyen qui ose critiquer, potentiel insurgé et probable agitateur ; il fermera les clubs de natation et de gymnastique, considérés malfaisants, et s’entête à ce que les universités refusent les « fils des cuisinières », comme … Schubert. Pour autant, aussi candide et rêveur que paraît Franz, il est quand même inquiété lors d’une soirée chez son ami Johann Senn, poète et philosophe, libre penseur trop bon vivant : il sera emprisonné pendant 14 mois et Schubert arrêté, puis relâché avec un oeil au beurre noir ; il ne reverra plus jamais son ami. Evoquer le climat policier de Metternich, « prince de minuit », à Vienne à l’époque de Schubert, offre une nouvelle couleur à la mélancolie schubertienne. Une sorte de recontextualisation qui se montre passionnante. De fait, dès la première Schubertiade (1816), chaque réunion est aussi une manière de contester le régime politique qui les opprime. Même dans le choix des héros et références à la mythologie grecque se cachent des critiques codées vis à vis de Metternich et sa police. Passionnant.
Fidèle à la charte de la collection « horizons » de l’éditeur Bleu Nuit, ce nouveau volume comprend aussi tableau synoptique, bibliographie, discographie.
__________________________________________________________
 CRITIQUE LIVRE, événement. Isabelle Werck : Franz Schubert (Bleu Nuit éditeur – 177 pages ) – Plus d’infos sur le site de l’éditeur Bleu Nuit : https://bne.fr/page267.html – Collection HORIZONS, n°103. CLIC de CLASSIQUENEWS automne 2023.
CRITIQUE LIVRE, événement. Isabelle Werck : Franz Schubert (Bleu Nuit éditeur – 177 pages ) – Plus d’infos sur le site de l’éditeur Bleu Nuit : https://bne.fr/page267.html – Collection HORIZONS, n°103. CLIC de CLASSIQUENEWS automne 2023.



