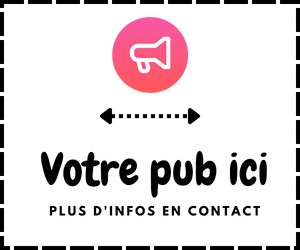Compte-rendu, opéra. PARIS, Opéra Bastille, le 16 mai 2018. Richard Wagner : Parsifal. Peter Mattei, Günther Groissböck, Andreas Schager, Anja Kampe, Evgeny Nikitin… Orchestre de l’Opéra. Philippe Jordan, direction. Richard Jones, mise en scène. Après une première repoussée suite à un accident technique, la maison parisienne inaugure enfin sa nouvelle production de Parsifal, le festival lyrique sacrée, mis en scène par l’anglais Richard Jones. Philippe Jordan dirige l’orchestre de l’Opéra avec sophistication et clarté, habituelles.
 PARSIFAL EST VENU POUR SAUVER LE MONDE … OU PAS. La légende du Graal qui inspire le livret s’est imposée à Wagner après avoir lu la romance médiévale Parzifal de Wolfram von Eschenbach. Le compositeur écrivit par la suite le synopsis de ce qui allait devenir son ultime opéra, ce dès 1857, soit 25 ans avant la première qui eut lieu grâce au soutien de son mécène, Louis II de Bavière. Il est nécessaire de citer ici un annexe au programme de la création à Bayreuth, de la plume du compositeur lui-même, nommé « Héroïsme et Chrétienté » (Heldentum und Christentum). Dans ce texte moins connu que son testament antisémite « La judéité dans la musique » (Das Judenthum in der Musik), Wagner explique que les aryens, leaders teutons de l’humanité tout entière, sont descendants des dieux, et que les autres races, inférieures forcément, descendent, elles, des primates. Il y exprime aussi son dégoût vis-à-vis de la dévotion des chrétiens pour un dieu juif, à travers son incarnation, ce Christ juif qu’il tient en horreur. Le compositeur s’est donné donc la peine de ré-imaginer le Christ selon son goût. Ainsi, le chevalier Parsifal devient, de fait, un Christ aryen.
PARSIFAL EST VENU POUR SAUVER LE MONDE … OU PAS. La légende du Graal qui inspire le livret s’est imposée à Wagner après avoir lu la romance médiévale Parzifal de Wolfram von Eschenbach. Le compositeur écrivit par la suite le synopsis de ce qui allait devenir son ultime opéra, ce dès 1857, soit 25 ans avant la première qui eut lieu grâce au soutien de son mécène, Louis II de Bavière. Il est nécessaire de citer ici un annexe au programme de la création à Bayreuth, de la plume du compositeur lui-même, nommé « Héroïsme et Chrétienté » (Heldentum und Christentum). Dans ce texte moins connu que son testament antisémite « La judéité dans la musique » (Das Judenthum in der Musik), Wagner explique que les aryens, leaders teutons de l’humanité tout entière, sont descendants des dieux, et que les autres races, inférieures forcément, descendent, elles, des primates. Il y exprime aussi son dégoût vis-à-vis de la dévotion des chrétiens pour un dieu juif, à travers son incarnation, ce Christ juif qu’il tient en horreur. Le compositeur s’est donné donc la peine de ré-imaginer le Christ selon son goût. Ainsi, le chevalier Parsifal devient, de fait, un Christ aryen.
Si la mise en scène de Richard Jones, avec décors géants et costumes d’Ultz, défend une transposition vers une modernité indistincte, dans une sorte de collège-secte aux Ier et IIIe actes, ou encore qui s’inscrit dans le milieu scientifique (cf le palais de Klingsor au IIe), elle demeure en vérité très conventionnelle. Voire vaine. Sans tension véritable, exceptions faites aux Ier acte, quelque-peu rocambolesque, et au IIe avec une pseudo-revue des Filles-Fleurs déjantées (aux seins géants) ; mais cette vision schématique et caricaturales, en rien poétique, est dépourvue de profondeur au IIIe. Les bijoux seraient donc à chercher ce soir dans la musique. Ou pas.
La distribution a le mérite d’être plutôt homogène voire engagée à servir tous les partis de la production. Ainsi, l’Amfortas de Peter Mattei dans toute sa gloire, tourmenté à souhait, élégant toujours, et avec une voix capable de force comme de souplesse. Excellente aussi, l’interprétation de Günther Groissböck en Gurnemanz ; au niveau scénique, il est même peut-être un poil trop beau au Ier acte, mais fait preuve d’une résilience vocale qui ne laisse pas indifférent. Comme d’habitude son chant a du caractère et sa diction est fantastique. Un peu moins fantastique celle d’Evgeny Nikitin en Klingsor. Le timbre sied au rôle merveilleusement, et la prestation a un je ne sais quoi d’étrange comme d’inquiétant… ma non troppo. La Kundry d’Anja Kampe est bouillonnante, bouleversante, tout simplement excellente malgré la minceur dramaturgique de la production. Il s’agît d’une performance sans défaut au niveau vocal, même si elle a pris un certain moment pour se chauffer au cours du Ier acte (qui il est vrai n’espt « son » acte). Que dire du Parsifal d’Andreas Schager ? S’il est cristallin dans les aigus, si d’une manière générale, son interprétation vocale est solide, remplissant l’immensité de l’Opéra Bastille (un exploit en soit déjà), il laisse, lui, osons le dire, plutôt indifférent. Les lieux communs qui lui sont attribués dans la mise en scène ne permettent pas non plus de voir ou apercevoir un quelconque relief. Dommage. Félicitons les nombreux petits rôles en pleine forme et le travail des chœurs de l’Opéra de Paris, sous la direction spiritosa de José Luis Basso.
L’Orchestre sous la baguette toujours raffinée de Philippe Jordan étale une sonorité uniforme et correcte. Sophistiquée voire sévère dans la forme, sa direction explore la partition avec sagesse. Le final éthéré reste un moment de grande beauté. S’il n’est pas obligatoire de jouer Wagner avec la force de la grandeur que le compositeur s’est auto-attribuée, le geste s’affirme juste, mais elle est souvent sans conviction. Peut-être le chef est-il secrètement du même avis que le philosophe Nietzsche quand il dit, tout en louant la force et la beauté d’une grande partie de l’opéra, qu’il était question ici d’une « œuvre malicieuse… mauvaise… outrageante pour la morale ». Tout en reconnaissant sa séduction formelle, la partition n’est elle pas en soi vénéneuse et dangereuse ? Encore à l’affiche à l’Opéra Bastille le 20 et 23 mai 2018. Comme celle antérieure à Paris signée Warlikowski, encore une nouvelle production wagnérienne qui ne laissera pas un souvenir impérissable.