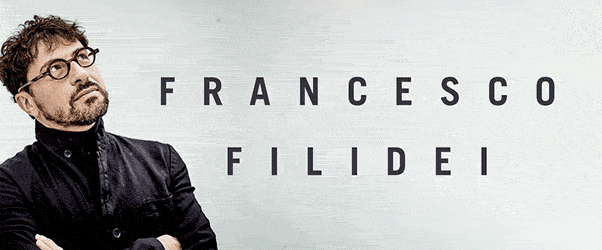Compte rendu, opéra. PARIS, Opéra Garnier, le 29 janvier 2019. Dvorak : Rusalka. Klaus Florian Vogt, Karita Mattila, Camilla Nylund… Choeurs et Orchestre de l’Opéra. Susanna Mälkki, direction. Robert Carsen, mise en scène. Le Dvorak lyrique de retour à l’Opéra avec la reprise de la production de Robert Carsen du conte Rusalka, d’après la mythique créature aquatique des cultures grecques et nordiques. La direction musicale du drame moderne et fantastique est assurée par la cheffe Susanna Mälkki, et une distribution de qualité mais quelque peu inégale en cette première d’hiver.
Compte rendu, opéra. PARIS, Opéra Garnier, le 29 janvier 2019. Dvorak : Rusalka. Klaus Florian Vogt, Karita Mattila, Camilla Nylund… Choeurs et Orchestre de l’Opéra. Susanna Mälkki, direction. Robert Carsen, mise en scène. Le Dvorak lyrique de retour à l’Opéra avec la reprise de la production de Robert Carsen du conte Rusalka, d’après la mythique créature aquatique des cultures grecques et nordiques. La direction musicale du drame moderne et fantastique est assurée par la cheffe Susanna Mälkki, et une distribution de qualité mais quelque peu inégale en cette première d’hiver.
Rusalka : la magie de l’eau glacée
L’histoire de la nymphe d’eau douce, immortelle mais sans âme, qui rêve de devenir humaine pour connaître l’amour, souffrir, mourir et… renaître (!) est inspirée principalement de l’Ondine de La Motte-Fouqué et de la Petite Sirène d’Andersen. Créé au début du 20e siècle, l’œuvre peut être considérée comme l’apothéose des talents multiples du compositeur tchèque. Il ajoute à sa fougue rythmique, un lyrisme énergique. Il utilise tous ses moyens stylistiques pour caractériser les deux mondes opposés : celui des créatures fantastiques, dépourvues d’âme, mais non de compassion; celui des êtres doués d’âmes mais aux émotions instables. Un heureux mélange de formes classiques redevables au Mozart lyrique et proches des audaces lisztiennes et wagneriennes. Parfois il utilise des procédés impressionnistes, et parfois il anticipe l’expressionnisme lyrique.
UNE FROIDEUR LYRIQUE QUI PEINE A SE CHAUFFER… Les nymphes de bois qui ouvrent l’œuvre sont un délicieux trio parfois émouvant parfois piquant, interprété par Andrea Soare, Emanuela Pascu et Elodie Méchain. Leur prestation au dernier acte relève et de Mozart et de Wagner sous forme de danse traditionnelle. La Rusalka de la soprano finnoise Camilla Nylund prend un certain temps à prendre ses aises. Son archicélèbre air à la lune du premier acte déchire les coeurs de l’auditoire par une interprétation bouleversante d’humanité et de tendresse. C’est dans le finale de l’opéra surtout, lors du duo d’amour et de mort qui clôt l’ouvrage, qu’elle saisit l’audience par la force de son expression musicale. Son partenaire le ténor Klaus Florian Vogt prend également un certain temps à se chauffer. A la fin du premier acte, il conquit avec son air de chasse, qui est aussi la rencontre avec Rusalka devenue humaine. La prestation est instable et perfectible : il paraît un peu tendu, voire coincé sur scène. Il semble avoir des difficultés avec des notes ; est parfois en décalage, mais il essaie de détendre sa voix dans les limites du possible, et sa performance brille toujours par la beauté lumineuse et incomparable du timbre comme la maîtrise de la ligne de chant. Le duo final est l’apothéose de sa performance.
La Princesse étrangère de Karita Mattila est délicieuse et méprisante au deuxième acte, sans doute l’une des performances les plus intéressantes et équilibrées de la soirée. La sorcière de la mezzo-soprano Michelle DeYoung est un cas non dépourvu d’intérêt. Théâtralement superbe au cours des trois actes, nous trouvons que c’est surtout au dernier qu’elle déploie pleinement ses qualités musicales. Remarquons le duo comique et folklorique chanté avec brio et candeur par Tomasz Kumiega en Garde Forestier et Jeanne Ireland en garçon de cuisine, …peureux, superstitieux, drolatiques à souhait. La performance de Thomas Johannes Mayer en Esprit du Lac a été déchirante, par la beauté du texte et du leitmotiv associé, mais comme beaucoup d’autres interprètes à cette première, son chant s’est souvent vu noyé par l’orchestre.
LES VOIX SONT COUVERTES PAR L’ORCHESTRE… L’orchestre de la maison sous la baguette fiévreuse de Susanna Mälkki est conscient des timbres et des couleurs. L’instrumentation de Dvorak offre de nombreuses occasions aux vents de rayonner, et nous n’avons pas manqué de les entendre et de les apprécier. La précision des cordes également est tout à fait méritoire. Or, la question fondamentale de l’équilibre entre fosse et orchestre, notamment dans l’immensité de l’Opéra Bastille, paraît peu ou mal traitée par la chef. La question s’améliore au cours des actes, et nous pouvons bien entendre et l’orchestre et les chanteurs au dernier. Un bon effort.
Sinon que dire de la mise en scène élégante, raffinée et si musicale de Robert Carsen ? Jeune de 17 ans, elle conserve ses qualités dues à un travail de lumières exquis (signé Peter van Praet et Carsen lui-même), qui captive visuellement l’auditoire. Le dispositif scénique est une boîte où un jeu de symétries opère en permanence, comme le jeu des doublures des chanteurs par des acteurs. D’une grande poésie, la transposition sage du canadien ne choque personne, malgré un numéro de danse sensuelle au deuxième acte qui représente la consommation de l’infidélité du Prince, ou encore l’instabilité et la frivolité violente des hommes. Si le jeu d’acteur est précis, de nombreux décalages sont présents dans l’exécution et la réalisation de la production. Une première d’hiver qui se chauffe progressivement… pour un résultat final qui enchante.
A voir à l’Opéra Bastille encore les 1er, 4, 7, 10 et 13 février 2019. Incontournable.