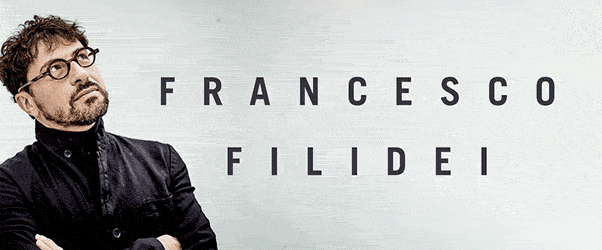Crudité scénique…
Structures métalliques, escaliers et cadres, gradins et bancs: nous sommes bien du côté de l’envers d’un miroir qui ne peut plus ni séduire ni tromper… du côté des coulisses où les transformations se faisant à vue, soulignent l’activité d’une satire et certes pas d’une scène enchanteresse: ainsi le superbe et si juste tableau où les 3 Nornes se changeant en naïades du Rhin, miment le voyage de Siegfried sur le fleuve… (avec grand écran diffusant l’image des eaux fluviales à l’appui…). Le regard de Günter Krämer est toujours aussi âpre et sans illusions, réaliste jusqu’au glacial métallique…
Saluons les vertus de la production parisienne qui s’achève ainsi à Bastille avec la Troisième et ultime Journée. Excellente idée par exemple de portraiturer Hagen en fauteuil roulant, infirme flanqué d’un globe, rêvant de reprendre l’anneau, de dominer le monde à la suite de Wotan inexistant, manipulant et flattant pour se faire, son demi frère Günther… La somptueuse basse Hans-Peter König en être frustré par son handicap mais ivre de puissance, fait admirablement le fils d’Alberich… lequel d’ailleurs parait en fin de tableau, comme pour mieux insister sur cette filiation noire, parfaitement assumée: tel père, tel fils. Les prédateurs se sont renouvelés, toujours prompts à ourdir intrigues et calculs pour ravir l’or et l’anneau aux filles du Rhin.
Dès le début, le metteur en scène insiste sur les forces cyniques ici dominantes (audibles en particulier chez les cuivres monumentaux et continus…): sous l’emprise des tractations tissées par le clan des Gibishungen, tout le monde de Wotan s’écroule… Une inéluctable agonie que tente d’inverser Waltraute dans son air avec Brünnhilde: mais celle-ci préfère conserver le confort petit-bourgeois de son amour avec Siegfried plutôt que de rendre l’anneau de ses noces aux Filles du Rhin (ce qui aurait annuler pourtant la malédiction qui envenime toute l’action). A l’ouverture, précédent le chant des trois Nornes, Hagen parait en petit garçon dans son fauteuil d’infirme… quand Alberich (grimé en fausse nurse) lui tend pour s’en amuser, une épée scintillante… Ainsi tout est dit dès le départ: ce dernier opéra est celui d’une ambition, celle de Hagen… Günter Krämer instille ainsi par petites touches les ferments d’une lecture réaliste, glaçante, désenchantée, non pas tant parce qu’il vient du regietheater (source parfaitement intégrée) mais plutôt par respect strict de l’esprit de l’œuvre: Wagner rappelons-le use et abuse des symboles légendaires pour mieux asséner sa vision shopenhauerienne, dépoétisée et dégoutée de la nature humaine. Siegfried n’a rien d’un héros: il trompe et bafoue; bien naïf, celui qui ne connaît pas la peur, se laisse bêtement manipulé… Comment a-t-il pu susciter ce culte qui continue de l’idolâtrer? C’est une victime décérébrée… certes pas un conquérant brillant par son intelligence. Et hélas, Torsten Kerl, vocalement limité et simple exécutant n’apporte aucune subtilité ni profondeur au personnage…
Pour le reste, cette barbarie que Wagner se plaît à nous dévoiler, est idéalement représentée. Palmes au metteur en scène pour la criante réalité de cette satire humaine: rien de plus juste que le regard de Wagner sur notre civilisation: plus d’un siècle après sa genèse, Le Ring saisit toujours par la vérité de ce qu’il dénonce. Jamais les tractations, le pouvoir, l’or n’ont à ce point dévier les hommes de leur salut. Wagner parle de notre perte… Et ce Crépuscule des dieux désigne très précisément la fin de nos sociétés.
Enchantement symphonique
Par contre si son sujet est sombre voir lugubre, le compositeur déploie un orchestre flamboyant dont le chef Philippe Jordan ouvrage la parure instrumentale avec un style qui se révèle… irrésistible. L’accomplissement de ce Ring parisien demeure orchestral: en remarquable symphoniste, le maestro entretient un somptueux équilibre fosse-plateau, ne couvrant jamais les voix. C’est un travail sur des tempos retenus, souvent suspendus qui plongent dans la psyché de chacun; la sonorité est d’une opulence délectable; les percussions et les cuivres atteignant des sommets de rondeur et d’intensité. Philippe Jordan n’est pas un Wagnérien révélé (comme on peut le lire ici et là: il n’en est pas à sa première Tétralogie, loin de là), s’agissant de sa baguette fine, transparente, racée, l’on devrait plutôt parler d’un wagnérien confirmé.
Comme pour les volets précédents, le niveau vocal général est plus que bon, et même surclassant les derniers Bayreuth. Palmes spéciales au Hagen qui domine largement le plateau; Siegfried sans grand panache particulier de Torsten Kerl; Brunehilde engorgée et aux aigus souvent tirés de Birgitt Pieler (remplaçant au pied levé Katarina Dalayman portée pâle) … abaissent légèrement la moyenne. Heureusement, le Günther de Ian Petersson et la Waltraute de Sophie Koch , qui restera mémorable, Walkyrie impuissante et implorante… suppliant sa soeur de rendre l’anneau, pour l’amour de leur père… un Wotan détruit par ce qu’il a lui-même semé-, sont les autres piliers du spectacle.
Il faut absolument aller voir et écouter ce Ring de Bastille: fosse électrisante et aboutie, chanteurs globalement convaincants, mise en scène décapante sans effets décoratifs.
Richard Wagner: Le Crépuscule des dieux, Götterdämmerung. Torsten Kerl : Siegfried. Iain Paterson : Gunther. Peter Sidhom Alberich. Hans-Peter König: Hagen. Brünnhilde. Christiane Libor : Gutrune, Troisième Norne. Sophie Koch : Waltraute. Nicole Piccolomini: Première Norne, Flosshilde. Caroline Stein Woglinde. Daniela Sindram: Wellgunde. Orchestre et Choeur de l’Opéra national de Paris.
Diffusion sur France Musique, le 18 juin 2011 à 18h
Encore 4 dates à l’affiche de l’Opéra Bastille pour voir et applaudir Le Crépuscule des Dieux de Wagner (Götterdämmerung): les 18, 22, 26 (14h) puis 30 juin 2011. Attention séance à 18h.