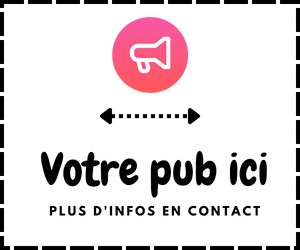Un des piliers du Mur d’Orange : la Tosca est revisitée dans un esprit
de classicisme inventif. Le travail d’orchestre, superbement conduit par
Mikko Franck, est très inventif et rend justice à des aspects souvent
occultés de l’écriture puccinienne. La mise en scène de Nadine Duffaut,
discrètement modernisée, rend très lisible la dramaturgie. Catherine
Naglestad est une Tosca subtile, Falk Struckmann un puissant et
inquiétant Scarpia, Roberto Alagna un Mario éloquent. Les seconds rôles
ne déçoivent en rien.
Qu’est-ce qui, dans Tosca, résume la splendeur d’un genre ? En altitude
vériste, le spectateur est entraîné vers une histoire de folle passion,
et aussi – surtout ? – vers la folie de l’Histoire, son exemplarité,
en quelque sorte. Selon la catharsis d’Aristote, à qui nous identifier
pour purger les passions ? Là où s’échappe, du moins au début, l’unité
d’un personnage, c’est avec la cantatrice qui s’égare dans sa jalousie
compulsionnelle, avant de « mériter » sa rédemption dans les choix de
l’héroïsme. Ailleurs règne la pureté du Bien : Mario Cavaradossi,
peintre épris de liberté autant que de la beauté des femmes et de l’art,
saura donner, à travers la torture, toute sa vie pour l’idéal. Ou celle
du Mal : Scarpia, Premier Flic de Rome, ajoutant à son sadisme de
serviteur du totalitarisme la stratégie perverse qui lui permettrait de
rafler la mise sexuelle. Quand Puccini, au tout début du XXe, aborde
le sujet que Sardou venait de porter au théâtre, il se tient sur la voie
de crête entre la continuation du baroque qui est celle du
post-romantisme italien – montrer la violence des événements et les
êtres aux prises avec l’agitation, parfois insensée, du monde – et une
volonté de l’inscrire dans un cadre quasi-rigoureux, qui sacrifie à une
règle adaptée des trois unités de temps, de lieu et d’action. Les
quelques heures sont là ; l’action se tend vers son accomplissement
furieux ; les lieux se resserrent entre ce que les surréalistes
voyaient réuni de plus haïssable : une église, un palais qui abrite des
fêtes et les « bureaux » de la police, un terrain vague pour
exécutions derrière les casernes et la prison…
Aujourd’hui, la tragédie c’est la politique
 Ce qui fait de Puccini un Maître du Temps, ce n’est évidemment pas son
Ce qui fait de Puccini un Maître du Temps, ce n’est évidemment pas son
intuition métaphysique, telle que lui assignerait pourtant une
situation au bout de la chaîne post-romantique. Non théoricien de l’art,
et au contraire merveilleux praticien : le naturalisme vériste lui
apporte sa charge de lien avec l’histoire – sociale, dans la plupart des
cas italiens, et ici, politique : « rétroactivée » d’un siècle, la
Rome pontificale, monarchique et policière -, et s’y ennoblit de
l’aphorisme napoléonien rapporté par Goethe : « Aujourd’hui, la
tragédie c’est la politique ». Par delà les Alpes, on songe aussi à la
vision hugolienne, celle des Misérables. Puccini façonne ce Temps
renouvelé de ses fulgurances, de ses gestes nerveux et parfois
brutaux, de ses soudains relâchements de tension aussi. Bien sûr, on ne
peut oublier – en ces deux heures et demie de récit haletant et
pourtant envahi d’éclaircies lyriques – que l’histoire des arts voit
alors éclore son Septième, ce cinéma qui devra attendre encore quelques
décennies pour montrer en pleine lumière la force, la rapidité de
succession et d’enchaînement, et même la possible réversibilité de ces
images, enfin mises en mouvement dans le torrent de l’histoire. Il
reviendra « bientôt » à un Italien génial, fou d’opéra, Lucchino
Visconti, d’accomplir la fusion du sublime des passions amoureuses et de
la foi en une idéologie qui devrait les dépasser, ainsi sera Senso,
« prolongé » par Les Damnés selon la symbolique d’une Famille en proie
au nazisme…
Le souffle brûlant des versions historiques
Ici donc la tâche musicienne et gestuelle n’est pas aisée, d’autant
que la mémoire auditive est « envahie » par l’interprétation légendaire
de Callas, accompagnée de Tito Gobbi et Giuseppe di Stefano, au début
des années 50. Les enregistrements montrent que le chef Victor de
Sabata y mena cette vision historique d’un seul souffle brûlant, d’une
ardeur qui exaltait ses interprètes. Mais le lieu très particulier du
Grand Mur d’Orange, en sa grandeur verticalisée, avec ses contraintes –
l’espace en glissière sans profondeur –n’est guère « facile ». On peut
lui inventer un « cache » visuel : ce sera l’immense tableau, laid
naufragé de guingois, où une Marie-Madeleine post-baroque, berninienne
et pseudo-caravagesque hume son flacon d’Oréal, « les deux yeux
révulsés, et les mains en avant pour tâter le décor d’ailleurs… (trop)
existant », pour paraphraser Queneau. La mise en abîme sera le petit
tableau sur chevalet devant le peintre qui d’ailleurs ne s’en servira
guère. Une porte sur la gauche permettra de «communiquer » avec la
salle d’interrogatoire, et un dispositif technologique (répété à droite
pour l’écriture de la lettre en prison) donnera selon le principe de la
glace sans tain, dont les séries policières de Télé sont fortes
consommatrices, la sensation « d’y être ». Cela servira aussi pour un
flash très impressionnant, la projection de l’ombre maléfique de
Scarpia… Le 1er acte en son début distribue paradoxalement les cartes :
l’orchestre particularise les sonorités, affine les timbres,
« dédramatise ». On s’apercevra rapidement que le travail de Mikko
Frank dirigeant le Philharmonique de Radio-France est très concerté,
mettant en évidence l’écriture puccinienne dans sa modernité, quelque
chose qui parfois évoque Debussy, et avant la lettre, une mélodie de
timbres…Ce qui n’empêchera pas, plus loin, d’intégrer l’impressionnante
et violente dramaturgie d’accords et de motifs qui transforme et allège
le principe wagnérien pour singulariser les personnages et symboliser
les principes en action. En tout cas, cette entrée en matière de l’opéra
souffre, et dans la mise en scène, et dans l’apparence première de
l’interprétation musicale, de minimisation. L’arrivée de l’évadé
Angelotti, banale, puis la longue scène d’amour jaloux entre Mario et
Tosca manquent de ce caractère d’attente indispensable au surgissement
du tragique. Roberto Alagna, Mario,… fait de l’Alagna, sans effort,
vocalement excellent, scéniquement attendu, et Catherine Naglestad,
Tosca, y est presque en retrait, sans que forcément le public
« orangiste », ordinairement attaché aux effets immédiats de la «
bravitude » vocale, se rende compte que pour la soprano américaine, il
s’agit d’un principe d’intériorisation.
Poétique Vissi d’arte
 Cela se modifiera dès l’arrivée, très impressionnante, d’un Scarpia –
Cela se modifiera dès l’arrivée, très impressionnante, d’un Scarpia –
Falk Struckmann, saisissant – d’abord mussolinien, et dont la noirceur à
tous les sens du terme sera d’autant plus inquiétante que la voix,
profonde et capable de fureur foudroyante, garde quand il le faut
une réserve qui sait se faire douceur caressante et insinuante d’une
rare subtilité : une belle place réservée dans quelque Histoire de
l’Infamie ! La mise en scène de Nadine Duffaut semble alors y trouver
sa justesse efficace, et les face à face du bourreau cynique, de la
victime héroïque et de l’amoureuse prise au piège y prendront toute la
grandeur nécessaire. N.Duffaut n’a pas tort de tout transposer dans
l’avancée du XXe, ce siècle si fertile en sinistres inventions
liberticides et négatrices de la dignité humaine. Les « chemises
noires » sont remplacées par des complets-cravates, Scarpia fait
d’ailleurs moins penser au Duce, « César de carnaval » (comme disait
Paul-Boncour), qu’à un patron d’une gestapo à manteaux et chapeaux
bien reconnaissables, microcosme de sbires où s’illustre le sinistre
Spoletta de Christophe Mortagne, liquidation du condamné au revolver et
non par peloton d’exécution. Scarpia, tortionnaire signant la
paperasse de proscription à sa longue table de bureaucrate de la
terreur, finira, étalé sur son canapé, par applaudir une Tosca qui
vient de se réfugier en son havre de grâce du Vissi d’arte…Et alors,
Catherine Naglestad arrive au sommet de son art, poétiquement abandonnée dans
l’enclave de sa nostalgie d’un monde impossible. L’orchestre de Mikko
Frank, auparavant et ensuite en ivresse de la fureur, y retrouve une
analogue beauté douce qui fait frémir en image sonore du paradis perdu.
Ainsi cette « étrangeté » d’une insertion de lyrisme dans une action
convulsée prend-elle toute sa charge de beauté nécessaire, et au lieu
de nous apparaître en « air à ne pas manquer », rejaillit-elle comme une
prière de la beauté sur un monde sans pitié.
La liberté parle et chante
 Ce recentrage sur la solitude des personnages est évidemment au risque
Ce recentrage sur la solitude des personnages est évidemment au risque
d’une coupure avec « l’opinion dominante », qui cherche en de semblables
œuvres une exemplarité vocale encore plus que musicienne en profondeur.
Tant pis, tant mieux, d’autant qu’une part indiscutable de
l’interprétation va dans le sens de ce qui est attendu par le public :
le charme puis la vigueur d’un Mario porté sans faiblir par un Roberto
Alagna… que l’on préfèrerait par moments moins « vaillant ». Et que les
« seconds rôles » sont dessinés de façon très convaincante, notamment
le sacristain cagot et pleutre de Michel Trempont. Plus que les
mouvements de foule orante et mondaine, classiquement ordonnés en
va-et-vient horizontal (4 excellents ensembles choraux, dont la
Maîtrise des Bouches-du-Rhône), nous intéressent aussi des idées de
pause lyrique, tel le jeune berger de blanc vêtu qui va boire au
puits… En somme, en cette Tosca de haute qualité musicienne,
n’importe-t-il pas aussi que le mélomane, fût-il d’abord et avant tout
venu pour concélébrer la messe lyrique, soit amené à « penser cette
musique d’hier proche d’aujourd’hui », et à méditer, au-delà de ses
légitimes enthousiasmes, sur les interrogations que porte, aujourd’hui
et plus que jamais, cet opéra d’action intense ? Et, au-delà du
spectacle vocal, en se recentrant sur le huis-clos de terribles
affrontements individuels, à percevoir mieux encore tout ce qui nous
parle et chante les libertés, face à toutes les oppressions ?
Puccini (1858-1924): Tosca. Orchestre Philharmonique de
Radio-France, Chœurs des Opéras d’Avignon et Toulon, du Capitole de
Toulouse, Maîtrise des Bouches du Rhône, Ensemble instrumental des
Chorégies. Direction: Mikko Franck. Catherine Naglestad, Falk Struckmann,
Roberto Alagna, Michel Trempont, Christophe Mortagne. Mise en scène:
Nadine Duffaut.