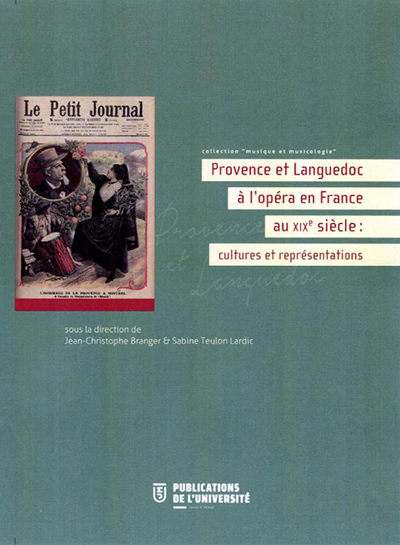 Livre, compte rendu critique. PROVENCE ET LANGUEDOC A L’OPERA EN FRANCE AU XIXème SIECLE (Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2017). Comme il est détaché, distingué, mis en exergue, « Méridionaux. tous Poètes », selon la formule positive de Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues. C’est un donc un préjugé qui argumente opportunément le sujet de ce livre à l’ancrage aussi original que passionnant. Les œuvres qui mettent scène la Provence rayonnent ici d’un intérêt particulier. Prolongement d’un colloque qui s’est déroulé le 20 décembre 2014 à Nîmes, le cycle de textes et interventions rassemblés ici témoignent d’un corpus indiscutable qui atteste d’une certaine vision de la culture provençale à l’opéra, en particulier dans le « grand XIXè », soit du Second Empire à la Première Guerre mondial. Evidemment Mireille de Gounod et Mistral (1864) incarne un premier sommet de ce goût pour le folklore régional. D’autant plus exacerbé et cultivé, porté par le Félibrige, et d’autres courants intellectuels et culturels, en réaction contre le wagnérisme ambiant, conquérant, inévitable. Quand Saint-Saëns cherche et trouve (cf son Concerto pour piano), une nouvelle inspiration, étrangère à tout germanisme vénéneux, en Algérie, Egypte et dans ce proche Orient africain qu’avant lui, le peintre Delacroix a su peindre et célébré, les compositeurs français romantiques s’intéressent aux particularités territoriales, le folklore livrant une nouvelle source dépaysante. Le populaire et le traditionnel fécondent la musique savante. Avec la création de la société nationale de musique (en 1871, c’est à dire comme une réponse culturelle de la France politiquement vaincue par la Prusse), il s’agit à présent de célébrer les joyaux du patrimoine français, en particulier méridional. Ainsi serait exaucer Nietzsche aussi dont la formule de 1888, « il faut méditerranéiser la musique », prenait prétexte de Carmen de Bizet (1875) pour appuyer son nouveau positionnement antiwagnérien.
Livre, compte rendu critique. PROVENCE ET LANGUEDOC A L’OPERA EN FRANCE AU XIXème SIECLE (Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2017). Comme il est détaché, distingué, mis en exergue, « Méridionaux. tous Poètes », selon la formule positive de Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues. C’est un donc un préjugé qui argumente opportunément le sujet de ce livre à l’ancrage aussi original que passionnant. Les œuvres qui mettent scène la Provence rayonnent ici d’un intérêt particulier. Prolongement d’un colloque qui s’est déroulé le 20 décembre 2014 à Nîmes, le cycle de textes et interventions rassemblés ici témoignent d’un corpus indiscutable qui atteste d’une certaine vision de la culture provençale à l’opéra, en particulier dans le « grand XIXè », soit du Second Empire à la Première Guerre mondial. Evidemment Mireille de Gounod et Mistral (1864) incarne un premier sommet de ce goût pour le folklore régional. D’autant plus exacerbé et cultivé, porté par le Félibrige, et d’autres courants intellectuels et culturels, en réaction contre le wagnérisme ambiant, conquérant, inévitable. Quand Saint-Saëns cherche et trouve (cf son Concerto pour piano), une nouvelle inspiration, étrangère à tout germanisme vénéneux, en Algérie, Egypte et dans ce proche Orient africain qu’avant lui, le peintre Delacroix a su peindre et célébré, les compositeurs français romantiques s’intéressent aux particularités territoriales, le folklore livrant une nouvelle source dépaysante. Le populaire et le traditionnel fécondent la musique savante. Avec la création de la société nationale de musique (en 1871, c’est à dire comme une réponse culturelle de la France politiquement vaincue par la Prusse), il s’agit à présent de célébrer les joyaux du patrimoine français, en particulier méridional. Ainsi serait exaucer Nietzsche aussi dont la formule de 1888, « il faut méditerranéiser la musique », prenait prétexte de Carmen de Bizet (1875) pour appuyer son nouveau positionnement antiwagnérien.
De Mireille de Gounod (1863) aux Barbares de Saint-Saëns (1901)
L’université de Saint-Etienne publie les actes du Colloque de 2014 soulignant PROVENCE ET LANGUEDOC à l’opéra en France au XIXè
comme sources d’une importante régénération du genre
Les Méridionaux à l’opéra
Ainsi dans le sillon de la pensée nietzschéenne, si musicale, – le poète « trahi » par Wagner ne se disait-il pas compositeur autant que philosophe ?- Gounod donc, puis Ravel, Chabrier, Debussy se passionnent chacun à leur tour pour les couleurs et les rythmes du midi, ligure, provençal, ibérique.
C’est aussi une célébration des hauts lieux lyriques en Provence, où l’opéra s’affirme comme le genre idoine : Mireille donc dans les Arênes de Nîmes, puis Les Barbares de Saint-Saëns (1901) qui entend affirmer le théâtre antique d’Orange comme une nouvelle scène opératique majeure (malgré les critiques du compositeur sur la réalité des conditions de représentation). En définitive, l’opéra sera créé à Paris.
Les textes attestent d’une longue tradition provençale à l’opéra qui remonte aux Lumières et s’affirme tout au long du XIXè : depuis les Feste de Thalie de Mouret (1720), et les tambourins de Rameau (Indes Galantes, 1735), à Daphnis et Alcimadure, pastorale en languedocien de Mondonville (1754), puis Aline de Berton (1803), Le Roi René d’Hérold (1824), … Simultanément, l’histoire géopolitique a déplacé le centre d’intérêt vers le monde méditerranéen, depuis la Campagne d’Egypte de Bonaparte (1799), avec la prise d’Alger (1830) ; l’identité méditerranéenne se précise au fil des ouvrages musicaux et lyriques au cours du XIXè. Elle se manifeste par des marqueurs emblématiques, liés à l’esprit et à la vie du lieu rural ou maritime, afin de faire « primitif voire paysan ».
Outre l’image de la Méditerranée sur la scène lyrique (à Paris majoritairement), le livre explore aussi l’activité des foyers de créations en Provence, phénomène lié à l’enracinement personnel d’un compositeur sur le territoire, ou la commande d’un théâtre ou d’un site à un auteur. Ainsi : Pétrarque de Duprat (1873) créé à l’Opéra de Marseille, comme Naïs Micoulin de Bruneau (1907) créé à Monte Carlo ; Héliogabale de Séverac (1910) créé à Béziers ; enfin, le volet le plus intéressant concerne la genèse puis les conditions de création des Barbares (apothéose à peine masquée de la civilisation gallo-romaine), nouvelle tragédie de Saint-Saëns, conçue pour Orange en 1901, car l’action s’y déroule, en 105 avant JC. Mais créé in fine à l’Opéra de Paris : Le 10è ouvrage lyrique de Saint-Saëns narre l’amour de la Vestale romaine Floria pour le germain barbare Marcomir et la tragédie qui les accable : Livie, autre vestale amie de Floria poignarde le barbare car il a tué jadis son père. Dans le contexte géopolitique de Saint-Saëns, Livie tuant Marcomir, c’est la France qui se venge indirectement de l’envahisseur germanique…
Pour autant, il ne suffit pas d’intégrer d’authentiques danses folkoriques provençales pour réussir un opéra provençal ; et même si elles sont conçues, les danses peuvent être sine die interdites pour cause de régionalisme indigne sur la scène parisienne, comme en fait l’expérience Séverac qui avait présenté la partition intégrale du Cœur du moulin à l’Opéra-Comique en 1910 : le directeur du théâtre parisien refusa net les danses du chevalet et des treilles.
L’intérêt majeur de ce corpus, aux regards spécialisés, et aux textes complémentaires est de questionner les sources d’inspiration du grand genre lyrique.
_____________
 Livre, compte rendu critique. PROVENCE ET LANGUEDOC A L’OPERA EN FRANCE AU XIXème SIECLE : CULTURES ET REPRESENTATIONS. Ouvrage collectif, sous la direction de Jean-Christophe Branger et Sabine Teulon Lardic. Publications de l’Université de Saint-Etienne, parution en juin 2017. CLIC de CLASSIQUENEWS. ISBN 978 2 86272 693 9.
Livre, compte rendu critique. PROVENCE ET LANGUEDOC A L’OPERA EN FRANCE AU XIXème SIECLE : CULTURES ET REPRESENTATIONS. Ouvrage collectif, sous la direction de Jean-Christophe Branger et Sabine Teulon Lardic. Publications de l’Université de Saint-Etienne, parution en juin 2017. CLIC de CLASSIQUENEWS. ISBN 978 2 86272 693 9.



