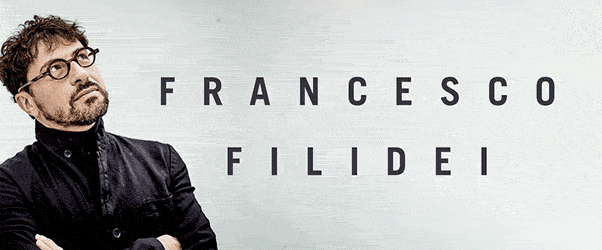LIVRES, compte rendu critique. Camille Saint-Saëns et Jacques Rouché : correspondance de 1913 à 1921. Actes Sud enrichit sa collection dédiée aux témoignages et correspondances d’un romantisme tardif, déjà ébloui par l’impressionnisme de Debussy, et la syncope frénétique d’un Stravinsky (qu’en bon père conservateur St-Saëns détestait en le faisant savoir). Les deux hommes de lettres : Rouché / Saint-Saëns qui échangent, croisent idées et projets, sont chacun dans une période très active de leur existence. Le Quinqua Jacques Rouché (1862-1957) est le récent directeur de l’Opéra de Paris ; il s’adresse ici à un Saint-Saëns, vieux (presque octogénaire) maître des excellences romantiques, doué d’une invention et d’un classicisme « moderne » qui n’a plus rien à prouver. Face au germanisme wagnérien croissant (lui qui fut néanmoins un adepte de Bayreuth dès les premières heures du Festival allemand), Saint-Saëns se dresse en défenseur de l’art musical français. En esprit curieux et fédérateur, Rouché accepte de (re)créer nombre d’ouvrages de Saint-Saëns sur la scène de l’opéra de Paris qui ne compte alors que Samson et Dalila : ainsi grâce au jeune directeur, sont montés : Les Barbares (1914), Etienne Marcel (extraits en 1915 et 1916), Henry VIII (1917), Hélène (1919), Ascanio (1921)… autant d’ouvrages qui suscitent évidemment de constantes coopérations, où le cher monsieur de 1013 est devenu « mon cher directeur », Saint-Saëns signant en « votre affectionné ». Dans les coulisses et les préalables à chaque production nouvelle, le compositeur se montre exigeant, partisan, préférant tel chanteur, et telle cantatrice ; fustigeant celui qui ne sait articuler et rendre intelligible la langue de Corneille et de Molière (un défaut encore tenace aujourd’hui). Il regrette ainsi que par la faute de chanteurs hauts parleurs, le français de Meyerbeer par exemple et toute sa musique si équlibrée et subtile, s’en trouvent dénaturés. Saint-Saëns bataille, intrigue (j’irai vous retrouver dans votre loge à l’Opéra pour en discuter), faisant ainsi salon pendant les représentations… Toujours égratigné par ses critiques partisans (dont Emile Villermoz, explicitement debussyste), Saint-Saëns défait sa réputation d’auteur froid et austère (mon grand duo du II, ou le quatuor, le grand air de Catherine comme celui d’Henry VIII en témoignent). Il proclame aussi au détour d’une phrase ses préférences et ses goûts (Sylvia plutôt que Coppelia). Voilà qui dévoile aussi au regard des titres des partitions concernées que Saint-Saëns au même titre que Massenet ou Puccini, dédia un bon nombre de son écriture à des héroïnes hautement caractérisées, en portraits dont il s’enorgueillit sans limites : Phryné, Proserpine, Javotte, la Princesse jaune, et surtout Hélène. Les lettres sont souvent factuelles, courtes, voire anecdotiques.Pas d’explications révélant l’explicitation d’une conception esthétique d’envergure, mais dans le rythme des missives techniques, l’idée de chantiers en cours ; des tracasseries en séries, où l’art se confronte à la réalité humaine des interprètes…
LIVRES, compte rendu critique. Camille Saint-Saëns et Jacques Rouché : correspondance de 1913 à 1921. Actes Sud enrichit sa collection dédiée aux témoignages et correspondances d’un romantisme tardif, déjà ébloui par l’impressionnisme de Debussy, et la syncope frénétique d’un Stravinsky (qu’en bon père conservateur St-Saëns détestait en le faisant savoir). Les deux hommes de lettres : Rouché / Saint-Saëns qui échangent, croisent idées et projets, sont chacun dans une période très active de leur existence. Le Quinqua Jacques Rouché (1862-1957) est le récent directeur de l’Opéra de Paris ; il s’adresse ici à un Saint-Saëns, vieux (presque octogénaire) maître des excellences romantiques, doué d’une invention et d’un classicisme « moderne » qui n’a plus rien à prouver. Face au germanisme wagnérien croissant (lui qui fut néanmoins un adepte de Bayreuth dès les premières heures du Festival allemand), Saint-Saëns se dresse en défenseur de l’art musical français. En esprit curieux et fédérateur, Rouché accepte de (re)créer nombre d’ouvrages de Saint-Saëns sur la scène de l’opéra de Paris qui ne compte alors que Samson et Dalila : ainsi grâce au jeune directeur, sont montés : Les Barbares (1914), Etienne Marcel (extraits en 1915 et 1916), Henry VIII (1917), Hélène (1919), Ascanio (1921)… autant d’ouvrages qui suscitent évidemment de constantes coopérations, où le cher monsieur de 1013 est devenu « mon cher directeur », Saint-Saëns signant en « votre affectionné ». Dans les coulisses et les préalables à chaque production nouvelle, le compositeur se montre exigeant, partisan, préférant tel chanteur, et telle cantatrice ; fustigeant celui qui ne sait articuler et rendre intelligible la langue de Corneille et de Molière (un défaut encore tenace aujourd’hui). Il regrette ainsi que par la faute de chanteurs hauts parleurs, le français de Meyerbeer par exemple et toute sa musique si équlibrée et subtile, s’en trouvent dénaturés. Saint-Saëns bataille, intrigue (j’irai vous retrouver dans votre loge à l’Opéra pour en discuter), faisant ainsi salon pendant les représentations… Toujours égratigné par ses critiques partisans (dont Emile Villermoz, explicitement debussyste), Saint-Saëns défait sa réputation d’auteur froid et austère (mon grand duo du II, ou le quatuor, le grand air de Catherine comme celui d’Henry VIII en témoignent). Il proclame aussi au détour d’une phrase ses préférences et ses goûts (Sylvia plutôt que Coppelia). Voilà qui dévoile aussi au regard des titres des partitions concernées que Saint-Saëns au même titre que Massenet ou Puccini, dédia un bon nombre de son écriture à des héroïnes hautement caractérisées, en portraits dont il s’enorgueillit sans limites : Phryné, Proserpine, Javotte, la Princesse jaune, et surtout Hélène. Les lettres sont souvent factuelles, courtes, voire anecdotiques.Pas d’explications révélant l’explicitation d’une conception esthétique d’envergure, mais dans le rythme des missives techniques, l’idée de chantiers en cours ; des tracasseries en séries, où l’art se confronte à la réalité humaine des interprètes…
 Saluons le travail documentaire, d’analyse et d’information de l’auteure qui annote et commente avec générosité chaque citation d’oeuvre, chaque nom d’artistes et interprètes invités, auditionnés et parfois célébrés par l’un ou l’autre, Jacques ou Camille. L’accompagnement critique de ces 161 lettres en éclaire toutes les résonances historiques et esthétiques. L’éditeur ajoute en complément (« Annexe 2 »), les notices des 5 ouvrages majeurs remontés à l’Opéra de Paris grâce à Rouché, ainsi nourrissant le goût de la IIIè République, éclectique, et très néo : Samson et Dalila, Ascanio, Hélène, Henry VIII, et le ballet Javotte… Vivant, documenté, révélateur. CLIC de CLASSIQUENEWS d’avril 2017.
Saluons le travail documentaire, d’analyse et d’information de l’auteure qui annote et commente avec générosité chaque citation d’oeuvre, chaque nom d’artistes et interprètes invités, auditionnés et parfois célébrés par l’un ou l’autre, Jacques ou Camille. L’accompagnement critique de ces 161 lettres en éclaire toutes les résonances historiques et esthétiques. L’éditeur ajoute en complément (« Annexe 2 »), les notices des 5 ouvrages majeurs remontés à l’Opéra de Paris grâce à Rouché, ainsi nourrissant le goût de la IIIè République, éclectique, et très néo : Samson et Dalila, Ascanio, Hélène, Henry VIII, et le ballet Javotte… Vivant, documenté, révélateur. CLIC de CLASSIQUENEWS d’avril 2017.
____________________
 LIVRES, compte rendu critique. Camille Saint-Saëns et Jacques Rouché : correspondance de 1913 à 1921, par Marie-Gabrielle Soret (Actes Sud avec le P. Bru Zane). 240 pages — ISBN 978 2 330 06581 2. CLIC de CLASSIQUENEWS d’avril 2017.
LIVRES, compte rendu critique. Camille Saint-Saëns et Jacques Rouché : correspondance de 1913 à 1921, par Marie-Gabrielle Soret (Actes Sud avec le P. Bru Zane). 240 pages — ISBN 978 2 330 06581 2. CLIC de CLASSIQUENEWS d’avril 2017.