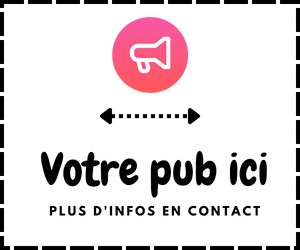La mise en scène originale et inhabituelle imaginée par Francisco Negrin est-elle pour quelque chose dans cette atmosphère lourde qui règne jusque dans la salle ?
Puritains bien sages
Car le scénographe mexicain a réussi à éviter l’écueil des clichés romantiques qui peuplent le livret et sa dramaturgie décousue. Dans sa vision, l’action se déroule au sein d’une forteresse, où vit reclus, et depuis longtemps, affamé et épuisé par la guerre, le clan des Puritains, d’une autorité et d’une rigueur brutales, tenu d’une main de fer par Giorgio Walton. Elvira vit ainsi cloitrée entre ces murs métalliques interminables, enfermée dans un mutisme qui confine à l’autisme, prête à chaque instant à basculer dans la folie, esprit fragile et malade. Peu de vraie lumière dans cette mise en scène, mais des éclairages crus et sinistres, peu de joie, et une impression constante d’oppression presque claustrophobe. Malgré un défilement inutile des pièces – sans fenêtre ni ouverture sur le monde extérieur – de la forteresse au début de l’œuvre, et des lettres en alphabet braille recouvrant les parois – censées représenter l’aveuglement des personnages – n’apportant rien, le cadre scénique et dramaturgique représenté ici change considérablement la couleur de la pièce, et donne à la musique une teinte différente, moins brillante, mais bien plus pesante. Pour accentuer encore cette impression de fatalité et de désespoir, la fin a été changée : plus d’amnistie pour Arturo, mais la mort, la fin joyeuse imaginée par Bellini devenant l’ultime délire d’une Elvira définitivement folle. Pour discutable qu’il est, ce choix fonctionne malgré tout remarquablement bien.
Vocalement, le bilan est plus contestable.
Chantant avec conviction, le chœur surprend par l’investissement de tous ses membres, chacun semblant habité par son rôle.
Aux côtés du Bruno Roberton efficace de Fabrice Farina, Isabelle Enriquez inquiète en Enrichetta, tant sa voix somptueuse semble prématurément vieillie, grossie et affligée d’un vibrato creusé. A corriger d’urgence avec une émission plus haute et davantage de finesse dans la pose des sons.
En Gualtiero soumis et faible, In-Sung Sim fait valoir sa superbe voix de basse, riche et noble, mais l’aigu sonne engorgé, ce qui se révèle dommageable pour un instrument de cette qualité.
En Giorgio Walton implacable et manipulateur, Lorenzo Regazzo semble fatigué, émission basse et vibrato ralenti, semblant chercher un legato qu’il ne parvient pas à trouver.
Belle surprise avec le Riccardo saisissant de Franco Vassallo. La voix est grande, le timbre somptueux, l’aigu sonne facile, ample et percutant. Pourtant, malgré toutes ces qualités de vaillance et d’éclat, il parvient à phraser superbement son « Ah, per sempre io ti perdei », jusqu’à des ornements parfaitement sur le souffle. Seule la place de la voix pourrait être revue à la hausse, et il est regrettable qu’il contrefasse si souvent son timbre noble et cuivré afin de sonner comme ce qu’on peut appeler un méchant d’opérette, ainsi de son jeu scénique, qui accumule les clichés et autres mimiques qu’on attribue à ce type de personnage.
Excellent rossinien, Alexey Kudrya affronte avec courage la tessiture meurtrière d’Arturo, mais force est de constater que la cantilène bellinienne le met moins en valeur. Ainsi, si toutes les notes sont là – jusqu’au contre-fa terrifiant de sa dernière scène –, elles semblent souvent atteintes avec effort et le legato n’est pas au rendez-vous, le chanteur paraissant audiblement fatigué et la voix portant peu. Son médium est pourtant superbe d’impact et de liberté, magnifiquement haut placé, et c’est rageant de l’entendre ainsi serrer la gorge et fermer l’espace arrière de la bouche au-delà du passage, privant l’aigu de rayonnement et de puissance, qui sonne alors moins que le reste de la voix. Pourtant, son engagement est louable, il se donne tout entier, et sa bravoure est à saluer.
Pour sa prise de rôle en Elvira, Diana Damrau était attendue, et c’est son nom qui attire principalement le public. Soyons francs, elle n’a pas déçu, mais sa prestation manquait ce soir de … démesure. Le timbre est toujours beau et pur, l’aigu et le suraigu faciles, l’agilité bien maîtrisée, mais c’est justement cet excès de maîtrise qui semble encore scolaire, manquant d’abandon et de liberté. En outre, l’étendue vocale d’Elvira la pousse dans ses retranchements, sollicitant un médium et un grave qu’elle ne possède pas encore entièrement, l’instrument demeurant d’un volume sonore modeste. Par ailleurs, l’esthétique de sa voix reste envers et contre tout d’école allemande, et l’italianité lui fait défaut, jusque dans la prononciation qui parfois brise la ligne à force d’accentuation des consonnes. En revanche, on ne peut que s’incliner devant une capacité inouïe à réaliser des diminuendi et pianissimi stupéfiants d’apesanteur, flottant sans effort, d’une texture sonore presque irréelle, grâce auxquels elle déroule un phrasé d’un legato parfait, tirant à merveille le souffle. Scéniquement, elle répond pleinement au projet du metteur en scène, perturbée, agitée, absente. Mais tant de mouvements et de gesticulations empêchent parfois l’énergie émotionnelle de se déployer pleinement, et c’est, dans sa scène de folie, lorsque, toute entière à ses sons filés, Diana Damrau cesse de bouger et se laisse porter par son propre chant, que la sensibilité exprimée par la musique prend son envol et que la magie opère enfin.
Une soirée inégale, loin du tourbillon virtuose auquel on s’attendait, mais réservant malgré tout quelques beaux moments.
Genève. Grand Théâtre, 4 février 2011. Vincenzo Bellini : I Puritani. Livret du Comte Carlo Pepoli. Avec Elvira : Diana Damrau ; Lord Arturo Talbot : Alexey Kudrya ; Sir Riccardo Forth : Franco Vassallo ; Sir Giorgio Walton : Lorenzo Regazzo ; Lord Gualtiero Walton : In-Sung Sim ; Sir Bruno Roberton : Fabrice Farina ; Enrichetta di Francia : Isabelle Henriquez. Chœur de l’Opéra de Genève. Orchestre de la Suisse Romande. Jesús López Cobos, direction musicale. Mise en scène : Francisco Negrin ; Décors : Es Devlin ; Costumes : Louis Désiré ; Lumières : Bruno Poet ; Direction des chœurs : Ching-Lien Wu