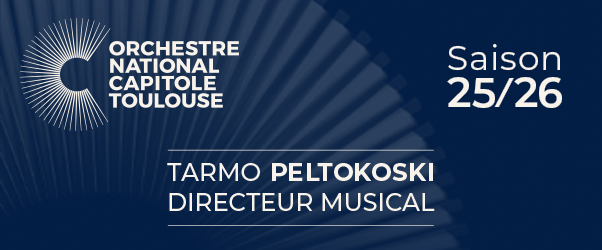L’Opéra de Rouen Normandie met à son affiche le chef d’œuvre de Francis Poulenc dans le cadre de sa saison 2024-2025, du 28 janvier au 4 février 2025, en coproduction avec l’Opéra national de Lorraine. Amateurs de belles histoires, passionnés d’intrigues amoureuses, de drames convenus ou de tragédie prévisible, passez votre chemin : Francis Poulenc nous conduit au plus près du destin de chacun d’entre nous, et comment l’assumer… Francis Poulenc (1899-1963) s’est emparé de cette œuvre, créée en 1957 à La Scala de Milan, qui reprend le récit de l’arrestation, la condamnation à mort et l’exécution, en 1794, des Carmélites de Compiègne, béatifiées par l’Église en 1906 et récemment canonisées (en 2024). Récit de ce drame à travers le parcours d’une jeune aristocrate, Blanche de la Force, depuis sa décision d’entrer chez les Carmélites jusqu’à sa mort et celle des Sœurs. Le compositeur de cet ouvrage, sans autre exemple dans la production lyrique, a tissé une musique puissante, tendue de bout en bout, qui sublime littéralement le texte de la pièce de théâtre de l’écrivain Georges Bernanos (1888-1948), elle-même inspirée d’une nouvelle de Gertrude von Le Fort (1876-1971). Une musique que le compositeur a souhaité, par sa dédicace, placer explicitement sous l’autorité esthétique de Debussy, Monteverdi, Verdi et Moussorgski.
Nous pouvons l’affirmer, la grande réussite de cette soirée – outre la grande forme de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et de son chef Ben Glassberg -, est la très belle mise en scène de Tiphaine Raffier. Le défi était d’importance pour cette jeune metteuse en scène dont c’était la première mise en scène de l’ouvrage, tous ayant en mémoire la mise en scène d’Olivier Py, référence s’il en est, de cette œuvre. Tiphaine Raffier (assistée pour la dramaturgie par Eddy Garaudel) a dépouillé l’ouvrage de toute référence explicite à la période révolutionnaire, à ses cocardes tricolores (mais des textes de discours, de lois, de cette époque troublée balisent visuellement la représentation), à son décorum fin XVIIIème siècle, et même à son contexte ecclésiastique, le tout réduit au minimum ; pari risqué, mais pari pleinement réussi : la dimension métaphysique de ce drame en sort renforcée, son interrogation philosophique acquiert une plus grande lisibilité, et ce qui est sans doute le plus important, et peut-être inattendu, le drame y gagne en émotion, tout au long de l’ouvrage, avec quelques intenses sommets, notamment lors de l’agonie de la Prieure, Madame de Croissy, magistralement incarnée par la mezzo-soprano Lucile Richardot. Si la fureur révolutionnaire est palpable dès la première scène de l’ouvrage, ce qui s’impose, c’est ce qui se résume dans l’expression choisie par la metteuse en scène dans sa note d’intention: apprendre à mourir…
Cette réussite doit aussi à l’équipe artistique : Scénographie (Hélène Jourdan), Costumes (Caroline Tavernier), Lumières (Kelig Le Bars) et Vidéo (Nicolas Morgan). Elle est aussi due, d’évidence, à un plateau de solistes dont la qualité première est l’homogénéité, à de rares exceptions près. Côté femmes, outre l’exceptionnelle Lucile Richardot, il convient de noter les très belles interventions tant scéniques que vocales de la jeune soprano Emy Gazeilles dans Sœur Constance, émouvante et parfois drôle dans sa candeur et sa simplicité, confidente privilégiée de Blanche, de la mezzo-soprano Eugénie Joneau dans Mère Marie et la soprano Aurélia Legay dans Mère Jeanne, toutes remarquables dans cette rude partition, d’une âpre modernité. Axelle Fanyo en Madame Lidoine, si elle est une solide chanteuse lyrique, délivre néanmoins un chant qui incline naturellement un peu trop vers un style belcantiste. La soprano Hélène Carpentier réussit sa prise de rôle de Blanche de la Force, le personnage central du drame : son chant est parfois vibré à l’excès et comporte des aigus un peu durs ; mais cela ne nous empêche pas d’être séduit par sa présence scénique, d’une grande réussite. Elle parvient à donner vie à Blanche, à son parcours de vie, ses doutes et sa peur, et à son parcours funeste.
Du côté des hommes, s’ils sont moins nombreux, leur présence dramaturgique n’en est pas moins essentielle ; de grande qualité vocale, le baryton-basse Jean-Fernand Setti dans le Marquis de la Force, père de l’héroïne, désemparé face à l’attitude de sa fille quand elle lui annonce sa décision d’entrer au Carmel. Le Chevalier de la Force est assumé vaillamment par le jeune ténor Julien Henric, tandis que François Rougier campe l’Aumônier du Carmel, prêtre tout à la fois paternel et terrorisé. A noter la belle présence du ténor Matthieu Justine dans le rôle du Premier commissaire, dont la voix a parfois du mal à s’imposer, notamment pendant les fortissimi de l’orchestre. Enfin, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, sous la baguette inspirée de Ben Glassberg, restitue puissamment la partition de Poulenc.
__________________________________________
CRITIQUE, opéra. ROUEN, Théâtre des Arts, le 30 janvier 2024. POULENC : Dialogues des carmélites. E. Gazeille, L. Richardot, E. Joneau… Tiphaine Raffier / Ben Glassberg. Toutes les photos © Caroline Doutre
VIDEO : Trailer de « Dialogues des carmélites » de Poulenc selon Tiphaine Raffier à l’Opéra Rouen Normandie