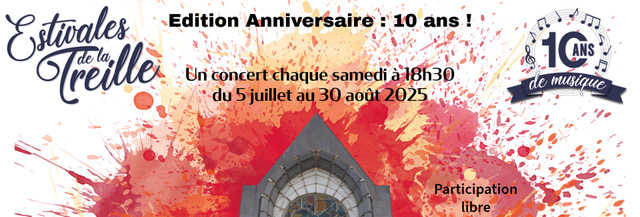Symphonie n°9 (1824)
Orchestre Symphonique d’Orélans
Jean-Marc Cochereau, direction
Fin de sasion 2009-2010 en apothéose romantique pour l’Orchestre Symphonique d’Orléans: les 11, 12 et 13 juin, le Théâtre d’Orléans accueille la phalange sous la direction de Jean-Marc Cochereau dans le dernier opus de Beethoven, la Symphonie n°9. C’est l’aboutissement d’un cycle de concerts mémorables dédiés aux symphonies du destin, les Symphonies n°9 signés par Schubert, Bruckner, Mahler… Beethoven conclue une programmation ambitieuse qui fait d’Orléans, une nouvelle capitale symphonique.
L’hymne du genre humain
L’idée d’un choeur concluant une symphonie était née dans l’esprit de
Beethoven dès la Sixième « Pastorale » (1807). De même, certains
motifs de
la Neuvième paraissent déjà dans la Fantaisie pour piano de
1808 qui
donne à cette date, une manière d’ébauche avant l’ample développement de
la dernière symphonie. Plus de dix ans s’écoulent entre la création de
la Neuvième et la Huitième : c’est donc un long processus de réflexion
et de maturation de projets et d’intentions anciens, qui permet la
réalisation de la Neuvième. La composition est achevée en février 1824.
Quelques mois plus tôt, Beethoven a terminé la Missa Solemnis
dont le
caractère général approche le dernier mouvement choral de la Neuvième.
La création, à Vienne, le 7 mai 1824, recueille un triomphe. La
partition autographe est dédiée au Roi de Prusse, Frédéric-Guillaume
III.
 C’est une
C’est une
œuvre monumentale en quatre mouvements, qui, dans le finale introduit
des sections chantées sur l’Ode à la Joie de Friedrich von Schiller.
Beethoven, dès sa jeunesse, avait un goût prononcé pour Goethe et
Schiller chez qui il puisa certains idéaux qui allaient jalonner son
oeuvre : la nature, l’amitié, la joie, l’exaltation fraternelle.
La 9ème Symphonie, en laquelle Wagner voyait « la dernière des
symphonies », marque un tournant décisif dans ce style musical et est
considérée comme un grand chef-d’œuvre du répertoire occidental. Outre
les développements thématiques impressionnants, et l’exploitation
méticuleuse de chaque motif, l’œuvre se caractérise par des changements
de tempi, de caractères, de mesures, d’armures et de modes jamais vus
jusqu’alors dans une symphonie, ce qui fit écrire à Berlioz : « Quoi
qu’il en soit, quand Beethoven, en terminant son œuvre, considéra les
majestueuses dimensions du monument
qu’il venait d’élever, il a dû se dire : “Vienne la mort maintenant, ma
tâche est accomplie”».
 Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans
Maitrîse des enfants du Conservatoire d’Orléans
Chef de Chœur: Elisabeth Renault
Solistes: Corinne Sertillanges, soprano. Hélène Obadia, mezzo soprano.
Jean-Françis Monvoisin, ténor. François Harismendy, basse.
Tous les concerts, les dates et les horaires sur le site de
l’Orchestre Symphonique d’Orléans (saison 2009 – 2010)
Les quatre mouvements
 1. Les douze
1. Les douze
premières mesures donnent la tonalité générale de l‘allegro ma
non
troppo, un poco maestoso : mystérieux et suspendu, le climat
initial
exprime l’aube d’une ère, nouvelle et brosse le tableau d’un
commencement du monde. Beethoven ne nous invite-il pas à l’écoute d’une
oeuvre qui présenterait une nouvelle genèse du genre humain? Volonté de
bannir les conflits vécus, désir de confier aux hommes, un message de
salut et de paix… Nous sommes ici aux prémices de l’intention.
2.
Molto vivace : il s’agit d’un scherzo
exceptionnellement long : là
encore, le sentiment profond, vaste, à l’échelle cosmique, d’une
réorganisation du monde se précise. Le souffle universel s’y consomme
sans limites : Beethoven exprime une conscience élargie à l’écoute de
l’histoire humaine.
3. Adagio : Après la motricité rythmique du
mouvement précédent, qui exprime l’action, le troisième mouvement rompt
violemment avec l’élan vital exprimé jusque là : Beethoven y étend
l’horizon d’une vaste méditation, profonde, grave et spirituelle sur le
devenir de l’homme.Ni défaitisme ni pessimisme mais lucidité sur
l’avenir du genre humain.
4. Après avoir atteint dans l’exaltation et
la médiation, les limites de la conscience, Beethoven engage un hymne
final marqué par la philosophie humaniste et l’espoir de l’Ode
à la joie
de Schiller, dont on sait qu’il souhaitait depuis très longtemps,
mettre en musique chaque vers.
Le mouvement débute dans un
cataclysme, un ouragan qui prélude à la reconstruction exprimée par le
chant du choeur et des solistes. C’est strophe après strophe,
l’exaltation du sentiment fraternel, réminiscence de l’esprit des
Lumières et des opéras de Mozart qui jaillit, irrépressible et
visionnaire : « millions d’être embrassez-vous… » (« Seid
umschlungen milionem… »).
Durée indicative
:
1h10 minutes dont plus de 20 minutes pour le dernier mouvement
avec choeur
Illustrations
Ludwig van Beethoven, Friedrich
Von Schiller, portrait
Dossier réalisé par Alexandre Pham et Adrien De Vries