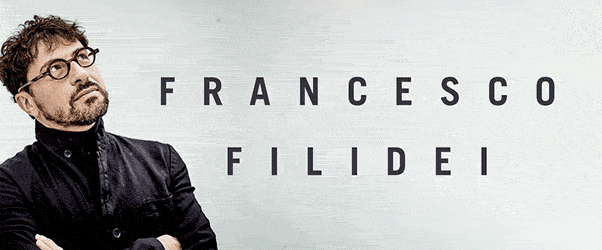Richard Wagner
Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, 1869

France Musique
Mercredi 20 août 2008 à 20h
Concert donné le 27 juillet 2008 au Festspielhaus de Bayreuth dans le cadre du festival de Bayreuth
L’objet du concours
Qui épousera la belle Eva, fille du riche orfèvre Veit Pogner? Walther qui en est amoureux devra bien se soumettre au concours de chant imposé par le père. Pour la Saint-Jean, au coeur de l’été, le vainqueur qui aura remporté l’épreuve convolera avec la jeune femme qui est en outre, un beau parti… David, l’apprenti du cordonnier-poète, Hans Sachs, explique à Walter les règles strictes de la confrèrie des Maîtres Chanteurs… Contre les manigances du greffier Beckmesser, lui aussi épris d’Eva, Walther remporte la palme gagnante grâce à l’aide du valeureux et loyal Hans Sachs, incarnation de l’art allemand.
De Sixtus Beckmesser à Hans Sachs
Après la création munichoise de l’opéra, le 21 juin 1869, Nietzsche s’élève contre ce manifeste de la fierté méprisante de la nation allemande qui étale sa culture autoproclamée, supérieure. Hans Sachs proclame en effet l’excellence et la permanence de l’art allemand, art saint qui se relèverait de toute chute de l’empire poltique, seul manifeste atemporel de l’identité germanique… Les critiques reconnaissent l’antisémitisme de Wagner dans la figure de Beckmesser, rival sournois et malheureux du pur et aryen Walther: comme Alberich dans Siegfried. un être de l’ombre, porté par l’envie et la jalousie, la rouerie, le calcul indirect. Quand au moment du concours, Beckmesser s’accompagne originellement d’un luth, l’instrumentiste (dans la fosse) chargé de jouer sa partie instrumentale, s’arrange pour sonner laid et écoeurant.
La réalité est plus prosaïque, et si Wagner règle ses comptes par personnage interposé, son Sixtus Beckmesser n’est que la caricature d’un journaliste honni, Eduard Hanslick (1825-1904). De son côté, Hans Sachs a bel et bien existé: à Nuremberg, cité de la réforme luthérienne, le poète cordonnier écrit pièces religieuses et plus de 3.000 poèmes. Dans son chant paternel pour Eva, amical et fraternel pour Walther, se précise la noblesse éternelle de l’art populaire allemand, juste, humble, philosophe.
L’opéra, art populaire
Wagner semble, en revisitant la légende médiévale, s’autoriser une pause: ni malédiction du héros, ni amour poison, ni impossibilité morale et personnelle… l’envoûtement mortifère de Tristan dont l’accord est cité dans le duo Hans Eva, est écarté au profit d’une fable légère, simple, d’essence populaire. Wagner n’en a pas pour autant abandonné ses convictions profondes: il laisse même en filigrane du « chromo Renaissance », un manifeste engagé pour l’art allemand. Hans Sachs est bien ce pilier et ce phare, détenteur de la tradition artisanale en laquelle fusionne les aspirations de l’art savant et la tradition populaire. Le collectif prime souvent sur l’individuel: dialogues chantés, ensembles et surtout choeur de la foule, dans chaque acte, omniprésent: tout indique chez le compositeur, une conscience aiguë de la nation, et du peuple allemand.
Distribution
Richard Wagner: Les Maîtres chanteurs de Nuremberg
Drame musical en trois actes sur un livret du compositeur
Franz Hawlata : Hans Sachs
Artur Korn : Veit Pogner
Charles Reid : Kunz Vogelgesang
Rainer Zaun : Konrad Nachtigall
Michael Volle : Sixtus Beckenmesser
Markus Eiche : Fritz Kothner
Edward Randall : Balthasar Zorn
Hans-Jurgen Lazar : Ulrich Eisslinger
Stefan Heibach : Augustin Moser
Martin Snell : Hermann Ortel
Andreas Macco : Hans Schwarz
Diogenes Randes : Hans Foltz
Klaus-Florian Vogt : Walther von Stolzing
Norbert Ernst : David
Amanda Mace : Eva
Carola Guber : Magdalene
Friedemann Röhlig : un veilleur de nuit
Choeur du Festival de Bayreuth
Direction : Eberhard Friedrich
Orchestre du Festival de Bayreuth
Sebastian Weigle, direction
 Notre avis: Cette production vaut toujours depuis sa création en juillet 2007, quelques huées bien cinglantes à l’adresse de la petite fille de Wolfgang Wagner, Katharina qui en signe la mise en scène, plutôt iconoclaste… L’anecdote ne serait guère plus illustrative qu’un fait divers mais la jeune femme candidate en lice pour reprendre la direction du Festival de la Colline Verte, suscite de vives réactions. Arrière petite fille de Richard, Katharina, 30 ans, y démontre avec un sens de la provocation, sa propre lecture de l’art, entre tradition et innovation. De l’action bavaroise du XVIème siècle, la jeune femme, réformatrice, imagine un Walter en peintre enragé et moderniste, et un Hans Sachs, écrivain sans le sou. Quant à Beckmesser, il s’agit d’un dadaïste sans style ni avenir, en particulier après la bastonnade qui conclue l’acte II. Le propos de Katharina s’appuie sur la critique de Wagner vis à vis de tout art académique, trop conservateur. Il s’agit le plus souvent d’un travail théâtral décapant, avec la volonté clairement assumée et explicite, de remettre en question le cadre scénique traditionnel, grâce à des trouvailles plus ou moins inspirées…
Notre avis: Cette production vaut toujours depuis sa création en juillet 2007, quelques huées bien cinglantes à l’adresse de la petite fille de Wolfgang Wagner, Katharina qui en signe la mise en scène, plutôt iconoclaste… L’anecdote ne serait guère plus illustrative qu’un fait divers mais la jeune femme candidate en lice pour reprendre la direction du Festival de la Colline Verte, suscite de vives réactions. Arrière petite fille de Richard, Katharina, 30 ans, y démontre avec un sens de la provocation, sa propre lecture de l’art, entre tradition et innovation. De l’action bavaroise du XVIème siècle, la jeune femme, réformatrice, imagine un Walter en peintre enragé et moderniste, et un Hans Sachs, écrivain sans le sou. Quant à Beckmesser, il s’agit d’un dadaïste sans style ni avenir, en particulier après la bastonnade qui conclue l’acte II. Le propos de Katharina s’appuie sur la critique de Wagner vis à vis de tout art académique, trop conservateur. Il s’agit le plus souvent d’un travail théâtral décapant, avec la volonté clairement assumée et explicite, de remettre en question le cadre scénique traditionnel, grâce à des trouvailles plus ou moins inspirées…
Côté chanteurs, l’idéal est presque atteint. Sous la direction très efficace de Sebastian Weigle, saluons la performance indiscutable du Walther de Klaus Florian Vogt, déjà Lohengrin subjugant, ici, héros chanteur à l’aigu souverain et hautement musical: le chanteur poursuit sa carrière au summum. A ses côtés, même palmes enthousiastes pour le Beckmesser du baryton Michael Volle. Le contraste des deux soupirants gagne ainsi en vérité. Déception en revanche pour Hans Sachs: Franz Hawlata est en méforme.
Le spectacle était en vision payante sur internet contre 49 euros (quand même). Il est vrai que pour s’offrir une place à Bayreuth, parmi les quelques 1.980 fauteuils tant convoités de par le monde, il faut toujours attendre a minima 9 ans pour espérer obtenir un siège. Mais sur la place des fêtes de Bayreuth, quelques 30.000 personnes ont pu suivre cette production sur une toile géante en simultané. Bel effet de démocratisation que n’aurait pas condamné Richard Wagner, militant avec force pour un opéra total pour le plus grand nombre…
Illustration: Albrecht Dürer, autoportrait vers 1498. Richard Wagner, portrait (DR)