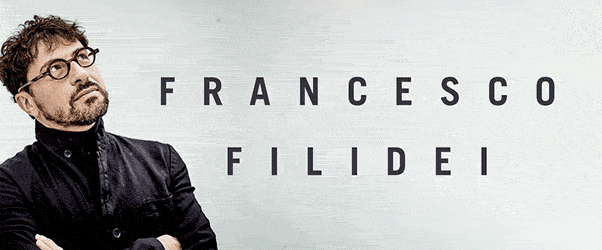compte rendu, critique, expositions par notre envoyé spécial Armand Quimper
Dès l’entrée de la très belle exposition «Tragédiennes de l’Opéra», présentée
jusqu’au 25 septembre 2011 à l’Opéra Garnier, une silhouette fantomatique vous
surprend et vous fait sursauter. La scénographie du manteau et coiffe portée par
Geneviève Vix dans le rôle de Salomé de Strauss donne une présence inquiétante à
cette relique. Confiné dans un recoin, un tulle noir opacifiant ses couleurs, le manteau
est posé sur un mannequin dont les formes se fondent totalement avec l’arrière-plan.
Le ton est donné et l’exposition tout entière joue avec les souvenirs et les traces de
ces femmes qui ont enflammé la scène de l’Opéra Garnier à la fin du XIXème siècle
et jusqu’aux années dix-neuf cent trente.
Entre présences et absence : A la recherche du temps perdu
Elles s’appelaient Rose Caron, Fanny Heldy, Rose Féart, Marcelle Demougeot,
mais aussi Germaine Lubin, Emma Calvé, Félia Litvinne et Mary Garden pour les
plus célèbres. Elles étaient applaudies, adorées, adulées même. Telles qu’elles
apparaissent aujourd’hui, elles sont les traces, ténues et pourtant tangibles, d’un passé
de l’art lyrique qui n’est plus mais qu’elles ont marqué chacune d’une manière ou
d’une autre. Les commissaires nous donnent à découvrir la figure de la tragédienne
dans un instant figé (nombreuses photographies), mais aussi à l’écouter à travers des
enregistrements (les premiers du genre), ou même à la voir évoluer grâce à quelques
archives filmées. La tragédienne de l’Opéra, à jamais disparue, réapparaît devant
nous, par petites touches fragmentées autour d’une série de présences. Elle se laisse
volontiers saisir et les costumes, accessoires et autres coiffes exposés donnent une
épaisseur, un poids, presque un corps à ces femmes à la silhouette floue.
«Dis-moi que je suis belle et que je serai belle, éternellement !»
Coincées entre deux siècles, elles incarnaient Charlotte, Carmen, Mignon,
Brünnhilde, mais aussi Salammbô, Thaïs, Salomé ou même Padmâvatî. Elles se
devaient de représenter les goûts exotiques d’une époque où l’orientalisme était une
esthétique. Elles portaient avec majesté les costumes dessinés pour elles par des noms
prestigieux comme Lacoste ou Bianchini, dont on peut contempler quelques croquis.
On les voulait grandioses, parées de dorures, sublimes, inhumaines peut-être.
Ce qui frappe, c’est l’effacement de la femme devant la tragédienne, la prédominance
du personnage sur la personne. Il ne s’agissait pas de photographier la cantatrice pour
elle-même, la notion «d’artiste lyrique» n’existant pas encore, mais pour le
personnage qu’elle incarnait, dont elle épousait l’apparence. La posture adoptée est
«inspirée des statues antiques et de la peinture néoclassique qui les avait elle-même
prise pour modèle» nous rappelle Rémy Campos dans son introduction du catalogue
de l’exposition (paru chez Albin Michel). Alors on erre avec plaisir dans cette galerie
de portraits qu’abrite le pavillon de l’empereur, on contemple, l’un après l’autre ces
visages aux regards égarés, volontiers fuyants qui semblent nous murmurer «Dis-moi
que je suis belle et que je serai belle, éternellement.» Elles étaient le reflet d’une
époque, nous sommes devenus le miroir de ces tragédiennes.
Commissaires de l’exposition : Mathias AUCLAIR, Christophe GHRISTI, Pierre VIDAL
Catalogue de l’exposition : Christophe GHRISTI, Mathias AUCLAIR, Rémy CAMPOS, Elizabeth
GIULIANI, José PONS, André TUBEUF, Pierre VIDAL, Les Tragédiennes de l’Opéra, Paris, Albin Michel,
2011. Compte rendu rédigé par notre envoyé spécial Armand Quimper
75009. Du 7 juin au 25 septembre 2011 de 10h30 à 16h30