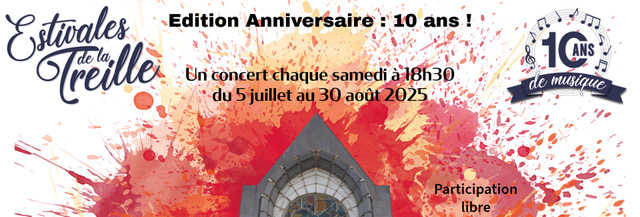Chaque récital de Grigory Sokolov est désormais un événement dans l’art de l’interprétation. Lors de sa 2de invitation lyonnaise par les Concerts des Grands Interprètes, le pianiste russe a choisi l’une des ultimes sonates de Schubert. Il a aussi, dressé un portrait passionnant de Scriabine, d’abord post-romantique puis moderniste absolu à la fin de sa vie. Notes pour jalonner le parcours d’une rigueur et d’une beauté sonores décisives.
Le pianiste qui ne sourit jamais
« Grigory, étonne-moi », auraient pu dire – comme à Cocteau, jadis – les amis d’un immense pianiste russe, alors si peu célèbre en France. Ce n’est plus de mise, désormais : Sokolov est respecté jusque dans son rituel. « Le pianiste qui ne sourit jamais » (du moins au public), entre, salue, se met au clavier, resalue, sort d’une même démarche solennelle mais comme absente. Non pas dédaigneux, mais concentré. La courtoisie, massive et raffinée tout ensemble, fait partie du don de son art. Et se lit aussi dans des programmes exigeants comme celui de Lyon, interrogateurs de deux musiciens inégalement aimés ou même connus, incandescents à presque un siècle de distance européenne, mais également épris d’un idéal de composition qui dépassait la seule écriture.
Les secrets des sonates ultimes
A son précédent récital lyonnais, G.Sokolov avait forcé les secrets de l’avant-dernière sonate de Schubert, D.959, celle-là totalement…schubertienne. Le voici dans la première de l’ultime trilogie (1828), D.958, dont on se contente souvent de dire qu’elle est hommage et adieu au Maître inapprochable, Beethoven, récemment disparu. Or, dès l’allegro initial, Sokolov, sans nier l’affrontement et l’abrupt en face du destin – qui sont essence constructrice de Beethoven -, instaure, après silence de recueillement, le chant très lent, presque murmuré d’un voyageur (wanderer) qui pénètre dans son passé. Dès lors, la tentation « sechterienne » de Schubert à l’été 1828 – le désir, empêché par la mort, de suivre l’enseignement du contrepoint auprès de Simon Sechter – se fond dans l’héroïque rigoureux de Beethoven. Et la passerelle d’un arpège viendra constamment rappeler que d’une rive à l’autre, le « peu profond ruisseau calomnié, la mort » (selon la poésie de Mallarmé) est franchissable, sans terreur ni colère. Car la rive d’essence proprement schubertienne, appartient à une vie plus rêvée, nocturne, feutrée. Cela permet le lien avec un adagio, d’énoncé calme et lent, avec un chant purifié de toute volonté de puissance, où même là, – un processus contrapuntique rigoureux – conduit et finit en pays de magie. Malgré une durée bien plus modeste que pour les deux autres sonates, on songe grâce au pianiste à d’autres mystérieux de la pensée russe, tel un Tarkovsky, explorateur par le film d’espaces-temps si graves, une fois passées les frontières de l’ordinaire. Et l’ascète du son qu’est Sokolov y fait sourdre une tendresse inattendue en son art si maître des émotions, si ennemi de tout pathos.
Scriabine et la monnaie de l’absolu
Puis c’est un parcours scriabinien, depuis l’encore-romantisme (Prélude et nocturne, 3e Sonate) jusqu’au finistère des pièces dernières (3 Poèmes, 10e Sonate). Presque sans s’accorder de repos, l’interprète habité par sa mission fait d’abord vivre les pièces des années 1890, en des explosions telluriques, des chants généreux, un « piano-espace » d’harmoniques : c’est comme une longue ouverture pour un opéra qui s’appellerait sobrement « 1913-1914 », et que seul, dans l’histoire musicale pouvait écrire Scriabine. A travers la magie du premier de ces Poèmes, on pourrait évoquer le debussysme, mais c’est ensuite vertige devant le décentrement de l’œuvre, le déchaînement de forces cosmiques, mises en action par l’invasion du trille et du tremblement dans tous leurs états, prolongement de l’invention beethovénienne mais extension à l’écriture entière. Devant cet extrémisme qui fonde une révolution harmonique et générale, on songe aux recherches contemporaines des peintres russes, Kandinsky et plus encore Malevitch. Comme un Horowitz dont le disque a gardé des témoignages devenus légendaires, G. Sokolov est ici prodigieux de force précise, de complexité, de subtilité, d’emportement contrôlé, d’ampleur visionnaire. « C’est sonate des insectes qui sont les baisers du soleil », disait Scriabine lui-même de sa 10e : une mystique est évidemment en arrière de tout cela, sans laquelle l’humain ne serait justement « que mouches sans lumière » (Malraux dans la coda des « Voix du silence »), mais la rigueur intellectuelle d’un Sokolov est de nous laisser le choix d’y voir une philosophie aussi transcendantale que la virtuosité pianistique ou d’y lire « seulement » l’écriture, et non la « monnaie panthéistique de l’absolu ».
Et puis le pianiste nous ramène par la générosité – un rien ironique ? – de bis très courts à du Scriabine plus « tranquille », des Chopin rêveurs, un Bach quintessencié, tout en rappelant qu’il est un maître de la diversité sonore, comme s’il avait à sa disposition plusieurs claviers superposés et leurs jeux de timbres à l’orgue. Retour sur une terre de réel séducteur, et dont on s’aperçoit, avec semblable art du concert, qu’il serait sans doute bien cruel de la quitter.
Lyon. Auditorium, le 14 mars 2007. Franz Schubert(1797-1828) : Sonate en ut mineur, D.958. Alexandre Scriabine (1872-1915) : Prélude et nocturne Op.9, 3e Sonate Op.23, Poèmes Op. 609, 10e Sonate Op.70, Vers la flamme, Op.72. Grigory Sokolov, piano.
Crédit photographique
Grigory Sokolov (DR)