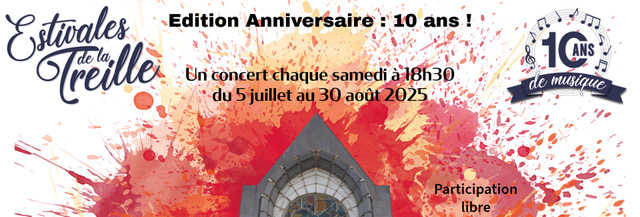Sept articles de fond, explorent les diverses clés d’entrée de la partition berliozienne.
1.
Un homme soucieux, passionné de baroque : le portrait que dresse Michel Berreti, son ami depuis leur rencontre en 1978, du metteur en scène Herbert Wernicke (1946-2002), rend hommage à celui qui est à l’honneur lors de cette production présentée à Paris. Gérard Mortier avait demandé cette mise en scène à Wernicke pour le festival de Salzbourg en 2000. Wernicke devait mourir en 2002. Le spectacle parisien honore ainsi une grand figure du théâtre qui nous a quitté trop tôt. Mais Les Troyens qui reviennent à Bastille, légitimement, puisqu’ils avaient inauguré le nouveau théâtre en 1989 sous la baguette de Myun Whun Chung, sont un prélude à la reprise du spectacle programmé sur la même scène, à partir du 2 décembre 2006, le Chevalier à la rose de Richard Strauss, dans l’une de ses plus belles mises en scène, signée… Wernicke.
Falstaff à Aix en Provence, Actus Tragicus d’après six cantates de Bach, … : Beretti trace la vérité d’un homme dont la critique sociale transparaissait dans son approche des oeuvres : « Dans le théâtre de Wernicke, il n’y a pas de place pour l’illusion de l’innocence« . Scène engagée mais non dénuée de pure féérie, comme sa Calisto de Cavalli en a témoigné, l’oeuvre de Wernicke partageait avec la vision de Gérard Mortier, le souci de faire avancer le débat d’idées sur notre civilisation et ses dérives, sur les planches du théâtre lyrique.
2.
Pierre-René Serna souligne dans « un sujet grandiose pour un vaste opéra », combien Les Troyens illustrent les idées les plus ambitieuses de Berlioz quant à la notion d’opéra. Retour sur la genèse d’une oeuvre à rebondissement qui occupe l’esprit du compositeur, de 1856 à 1861.
3.
Le même rédacteur interroge le chef Sylvain Cambreling sur une partition qu’il a dirigé à Salzbourg dès 2000, mais qu’il défend depuis…1980. Débat sur « la » version définitive ; importance des ballets ; inspiration grecque ; filiation avec Gluck ; inévitables ou regrettables coupures…
4.
Xavier Zuber évoque les « paysages de naufrage » et souligne combien Berlioz a peut-être moins traité le genre du « grand opéra » que réalisé son désir de « mettre en musique des pages de la grande littérature« . En particulier, la lecture de toute une vie, L’Enéide de Virgile. La mort des femmes, de Cassandre à Didon, y revêt le signal d’un échec. Portrait d’Enée, un héros, étranger à l’amour. Influence de l’opéra romantique dans les nombreux « tableaux de rêves et de visions« .
5.
Gérard Condé parle des « paradoxes de Berlioz« .  Il y a l’instinct des architectures harmoniques expérimentales, l’activité du professeur et théoricien qui à défaut de chaire, explique magistralement ses idées dans les colonnes du Journal des Débats, dès 1834. Désir de renouveler l’art musical de sont temps, mais ambition de coller aussi à son époque et d’adorer Napoléon III, alors qu’il écrivait dans un Journal d’opposition…
Il y a l’instinct des architectures harmoniques expérimentales, l’activité du professeur et théoricien qui à défaut de chaire, explique magistralement ses idées dans les colonnes du Journal des Débats, dès 1834. Désir de renouveler l’art musical de sont temps, mais ambition de coller aussi à son époque et d’adorer Napoléon III, alors qu’il écrivait dans un Journal d’opposition…
6.
Alain Patrick Olivier voit dans le spectre d’Hector, un appel à la domination, la source du colonialisme. De fait, dans l’Enéide, Virgile glorifie la politique impérialiste d’Auguste. Comme Les Troyens sont composés au moment où Napoléon III commence de mettre en oeuvre sa politique conquérante en Afrique…
7.
Enfin, Ulrich Schindel, dans « perspectives extra-temporelles », montre (après Sainte-Beuve, fin analyste de l’Enéide), comment Virgile détourne la signification de la Mythologie pour accréditer et glorifier l’histoire romaine. Ainsi Enée anticipe Auguste. Analyse des points de ce détournement dans le texte de l’Enéide. De son côté, Berlioz écarte le monde des dieux, pour ne s’intéresser qu’à l’action des héros et des hommes.
Plutôt que le projet politique romain, le compositeur, en dramaturge lyrique, focalise sur les destinées individuelles, celle de Cassandre (La Prise de Troie), celle de Didon et d’Enée, amants tragiques. L’impérialisme qui est le sujet principal chez Virgile, devient « secondaire » dans l’opéra de Berlioz.
En complément au fonds rédactionnel, deux cahiers iconographiques (La prise de Troie/Les Troyens à Carthage), présentent le travail scénique de Wernicke.
100 pages. En vente aux comptoirs commerciaux de l’Opéra national de Paris.
Illustration
Pierre Narcisse Guérin, Enée raconte à Didon les mahleurs de Troie (1819, Bordeaux, musée des Beaux-Arts). Découvrez dans les textes du programme de l’Opéra national de Paris, pourquoi il ne serait pas faux de penser que le tableau de Guérin a peut-être inspiré Berlioz, pendant la composition des Troyens.