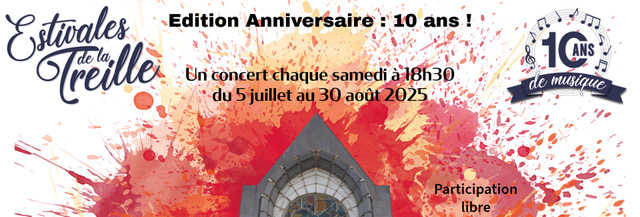Hector Berlioz,
Les Troyens, 1863
La Prise de Troie
Les Troyens à Carthage
Livret du compositeur
opéra en cinq actes et neuf tableaux
d’après L’Enéide de Virgile
A l’Opéra Bastille à Paris et à l’Opéra du Rhin
Du 11 octobre au 21 novembre 2006
L’oeuvre que ne vit jamais Berlioz
« Un aigle irrité auquel on a refusé son essor » : le portrait que brosse Théophile Gautier du « Grand Hector », nous rappelle combien furent sombres les dernières années parisiennes du musicien. Refus, malédiction : autant d’obstacles conspirant contre sa reconnaissance dont la vaine « Panthéonisation » annoncée, remise, abandonnée, fut en 2004, un nouvel avatar. A défaut des honneurs de la pierre, le dvd, le disque, puis enfin les scènes de la rentrée 2006 sont en passe de restituer au génie musicien, un peu de son lustre.
Objet de sa plus grande et profonde déception, l’opéra « Les Troyens », fut pour leur auteur, Hector Berlioz, une succession de ressentiments amers, la confirmation que toute gloire lui était interdite. Ce qu’il tenait pour sa dernière grande œuvre lyrique, l’équivalent de la tétralogie Wagnérienne, ce qui devait être un cycle jamais vu ni écouté jusque là, fut tout bonnement évacué par l’insouciant et pompeux Second Empire qui lui préféra toujours Meyerbeer et Offenbach.
Pourtant la fresque est inclassable autant que visionnaire : les cinq actes – presque 4h20 de musique- nous sont restitués ici quand le compositeur, de son vivant, ne put monter qu’une version réduite et dénaturée en « deux actes » (Paris, théâtre lyrique, 1863), devant un public visiblement déconcerté par son ampleur et ses audaces.
 Lecteur de Virgile, Gœthe et Shakespeare, jamais Berlioz ne fut autant inspiré. Il y convoque les héros de l’Enéide en de terrifiants et sublimes tableaux : la musique façonne une épopée exaltante où les scènes humaines, d’un pessimisme noir, sont vivifiées par l’apparition des héros de la Mythologie. Berlioz nous livre sa science musicale (qui cite Rameau et Gluck), son étonnante culture poétique et littéraire (de Virgile, il puise le montage du livret qu’il écrit lui-même en y associant le souffle de la poésie Shakespearienne), surtout une idée du théâtre musical digne d’un tympan grecque : son marbre est le plus pur et les lignes qu’il y cisèle, sont du plus noble style.
Lecteur de Virgile, Gœthe et Shakespeare, jamais Berlioz ne fut autant inspiré. Il y convoque les héros de l’Enéide en de terrifiants et sublimes tableaux : la musique façonne une épopée exaltante où les scènes humaines, d’un pessimisme noir, sont vivifiées par l’apparition des héros de la Mythologie. Berlioz nous livre sa science musicale (qui cite Rameau et Gluck), son étonnante culture poétique et littéraire (de Virgile, il puise le montage du livret qu’il écrit lui-même en y associant le souffle de la poésie Shakespearienne), surtout une idée du théâtre musical digne d’un tympan grecque : son marbre est le plus pur et les lignes qu’il y cisèle, sont du plus noble style.
A l’affiche
Rendez-vous d’abord à l’Opéra Bastille (du 11 octobre au 8 novembre, sous la baguette de Sylvain Cambreling, dans la mise-en-scène du regretté Herbert Wernicke qui l’avait produite pour le festival de Salzbourg en 2000, réalisée pour cette « recréation » parisienne par Tine Buyse). Avec Deborah Polaski dans les rôles de Cassandre et Didon.
Puis, à l’Opéra du Rhin (sous la direction de Michel Plasson, mise-en scène : Andreas Baesler, du 25 octobre au 21 novembre).
Parcours d’une oeuvre
Du studio à la scène. Sur les traces de Thomas Beecham et Rafael Kubelik, Colin Davis dans les années 1960 décidait d’exhumer (puis d’enregistrer au studio pour Philips en 1977) la fresque berliozienne d’autant plus pertinente qu’elle était grâce à lui intégralement restituée. Première résurrection, premier grand succès. C’est en 1990, un second coup de tonnerre qui consacra le chef d’oeuvre, lorsque Myung-Whun Chung dirigea pour inaugurer la nouvelle salle de l’Opéra Bastille, des Troyens en grand apparat, grâce à la mise en scène de Pier Luigi Pizzi. Enfin, John Eliot Gardiner donnait en 2004 une superbe production enregistrée pour le dvd au Châtelet. L’oeuvre grandiose poursuit donc sa route et l’Opéra Bastille confirme la place d’un opéra, jusque là écarté.
Radio
Les Troyens de Berlioz à l’Opéra Bastille
En direct sur

Le 4 novembre à partir de 18h
Illustrations
Jean-Dominique Ingres, le songe d’Ossian (Musée de Montauban)
Girodet, Ossian accueille les fantômes des héros français (1802, Musée de la Malmaison)