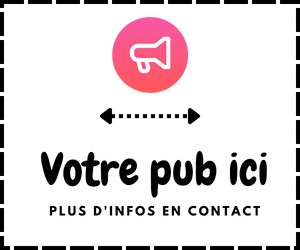ENTRETIEN avec Timothée PICARD. A propos de « Anatomie de la folle lyrique »… Timothée Picard a écrit la postface du livre que vient d’éditer La Philharmonie : » Anatomie de la folle lyrique « , essai sur l‘opéra de l’américain Wayne Koestenbaum, paru pour la première fois en 1993. Pour cette première édition en français, Timothée Picard résume les enjeux et les enseignements d’un texte qui a compté dans l’histoire de la typologie du public d’opéra, depuis les années 1990… C’est pourtant moins ce qui date le texte et l’inscrit dans une période précise de l’histoire du XXè que les fondamentaux et invariants, intellectuels, esthétiques, artistiques qu’il éclaire, que l’écrivain et musicologue met en lumière. En s’interrogeant sur lui-même, et en interrogeant le phénomène de l’opéra, singulier, intact, d’une permanente actualité, Koestenbaum ne cible-t-il pas ce qui identifie spécifiquement un genre toujours fascinant ? Timothée Picard analyse ainsi ce qui fonde les apports d’un texte pertinent et majeur au delà de son titre polémique… Entretien exclusif pour CLASSIQUENEWS.COM
ENTRETIEN avec Timothée PICARD. A propos de « Anatomie de la folle lyrique »… Timothée Picard a écrit la postface du livre que vient d’éditer La Philharmonie : » Anatomie de la folle lyrique « , essai sur l‘opéra de l’américain Wayne Koestenbaum, paru pour la première fois en 1993. Pour cette première édition en français, Timothée Picard résume les enjeux et les enseignements d’un texte qui a compté dans l’histoire de la typologie du public d’opéra, depuis les années 1990… C’est pourtant moins ce qui date le texte et l’inscrit dans une période précise de l’histoire du XXè que les fondamentaux et invariants, intellectuels, esthétiques, artistiques qu’il éclaire, que l’écrivain et musicologue met en lumière. En s’interrogeant sur lui-même, et en interrogeant le phénomène de l’opéra, singulier, intact, d’une permanente actualité, Koestenbaum ne cible-t-il pas ce qui identifie spécifiquement un genre toujours fascinant ? Timothée Picard analyse ainsi ce qui fonde les apports d’un texte pertinent et majeur au delà de son titre polémique… Entretien exclusif pour CLASSIQUENEWS.COM
________________________________________________________________________________________________
CNC : Pourquoi avez vous choisi d’éditer ce texte ? Quel est son apport sur le plan documentaire et historique ? Est-il très emblématique d’une certaine époque et d’un certain goût ?
Timothée Picard : La question des liens – supposés – privilégiés entre les homosexuels et l’opéra est un lieu commun bien connu des amateurs d’art lyrique mais que ne documente pratiquement aucun texte en France, alors qu’il a donné lieu à une importante littérature à l’étranger, dans le domaine anglo-saxon en particulier. Paru en 1993, le livre de Koestenbaum a été le point de départ de toute cette littérature qui, presque toujours, prend position par rapport à lui. C’est probablement son représentant le plus intéressant, à la fois sur le plan théorique et littéraire, quoique tout à fait singulier. C’est pourquoi il m’a paru bienvenu de le faire traduire en France, où il était connu de réputation ; et, surtout, d’en profiter pour faire le point sur les principaux discours et imaginaires tenus sur ce lieu commun avant comme après, et tenter de mesurer le degré de validité des hypothèses de l’auteur encore aujourd’hui.
Il m’a également semblé que cet ouvrage représentait une tentative exemplaire de cerner ce qui peut faire l’étrangeté de la lyricomanie en général.
Oui, l’ouvrage a par certains aspects une valeur documentaire : il est historiquement, géographiquement et socialement situé. Koestenbaum est, comme la majorité des auteurs illustrant cette littérature, né dans les années 1950-1960, issu de la classe moyenne, ayant grandi sur la Côte Est, blanc, gay, juif, intellectuel, formé dans des universités prestigieuses puis enseignant dans ces dernières, et principalement l’opéra sans être musicologue. L’essai est également très représentatif de ce moment où, au cœur des années sida, un certain nombre d’intellectuels gays se décident à sortir du placard et à revendiquer leur passion pour l’opéra, et surtout une manière spécifique de l’investir, comme trait d’identification. On retrouve donc dans ces pages une culture littéraire, musicale et cinématographique caractéristique, mais qui semblera en réalité moins exotique au lecteur français de la fin des années 2010 qu’à celui des années 1990 tant la comédie musicale ou le mélodrame et les films de l’âge d’or hollywoodien jouissent aujourd’hui en France d’un intérêt qu’ils n’avaient pas alors. Les références aux grandes icônes du monde lyrique – Callas, Tebaldi, Sutherland, etc. – ne sont pas non plus exagérément tributaires de cet espace-temps au point de risquer de perdre le lecteur français, toutes générations confondues.
Toutefois il ne faut pas se méprendre : ce qui pourrait nous sembler documentaire et donc daté dans cet essai l’était déjà pour le lecteur de 1993. Koestenbaum sollicite à travers leurs enregistrements et les témoignages les fantômes de divas qui sont déjà largement de l’ordre du passé, évoque un rapport fétichiste au vinyle à l’heure du CD, et semble de prime abord délivrer une image ambivalente de l’homosexuel fou d’opéra – par certains aspects doloriste et élégiaque – qui, presque vingt-cinq ans après les émeutes de Stonewall (1969), point de départ d’un mouvement mondial d’émancipation des gays, entre en contradiction avec celle, résolument optimiste et combative, défendue par les nouveau mouvements militants désireux d’en finir avec la civilisation du placard. Il y a parfois dans ce texte une dimension égotiste, esthète, mélancolique et même un rien masochiste, qui peut sembler anachronique et qui, de ce fait, n’a pas manqué de susciter dès la parution du livre certaines réticences – particulièrement chez les folles lyriques !
Il faut dire que le terme même de folle lyrique, que nous avons volontairement fait figurer dans le titre, revalorisation paradoxale d’une stigmatisation première, ne pousse pas les principaux intéressés à se revendiquer tels : à moins d’être particulièrement à l’aise avec sa singularité, l’homosexuel fou d’opéra et le fou d’opéra tout court auront tendance à vouloir fuir ce dénominatif ; la folle lyrique sera toujours cet autre que l’on ne veut pas être !
Mais à partir de là, on comprend que cette anatomie de la folle lyrique et, plus largement, cette analyse au scalpel de la lyricomanie, ont moins une valeur historique et documentaire qu’un intérêt théorique : cet essai constitue un kaléidoscope d’hypothèses – la folle lyrique est en effet à la fois une et multiple – qui ont une pertinence transhistorique. Sous cet angle, on retrouve dans ce texte l’esprit et la qualité des plus grands essayistes tentant de penser dans une forme et un styles singuliers ce qui fonde leur subjectivité : Roland Barthes ou Susan Sontag, par exemple, dont on retrouve ici le goût pour la succession rhapsodique de brefs paragraphes mêlant considérations autobiographiques, méditations poétiques et mises en perspectives historiques.
Ces hypothèses trouvent même par certains aspects un regain de validité. Car quelle qu’ait été, durant ces trente dernières années, l’évolution des supports techniques, des répertoires et des visages que prennent les icônes du chant lyrique d’une part, et celle de la place et de l’image des homosexuels dans nos sociétés d’autre part, Koestenbaum dessine là une cartographie d’invariants qui, moyennant parfois quelques transpositions, semble toujours singulièrement adéquate pour les folles lyriques et, plus largement, pour les fous d’opéra d’aujourd’hui. Indirectement théorique, son livre est très représentatif d’un courant moins soucieux de s’interroger sur l’identité gay, qui était au centre des revendications des années 1970-1990, que sur ce qui fonderait sa culture et sa subjectivité, préoccupation qui a tendance à redevenir prédominante depuis les années 2000.
On s’aperçoit alors que, derrière ses soupirs et ses extases prétendument onanistes et anachroniques, le type de la folle lyrique, loin d’être dépassé, est au contraire pérenne et porteur d’une vraie modernité, liée à une force d’inventivité et de subversion qui lui seraient propres, du fait de sa résistance patente à toute une série d’injonctions, venues tant de la société en général que d’une certaine communauté gay en particulier. D’esthète asocial, il se pare alors malgré lui d’une dimension politique paradoxale. C’est que, comme je le signale dans la conclusion de ma préface, la folle lyrique est en prise directe et privilégiée avec l’inquiétante étrangeté de l’opéra lui-même : elle la maintient vive, et l’opéra avec elle.
CNC : Selon vous qu’est ce que Olivier Py met en lumière dans sa préface ? Y a t il un « regard français » (et précisément parisien) sur ce texte ?
Timothée Picard : Olivier Py – si passionné d’opéra qu’il a fait de l’art lyrique, art du chant, du spectaculaire, du travestissement, un véritable mode d’être au monde – offre un cas exemplaire de folle lyrique parfaitement assumé. Il confirme par son parcours et son témoignage que le livre de Koestenbaum, bien que lié à un espace-temps spécifique, rend compte d’une expérience, d’un ressenti existentiel, qu’ont pu et peuvent partager de nombreux homosexuels dans d’autres lieux et d’autres époques – en l’occurrence en France, mais pas spécifiquement à Paris.
Dans plusieurs de ses écrits, et notamment dans son roman de jeunesse Le Cahier noir (2015), paru une trentaine d’années après son écriture, Py décrit le profond mal-être existentiel qu’a pu et peut connaître encore l’adolescent homosexuel grandissant dans une petite ville de province étriquée et intolérante, ne trouvant aucun débouché à ses désirs érotiques et à son besoin d’absolu, et convertissant cette énergie sans but en pulsion de mort, automutilations et pulsions suicidaires. Il confie combien l’opéra – Tristan et Isolde de Wagner, Orphée et Eurydice de Gluck, etc. – a pu jouer dans ce cadre le rôle ambivalent de refuge consolateur et de caisse d’amplification démesurée à une soif d’infini ne pouvant s’attacher à aucun objet.
Le cas du jeune Py illustre ainsi parfaitement l’hypothèse selon laquelle l’opéra donnerait aux gays la possibilité d’accéder à des sentiments forts de leur vie affective faisant habituellement l’objet d’une répression sociale, mais ici transposés sur scène et sans censure ; mais aussi, plus généralement, qu’une partie de la fonction dévolue à la musique et à la musicalité dans la culture occidentale a été d’encadrer et de contrôler les pulsions sexuelles, a fortiori homosexuelles. L’hypersensibilité étrange des folles lyriques à l’opéra n’est évidemment pas la conséquence d’une pathologie originelle ; elle est l’inscription dans la psyché d’un sujet des conséquences pathogènes d’une vie menée dans un monde homophobe.
Py montre ainsi combien, encore aujourd’hui, la folle lyrique est tout sauf le résidu anachronique d’une époque vouée à disparaître.
Quand, avant 1969, la civilisation du placard était à son âge d’or, les homosexuels contraints dans leur sexualité et leur affectivité ont trouvé des subterfuges extraordinairement inventifs pour exprimer malgré tout leur subjectivité. La relecture et l’appropriation de la culture dominante a alors joué un rôle primordial. Bien que masqué, le désir homosexuel trouvait quantité d’objets sur lesquels se poser. Et tout particulièrement dans des formes artistiques telles que le mélodrame hollywoodien, la comédie musicale et l’opéra, dont la théâtralité stylisée et le pathos ostensible se prêtaient bien à cette sorte d’investissement : le spectateur gay pouvait projeter sa propre situation de stigmatisé sur la figure de la diva superbe et outragée pour à la fois en pleurer et en rire.
Mais la progressive conquête des droits et libertés, étayée par le souci de donner une image positive de soi, semble avoir d’abord eu pour effet de tirer un trait sur cette figure de la folle lyrique et tout ce qu’elle pouvait représenter : trop honteuse, trop clivée ou bien trop spectaculaire, trop opératique, alors que le nouveau type d’homosexuel que l’on souhaitait promouvoir aspirait à une forme de normalité démarquée sur les modèles hétérosexuels. Les signes mêmes d’une sensibilité aux formes culturelles estampillées gay se sont alors transformés en repoussoir.
Or il se trouve qu’aujourd’hui, malgré ces évolutions, les jeunes homosexuels sont encore socialisés dans un environnement culturel dans lequel ils ne trouvent que peu de modèles auxquels s’identifier ; ils sont toujours confrontés à une homophobie qui les force à adopter des stratégies de dissimulation, et ils continuent donc à pratiquer le même type d’investissement de la culture dominante que leurs aînés. Par ailleurs si, aujourd’hui, les personnages et les intrigues gays ont pu faire ici et là leur apparition, à l’opéra comme ailleurs, si on s’est donc mis à valoriser une représentation littérale et non plus métaphorique de l’homosexualité, nombre de ces homosexuels des nouvelles générations trouvent cette littéralité explicite bien moins riche, intéressante et, au bout du compte, subversive, que les formes culturelles polysémiques et sophistiquées
qu’investissait autrefois la sensibilité gay. De telle sorte qu’ils continuent à les pratiquer aujourd’hui.
Ce sont en effet les esthétiques plus métaphoriques que littérales qui ont le plus de chance de susciter l’intérêt des gays : par elles, le spectateur gay peut se projeter dans un univers plus intense, lyrique, spectaculaire, fantaisiste, que ce que lui offre sa vie courante. L’injection de quelque personnage ou intrigue explicitement gay serait un procédé qui, au bout du compte, s’avèrerait contre-productif. On comprend alors en quoi l’opéra et, plus généralement, ce qui possède des traits opératiques – par exemple dans certains shows rock, chez certaines divas de la musique pop, etc. – peut, encore aujourd’hui, figurer en bonne place dans une certaine culture gay.
CNC : Evidemment le titre du livre renvoie à une catégorie du public d’opéra. Néanmoins qu’est ce qui apporte un éclairage sur le grand public amateur d’opéra ? Selon vous en quoi l’auteur précise-t-il ce rapport passionné au chant des divas ?
Timothée Picard : L’essai de Koestenbaum et toute la littérature qui a suivi s’accordent sur les leviers permettant le fort investissement de la matière opératique par les gays mais, en effet, toutes les composantes de ce processus ne sont pas une exclusivité des gays. Ce livre offre donc également une analyse extrêmement précise et fascinante de cette merveilleuse et monstrueuse étrangeté qu’est la lyricomanie en général.
Cela peut s’expliquer ainsi. Deux impulsions complémentaires interviennent dans la formation de l’identité gay : une tendance à rapporter telle ou telle donnée à ce qui fait minorité, caractérisée par un rapport au monde qui serait spécifique et irréductible ; et une tendance au contraire à l’universaliser, à s’inclure dans une totalité. L’opéra rend possibles les deux à la fois : il peut être saisi comme monde à part, avec d’autres lois, d’autres dynamiques du désir que celles de la société hétéronormée ; mais la forme de désir large, non spécifique et non rigidement contrôlé qu’il met en œuvre permet aussi que ces passions spécifiques rejoignent celles de tous les autres dans un ensemble général, commun et partagé. En ce sens, l’opéra n’est évidemment pas gay en soi ; il est plutôt queer, terme anglais qui désigne une étrangeté non réductible aux discours dominants : l’opéra peut se faire le porte-parole d’un pouvoir officiel ; mais il offre aussi à tous la possibilité d’exprimer une dissidence voire une opposition par rapport aux comportements et constructions communes du désir imposés par la société, tout en y trouvant sa place.
Au-delà de la folle lyrique, on peut donc avancer que le fou d’opéra en général manifesterait quelques traits constants. Il goûterait moins la musique et le drame en tant que tels que les possibilités de performance qu’ils créent pour le chanteur. En l’occurrence, il s’agirait le plus souvent d’une chanteuse (même si Koestenbaum n’exclut pas l’adulation de chanteurs) et, parmi les cantatrices, il en serait toujours une qui s’imposerait comme objet de prédilection au détriment des autres. Le spectateur gay, lui, a pour particularité d’activer une forme d’identification par-delà le genre avec l’héroïne en surinterprétant pour cela certaines composantes d’un livret invariablement hétéronormé. La musicalité et la qualité du jeu de cette diva jouent certes dans ce cadre un rôle important ; mais il s’y surajouterait un je-ne-sais-quoi de difficilement explicable : une personnalité charismatique apparentant l’objet adulé à une divinité et qui, sur une base partagée, parlerait plus spécifiquement à tel ou tel de ses admirateurs.
En toute logique, le fou d’opéra préfèrerait donc les œuvres dans lesquelles les grandes cantatrices peuvent avoir un impact maximal : le bel canto, les œuvres de Wagner, Puccini ou Strauss. Il privilégierait certains moments particulièrement intenses plutôt que la ligne générale de l’ouvrage et se livrerait alors entièrement à ses émotions, en un type d’adhésion plus dionysiaque qu’apollinien, dont l’énergétique aurait quelque chose d’érotique. Son plaisir se focaliserait sur la voix comme objet pulsionnel, particulièrement source de jouissance quand il bordure le hors-sens. Pour cela il activerait un goût personnel fondé avant tout sur la conviction – la subjectivité trouvant dans certains passages une vérité propre qui ne souffrirait aucune contestation, quand bien même le fou d’opéra peut l’étayer de connaissances musicales ou historiques précises. C’est cela qui en fait la grandeur, au risque de susciter le sourire de ses détracteurs – qui, comme on l’a dit, sont souvent parfois aussi, sous une autre forme, des fous d’opéra, des folles lyriques.
Car la grande force de l’essai de Koestenbaum est qu’il propose une multitude de pistes construisant un socle commun, mais qui sont aussi parfois éloignées ou contradictoires, sans jamais en imposer aucune. Certes un portrait type de la folle lyrique ou, plus largement, du fou d’opéra, se dégage nettement, mais ses contours restent volontairement flous : en la matière, il n’y a pas un seul moule, encore moins une seule norme. La dénomination repoussoir devient accueillante : en somme il est temps de reconnaître que nous sommes toutes et tous à notre manière des folles lyriques !
________________________________________________________________________________________________
LIRE AUSSI notre critique du LIVRE : Wayne Koestenbaum Anatomie de la Folle Lyrique (Editions Philharmonie de Paris, janvier 2019)
https://www.classiquenews.com/livre-critique-wayne-koestenbaum-anatomie-de-la-folle-lyrique-editions-philharmonie-de-paris-janvier-2019/
Illustration : portrait de l’auteur Wayne Koestenbaum
© Ebru Yildiz