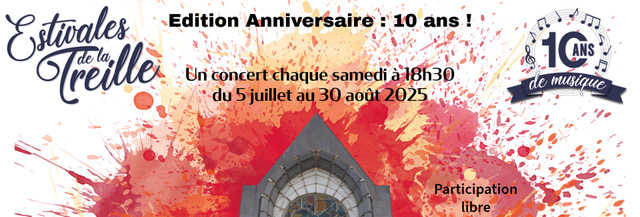Christoph Willibald Gluck

France Musique
Du 27 au 31 octobre 2008 à 13h
Grands compositeurs
Fils de forestier
Né à Erasbach, le 2 juillet 1714 et mort à Vienne (Autriche), le 15 novembre 1787, Gluck marque son temps, en particulier sur la scène lyrique. De Vienne à Paris, il incarne un nouvel idéal esthétique « européen », fondé essentiellement sur la vérité du drame. Son sens de la dramaturgie écarte les vocalises et effets vocaux s’ils ne sont pas commandés par la nécessité de l’action. Avec Haydn, Mozart et Carl Philip Emmanuel Bach, Gluck demeure le plus important créateur classique.
Fils d’un riche forestier, Gluck quitte le foyer paternel pour Vienne dès 1734, pour y apprendre son métier: la musique. A Milan en 1735, dans la classe de Sammartini, Gluck fait représenter son premier opéra en … 1741. C’est à Londres, à partir de 1745, que le musicien qui découvre les drames de Haendel, connaît son premier succès, sur les planches de l’Opéra de Haymarket: La Chute des Géants (La Caduta de’ Giganti, 1746), suivi en avril par Artamene (qui recycle un opus précédent, Tigrane de 1743).
Un voyageur européen
Comme Mozart après lui, Gluck poursuit son tour d’Europe, en voyageur passionné: après Londres, le compositeur se fait remarquer à Dresde, Copenhague, Naples, Prague, Aix-la-Chapelle (où il fait créer Semiramide riconosciuta, en 1748, d’après Métastase).
Mais Vienne demeure un centre musical incontournable pour qui souhaite s’imposer. Formé par les séjours différents aux quatre coins de l’Europe, Gluck se fait un nom sur la scène viennoise dès 1752, en écrivant comme chef d’orchestre puis maître de chapelle du prince de Saxe-Hildburghausen, puis de maître de chapelle, opéras-comiques dans le style français et divertissements italiens. Gluck devient compositeur de la Cour impériale en 1759 (45 ans).
A Vienne
C’est alors que le musicien, avec ses fidèles partenaires, le poète et librettiste, Ranieri de’ Calzabigi et le chorégraphe Gasparo Angiolini, entreprend un nouveau type de production lyrique: le ballet-pantomime Don Juan (1761), Orfeo ed Euridice (1762) qui marque l’avènement du drame néoclassique. Suivent Alceste (1767) et Paride ed Elena (1770), également d’après le texte de Calzabigi.
En France
 Invité par Marie-Antoinette en France, (son ancienne élève à Vienne était devenue Reine de France à Versailles), Gluck exporte le concept lyrique qui lui a valu de francs succès viennois… en France. En 1774, il fait représenter Iphigénie en Aulide et Orphée et Eurydice, version française d’Orfeo de 1762, mais avec des nouveautés pour plaire au goût français: ténor dans le rôle-titre à la place du castrat originel, importance des choeurs et du ballet. Le succès impose le Chevalier à la Cour de France. Ses détracteurs ne tardent pas à lui opposer bientôt le style italien de Piccini, autre musicien étranger, invité par la Reine de France. La polémique enfle, et une nouvelle querelle passionne le milieu musical: on applaudit ou en siffle Alceste (1776, reprise française de son ancien succès viennois), surtout, Armide (1777: l’oeuvre actualise le livret de Philippe Quinault, mis en musique par Lully pour Louis XIV), et Iphigénie en Tauride (1779, son plus grand succès en France, et l’ouvrage emblématique du goût de Marie-Antoinette). Hélas le séjour de Gluck à Paris et à Versailles, devait s’achever sur un échec des plus amers, Echo et Narcisse, véritable four.
Invité par Marie-Antoinette en France, (son ancienne élève à Vienne était devenue Reine de France à Versailles), Gluck exporte le concept lyrique qui lui a valu de francs succès viennois… en France. En 1774, il fait représenter Iphigénie en Aulide et Orphée et Eurydice, version française d’Orfeo de 1762, mais avec des nouveautés pour plaire au goût français: ténor dans le rôle-titre à la place du castrat originel, importance des choeurs et du ballet. Le succès impose le Chevalier à la Cour de France. Ses détracteurs ne tardent pas à lui opposer bientôt le style italien de Piccini, autre musicien étranger, invité par la Reine de France. La polémique enfle, et une nouvelle querelle passionne le milieu musical: on applaudit ou en siffle Alceste (1776, reprise française de son ancien succès viennois), surtout, Armide (1777: l’oeuvre actualise le livret de Philippe Quinault, mis en musique par Lully pour Louis XIV), et Iphigénie en Tauride (1779, son plus grand succès en France, et l’ouvrage emblématique du goût de Marie-Antoinette). Hélas le séjour de Gluck à Paris et à Versailles, devait s’achever sur un échec des plus amers, Echo et Narcisse, véritable four.Gluck qui a perdu sa fille adoptive en 1776, atteint comme musicien avec l’insuccès d’Echo, regagne Vienne où il meurt en 1787.
Illustrations: le Chevalier Gluck par le peintre officiel sous le règne de Louis XVI, Duplessis. Le portrait fixe les traits du compositeur, célébré à Paris et Versailles, étranger réformateur de la scène française, qui sous la protection de Marie-Antoinette accomplit la refondation du drame lyrique, en particulier de la tragédie lyrique héritée de Lully et Rameau. Son Armide de 1777, en témoigne particulièrement: Gluck y adapte pour la langue française (livret de Quinault), un nouveau canevas musical et dramaturgique. (DR)