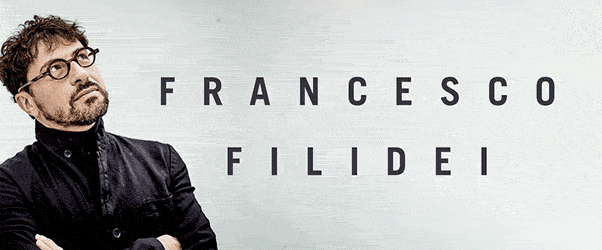Claudio Monteverdi
à Venise

France Musique
Grands compositeurs
Du 19 au 23 janvier 2009 à 13h
Le 24 janvier 2009 à 18h
Les Enfants du Baroque: Monteverdi par Christina Pluhar
Apothéose vénitienne
Heureux Claudio qui passe une retraite méritée, de 1613 à sa mort en 1643, dans la Cité rayonnante, la Sérénissime, pôle culturel toujours vivace et inégalé, même si l’âge d’or des peintres remonte au XVIè, si son essor économique fondé sur le développement de ses colonies et comptoirs en Méditerranée s’effrite depuis la seconde moitié du XVIè. Irrémédiablement. Peu importe. Il appartient à Monteverdi d’illustrer un nouvel âge d’or dans la Venise baroque, – avant le second acmé grâce à Vivaldi qui éblouit de la même façon la Cità dans les premières décades du XVIIIème-, permettant en particulier que se déploie l’opéra public, accessible au plus grand nombre et pas seulement de l’élite, à partir de 1637.
Le fait est d’importance: la République offre un accès exemplaire au genre lyrique, format emblématique du premier baroque. Nommé maître de la chapelle du doge, San Marco, le musicien perfectionne encore le niveau des chanteurs et instrumentistes de la première institution musicale de Venise. Auprès du grand maître, se forme une colonie de compositeurs (Cesti,Cavalli, Ferrari, Schütz…) qui compteront à la génération suivante, défendant eux aussi, un certain style vénitien, sensuel, articulé, palpitant, centré sur la projection intelligible du verbe, à la faveur de l’expression des passions humaines, ces fameux affetti qu’exprime aussi en peinture l’immense Nicolas Poussin avec la clarté et la mesure que l’on sait.
A Venise, Monteverdi ajuste son génie dans une ville qui lui permet d’élargir encore ses réalisations: musique sacrée (la partition de la Selva Morale de 1640 regroupe une somme musicale qui peut être estimée comme le synthèse de la meilleure musique sacrée de son temps!), mais aussi profane et instrumentale. Le maître innove, perfectionne l’art du concitato, style agité, dont les fulgurances expressives disent au plus près du coeur, la passion du sentiment. A Venise, Monteverdi élabore ses plus grands opéras, Le couronnement de Poppée et Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, deux portiques sublimes qui « ferment » au début des années 1640 (1642 et 1643), la trilogie initiée avec son Orfeo mantouan, beaucoup plus ancien (1607).
Comme Bach plus tard à Lepizig, Monteverdi fournit toutes les musiques imaginables, avec un talent supérieur qui sait se renouveler à chaque composition. On sait aujourd’hui, que le musicien fonctionnait comme les peintres et leur atelier, avec des aides et des assistants qui écrivent sous son contrôle, airs, intermèdes, récitatifs… A Venise, Monteverdi publie ses derniers livres de madrigaux (VIIè et VIIIè), imposant peu à peu une forme renouvelée, ample, dramatique, où la monodie sert définitivement l’articulation du sentiment incarné dans le verbe.
Parmi les chefs d’oeuvre complémentaires, s’impose son Combattimento de Tancredi e di Clorinda (partition majeure du genre concitatio, 1634) écrit pour un patricien de la lagune.
La grande peste de 1630 (qu’a peint aussi Poussin), ne l’épargne pas: il perd son fils. Gloire et vanité, reconnaissance et renoncement, profondeur et austérité: le cynisme de Poppée, la rigueur doloriste d’Ulysse sont certainement liés aux épreuves que traverse le vieux Claudio, philosophe voire sage, et peut-être stoïcien, comme le fut… Poussin.
Le visiteur des Frari qui protège aussi le mausolée du Titien, autre gloire locale, peut contempler la tombe de Claudio à gauche de la fameuse Assunta du Titien, mais sous la forme d’une dalle sobre et misérable, dont l’ascétisme dit assez le repli et la volonté de dénuement auxquelles s’est conformé peu à peu le musicien qui meurt à l’âge de 76 ans.
cd
 Parmi les dernières approches originales appliquée à la musique du Grand Claudio, aux côtés d’Emmanuelle Haïm qui aborde les opéras et les madrigaux dramatiques comme Il Combattimento di Clorinda e Tancredi, Christina Pluhar et ses musiciens et chanteurs de L’Arpeggiata « renouvellent » aujourd’hui la musique montéverdienne en la pimentant d’accents et de suavité jazzy, dans le respect avéré de cette notion de geste libre et improvisé, propre au Seicento vénitien (XVIIème siècle). Lire notre critique du dernier album de L’Arpeggiata, Christina Pluhar, « Teatro d’Amore, Monteverdi » (édité en janvier 2009 chez Virgin Classics)
Parmi les dernières approches originales appliquée à la musique du Grand Claudio, aux côtés d’Emmanuelle Haïm qui aborde les opéras et les madrigaux dramatiques comme Il Combattimento di Clorinda e Tancredi, Christina Pluhar et ses musiciens et chanteurs de L’Arpeggiata « renouvellent » aujourd’hui la musique montéverdienne en la pimentant d’accents et de suavité jazzy, dans le respect avéré de cette notion de geste libre et improvisé, propre au Seicento vénitien (XVIIème siècle). Lire notre critique du dernier album de L’Arpeggiata, Christina Pluhar, « Teatro d’Amore, Monteverdi » (édité en janvier 2009 chez Virgin Classics)
Illustrations: Venise: le lion de Saint-Marc, patron fondateur de la Cità, Claudio Monteverdi (DR)