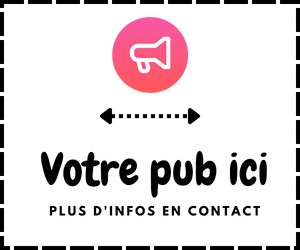La sélection des jeunes interprètes s’effectue, depuis deux années, lors de masters classes qui ont lieu, en partenariat avec le pôle ORL de l’hôpital de la Timone, à l’amphithéâtre de l’Hôpital Saint-Joseph. Ces classes de perfectionnement sont reconnues par l’AFDAS (Fond d’Assurance Formation des Secteurs de la culture, de la communication et des loisirs). Une phoniatre, le docteur Marie-Noëlle Grini-Grandval prodigue ses conseils et soins aux jeunes stagiaires, la metteur en scène Karine Leleu dispense ses cours de théâtre et, enfin, des artistes lyriques de rang international assurent la partie vocale de ces classes de travail. Ainsi, on a vu des artistes prestigieux se succéder, selon l’opéra étudié et travaillé : Véronique Gens, Mireille Delunsch, Marie-Ange Todorovitch, Jean-François Lapointe, et Leontina Vaduva, la marraine, que l’on retrouva au théâtre Silvain, qui a chanté avec Alberto Kraus, Placido Domingo, Roberto Alagna.
L’autre but est de monter, mais accompagnés au piano par Ludovic-Amadeus Selmi, pianiste et compositeur, des opéras.
L’Opéra Théâtre pour Tous
Théâtre et opéra. L’opéra, c’est du théâtre chanté et les sujets en sont le plus souvent tirés de romans ou de pièces de théâtre célèbres : Les Noces de Figaro, Don Giovanni de Mozart, Traviata, Otello, Pelléas et Mélisande, etc, viennent, bien sûr, du théâtre et, sous le livret, on retrouve Beaumarchais, Tirso de Molina, Dumas fils, Shakespeare, Maeterlinck,etc, …
Revenant à cette origine, OPT entend fusionner opéra, théâtre et littérature : c’est-à-dire, allégeant la partie vocale, toujours très longue, ce qu’on a éliminé de musique est rempli par des passages théâtraux ou littéraires des œuvres originales dont l’opéra est issu. Cela donne un éclairage nouveau intéressant à l’œuvre ainsi présentée. C’est de cette sorte que le Don Giovanni de Mozart/da Ponte présenté l’an dernier au Palais Longchamp, était allégé de ses récitatifs, et, à la place, il y avait des extraits traduits du Don Juan originel espagnol de Tirso de Molina et d’autres passages du Dom Juan de Molière. Sans être toujours entièrement convainquant, c’était néanmoins fort intéressant.
Ainsi, après le travail de sélection d’une année, dans le cadre magnifique du théâtre de verdure Silvain entre mont et mer, on retrouvait la généreuse Leontina Vaduva le 1er août pour un concert lyrique avec les jeunes solistes d’OPT, suivi par Madame Butterfly quelque temps après.
Madame Butterfly de Puccini
L’œuvre.
Les antécédents en sont connus : Madame Chrysanthème (1882), roman autobiographique de Pierre Loti qui, à Nagasaki, le temps d’une escale de son navire, par contrat légal renouvelable d’un mois, épousa en juillet une jeune Japonaise qu’il quitte en août, la femme pouvant se marier ensuite sans problème. Le roman à succès fut mis en musique par Messager (1893). Le galant et ambigu Loti récidivait : il avait déjà écrit Le Mariage de Loti (Rarahu) (1882), évoquant un séjour et un mariage à Tahiti.
Sa Madame Chrysanthème, proche de Butterfly par le thème du mariage entre une Japonaise et un marin étranger, n’est pas une victime, c’est une femme intéressée, faisant une bonne affaire, et non amoureuse de l’homme blanc abandonneur comme la future Madame Butterfly de la nouvelle américaine de John Luther Long, devenue une pièce anglaise (1900) mélodramatique de David Belasco de même titre. Le thème cruel de la geisha épousée, engrossée, abandonnée et suicidée, est ainsi présent dans une actualité sinon une conscience occidentale sûre de son bon droit colonialiste quand Puccini, en 1903, lui donne la finition et la définition qui en font un opéra définitif, qui a éclipsé ces œuvres, qui ne sont pas des chef-d’œuvres.
Aussi est-ce sans doute par intérêt historique plus que littéraire que l’on attendait avec curiosité ce qu’en ferait l’Opéra théâtre Pour Tous qui a l’idée originale de mêler à des opéras célèbres, à la place des plages narratives, récitatifs ou passages qui font avancer l’action, des extraits des textes originaux dont ils furent tirés, mêlant de la sorte leur mise en musique, le lyrisme vocal et musical, au théâtre et à la littérature dont ils furent issus. Effectivement, un grand nombre d’opéras se prête à ce jeu d’un découpage d’une partie chantée, remplie par une partie théâtrale qui le resitue ou en éclaire le sens, pas toujours compréhensible pour un profane aujourd’hui : bref, c’est revenir à l’opéra comique, c’est-à-dire, au sens précis du terme, parlé et chanté. Ce qui exige, certes, des chanteurs pouvant avec aisance passer à ces deux types de discours.
Réalisation et interprétation.
L’an dernier, l’espace réduit du jardin Longchamp dotait le Don Giovanni inaugural des conditions les meilleures pour mettre en valeur une mise en scène inventive et détaillée (Karine Leleu), les seules réserves à lui opposer étant l’hétérogénéité stylistique des textes théâtraux convoqués, les vers de Tirso, la prose de Molière et des récitatifs traduits ou trahis par maladresse.
Malheureusement, dans le vaste espace du théâtre Silvain, les personnages se diluent quelque peu (la belle Emmanuelle Zoldan, touchante et bien chantante Suzuki confinée, souvent à genoux, en arrière plan), quant aux textes, de Belasco et de Loti, ils sont pratiquement inaudibles, du premier au dernier rang, moins par un problème de sonorisation que de mauvaise diction du diseur qui les a enregistrés et, les chanteurs, tous excellents pour le chant, ne le sont guère pour le texte parlé, par ailleurs souvent malencontreusement couvert par le piano. Comme l’on n’entend pas les textes, quand viennent les passages parlés, que les personnages se figent pour faire place à la lecture, cela crée une rupture du tempo, du rythme de l’œuvre, d’autant plus que l’attention est attirée et dispersée par les très belles lumières, bleues, mauves, rouges et les superbes vidéos de Geoffrey Parant côté cour, visages en gros plans, noces japonaises, flots, journal, lettres de sang de la lettre du Mikado invitant le père de Cio-Cio-San à sacrifier au saputo, à se faire, hara-kiri.
On est obligé de s’en tenir aux déclaration d’intention de la metteur en scène Karine Laleu dans le programme, très intéressantes, mais, comme toujours, un peu frustrantes face à la réalisation concrète. On la suit volontiers dans son désir exprimé de donner au spectacle le fil continu du journal de voyage (j’imagine inspiré par Loti, volontiers narcissique, se mettant complaisamment en scène) que tient l’officier Pinkerton comme il tiendrait le journal de bord, faisant une escale touristique et érotique à peu de frais pour lui, comblant le rêve exotique occidental de se payer, littéralement, une poupée de porcelaine, une geisha à demeure : celle qu’il loue, maison de papier, comme le chiffon de papier du contrat, jeu pour lui, vécu par elle, dramatique dissymétrie. Jeu biaisé de miroirs où les époux se regardent l’un dans l’autre mais, reflet contre reflet : illusion. On est dans la clôture culturelle, bien symbolisée par l’hésitation de l’époux désinvolte à boire la boisson rituelle japonaise, préférant son whisky anglo-saxon.
À l’exception des beaux kimonos japonais (Misaya Iodice) face à la banalité peu protocolaire des vêtements des Américains, la scénographie, loin de tout vérisme, est conceptuelle et minimaliste : un cube comme siège, un autre plus grand symbolisant le promontoire de Nagasaki d’où Butterfly guette le retour du navire, et un cube plus grand pour la maison, écran à des ombres chinoises sinon japonaises, et aux projections vidéos. Bref, pour moi, une solitude carrée sur des univers clos : lui, enclos dans ses certitudes de supériorité arrogante d’une puissance américaine émergeante impérialement, elle, éclose apparemment à la modernité occidentale, mais enclose et rattrapée jusqu’au suicide par la tradition —papillon épinglé— qu’elle avait cru fuir en faisant un pas, un faux-pas, vers sa culture à lui, embrassant sa religion et reniant la sienne (on ignore que Nagasaki, grâce à la mission française, était un haut lieu du christianisme pourtant réprimé au Japon). Le passage du chœur à bouche fermée, descendant la pente arborée du fond de scène avec ces grandes lanternes et d’une belle poésie tout comme l’illumination irréelle des bosquets.
Côté chant, il n’y a pratiquement que des bons points à décerner. Si Renaud Talaïa semble mal à l’aise dans les imprécations brutales et abruptes du bonze, sans avoir le temps de s’installer vocalement, à entendre le peu que chante en Commissaire Impérial et prince Yamadori Jean-Marc Jonca, cela donne envie de réentendre cette belle voix de baryton. En Goro, l’entremetteur et marieur vil et servile, sinueux, Olivier Trommenschlager projette bien son insidieuse et insinuante voix. En surprenant gilet, barbe grise et canne à la main d’une vieillesse douloureuse, Cyril Rovery campe un Consul Sharpless plein d’humanité, de tendresse impuissante, dont la grande voix emplit l’espace sans passer les oreilles de l’aveugle et sourd Pinkerton de Florian Cafiero, en méforme physique mais beau tissu d’une voix en devenir qui assouplira et élargira sans doute ses aigus de ténor, tout en travaillant son jeu.
Le trio féminin est de grande qualité, on l’a dit pour Zoldan mais il y a aussi la cousine japonaise et Kate Pinkerton que chante Amélie Robinault d’une voix exquise qui convient à sa belle et élégante silhouette. Quant au rôle titre, Madame Butterfly, Marilyn Clément le remplit avec une plénitude confondante, voix souple, nuancée, puissante quand il convient : émouvante. Dans cette version à l’économie, sans orchestre, les pianistes Pierre-Luc Landais et Ludovic Selmi, ne s’économisent pas et nous le feraient presque oublier tant ils mettent en valeur la rutilance timbrique de Puccini, sensible même dans cette épure musicale.
Une belle production de toute l’équipe de l’OPT (on a du mal avec ce sigle mal sonnant…) qui offre, pour un prix minime, un spectacle de qualité avec peu de moyens mais une grande ambition qui mériterait
Silvain. Théâtre, les 11 et 13 août. Puccini: Madama Butterfly. Pianistes et chefs de chants : Ludovic Selmi et Pierre-Luc Landais. Mise en Scène : Karine Laleu ; costumes : Misaya Iodice ; création lumière et vidéo : Geoffrey Parant. Directeur Artistique : Cyril Rovery.
Distribution : Madame Butterfly (Cio Cio San) : Marilyn Clément ; Suzuki : Emmanuelle Zoldan ; la cousine et Kate Pinkerton : Amélie Robinault ; Pinkerton : Florian Cafiero ; Sharpless : Cyril Rovery ; Goro : Olivier Trommenschlager ; le Bonze : Renaud Talaïa ; le Commissaire Impérial et le prince Yamadori : Jean-Marc Jonca.