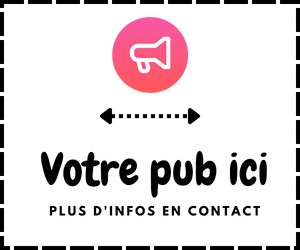Verdi a dévoré avec passion, en langue originale, le drame El trovador, du dramaturge Antonio García Gutiérrez (né la même année que lui : 1813-1884), créé triomphalement à Madrid en 1836 et qui lance au firmament du théâtre ce jeune homme inconnu jusque-là. Il tirera encore un opéra d’une autre pièce du même, Simon Boccanegra (1857) et, plus tard, La Forza del destino (1862) de Duque de Rivas, autre drame marquant du théâtre romantique espagnol. Comme avec Victor Hugo (Rigoletto), Alexandre Dumas fils (Traviata) ou Shakespeare (Macbeth, Otello et Falstaf), l’avisé compositeur au sens dramatique aigu, ne prend ses sujets que dans des pièces à succès et il est absurde d’imaginer une erreur de jugement ou de goût dramatique dans le choix du Trovador/ Trovatore (en réalité ‘troubadour’ et non « trouvère » selon l’impropriété traditionnelle du titre français) pour accréditer le foisonnement compliqué d’une pièce qui ne l’est guère plus que le théâtre goûté à cette époque.
Verdi s’enthousiasme pour le sujet médiéval, les passions affrontées, ce conflit amoureux (entre le Comte de Luna et Manrico le « trouvère » bohémien apparemment, amoureux de Leonora, amoureuse de ce dernier), qui redouble le conflit politique, situé dans l’Aragon du XVe siècle, déchiré en guerres civiles. Dans la pièce, par ailleurs, s’ajoute le conflit de classe entre des Bohémiens, dans le camp des rebelles, et celui des nobles légitimistes et le désir de vengeance de la Bohémienne Azucena dont la mère a été injustement brûlée vive. Quant à Léonore, éprise du fils d’une bohémienne, elle trahit sa classe et prend parti pour les rebelles.
Certes, les simplifications du librettiste Cammarano, qui meurt d’ailleurs sans terminer le livret, obligées par la nécessaire condensation qu’exige la musique, réduisent de beaucoup la complexité psychologique et dramatique de l’œuvre originale. Par ailleurs, comme dans le théâtre classique et ses règles de bienséance, le librettiste confie à deux grands récits (de Ferrando et d’Azucena) certains événements passés essentiels à la compréhension du drame présent qui déterminent l’action, le jeu et ses enjeux, sans compter des ellipses temporelles de faits passés en coulisses (la prise de Castellor), dites en passant qui, dans la complexité du chant, rendent difficile en apparence la linéarité de l’intrigue. Dans la tradition baroque le récit, le récitatif qui explicite la trame du drame sur un accompagnement minimal secco ou obligato, avec simplement un clavecin ou un minimum orchestral, permettait de suivre parfaitement l’action, traitée ensuite en ses effets et affects par les arias les plus complexes. Le problème, ici, c’est que Verdi, confie ces narrations essentielles qui exposent le nœud de l’action à des airs compliqués de vocalises qui en rendent confuse l’intellection, ainsi l’essentiel récit de Ferrando en ouverture, orné d’appogiatures (notes d’appui) haletant, haché de soupirs (brefs silences entre les notes) tout frissonnant de quartolets (quatre notes par temps). Expressivité musicale extraordinaire qui joue contre le sémantisme ordinaire du récit d’exposition. Défauts du livret, donc, mais compliqués par un chant lyrique où librettiste et compositeur ont leur part mais que la musique sublime transcende largement et que les surtitres aujourd’hui permettent largement de dépasser pour peu qu’on y veuille prêter attention. On met au défi le spectateur de comprendre Rodogune de Corneille, Britannicus de Racine, s’il n’a pas compris les immenses tirades historiques, précises ou allusives, bourrées de noms propres, du premier acte d’exposition.
La réalisation
Cette production marseillaise qui tourne partout, avec près de dix ans, n’a pas pris une ride pas plus que les réserves que j’en avais faites à propos de sa « modernisation » à la mode déjà ancienne depuis cinquante ans.
Certes, Charles Roubaud qui la signe a trop de culture pour ne pas pouvoir argumenter son choix : il transpose l’histoire du XVe siècle et des guerres civiles en Aragon au XIXe et les guerres carlistes en Espagne, dont la première éclate justement (1833/1846) à l’époque de El trovador, même si par les magnifiques costumes de Katia Duflot nous sommes plus à l’époque de la création de l’opéra qu’à celle du drame original. Cependant, étant donné l’évacuation du politique de la pièce dans l’opéra de Cammarano qui n’en garde qu’une histoire d’amour contrarié et une vengeance, si l’on peut accepter dans une Antiquité mythique ou un Moyen-Âge légendaire des récits fabuleux, cette histoire de sorcellerie, de bûcher, de substitution d’enfant, trop rapprochée chronologiquement de nous, même dans une Espagne livrée aux dissensions civiles, l’éloigne irrémédiablement dans l’invraisemblance absolue et montre, sous le bel apparat de ces décors (Jean-Noël Lavesvre
), ces sombres lumières de rêve ou de cauchemar (Marc Delamézière) un appareil luxueux de vaine décoration plus que de signification profonde. Tant qu’à moderniser à tout prix, comme je l’ai écrit autrefois, il y aurait eu, peut-être, de la pertinence à situer cette action, où deux hommes politiques et guerriers se disputent la même femme qui pourrait symboliser l’Espagne, à l’époque de la Guerre civile de 1936/1939 (qui finalement est la quatrième guerre carliste espagnole en un siècle), les Gitans étant les libéraux, les « Rouges », les rebelles, face à un pouvoir réactionnaire, totalitaire, d’autant que Franco voulait rétablir l’Inquisition, le fascisme s’y connaissant en bûchers… Beau diptyque espagnol pour Roubaud qui avait ramené avec succès le Cid tout aussi médiéval à l’époque de la transition du franquisme avec la monarchie libérale actuelle.
Il reste qu’on apprécie la beauté neigeuse de ces paysages de montagnes encadrées dans ces immenses tableaux auxquels répondent les gris clairs et sombres, glacés, des robes de Leonora et Inés dans des lumières lunaires, la crépusculaire perspective de fuite orange et rouge de cet immense palais baroque aux colonnes romaines délabrées, l’ambiance nocturne générale où l’immense grille est oppressante bien que largement ajourée. On eût juste rêvé que toute cette esthétique fût nourrie d’un peu d’éthique du sens.
Interprétation
Le plateau est magnifique, homogène. D’une voix au noble et beau métal de basse, Nicolas Testé, à quelques appogiatures près peu sensibles dans leur bref staccato, se tire avec honneur du tout premier air après l’ouverture schématique, campant un Ferrando de belle allure. Carlos Almaguer a une exceptionnelle voix de baryton d’airain, impressionnante de volume et d’éclat, tonnante, et à un moment un peu détonante à force d’excès : il fait du Comte de Luna un reître brutal et guère charmeur qui tonitrue son air supposé d’amour, plus tempétueux qu’amoureux. Sur ce chapitre, il ne peur guère rivaliser avec Manrico, le troubadour charmeur et chevaleresque incarné par un Giuseppe Gipali en pleine forme, virile prestance physique et belle prestation vocale jusqu’à un aigu éclatant, vaillant, dans un timbre aux chaudes vibrations. En comparses, Carl Ghazarossian donne de l’expressivité dramatique à sa brève phrase avec Leonora ; Frédéric Leroy et Wilfried Tissot sont de bonnes silhouettes chantantes.
 Côté dames,
Anne Rodier, Inés, est une suivante de grande classe. En Azucena, la Russe Elena Manistina est une révélation : voix profonde de mezzo grave, égale, ample, puissante, elle semble autant planer vocalement qu’humainement coller à la terre, aux sentiments humains déchirés de fille et de mère, implacable et obsédée dans la vengeance, névrosée mais non folle malgré l’atroce expérience. Malgré un aigu un peu raide dans son premier air, vite corrigé, Adina Aaron est une Leonora de rêve, élégiaque, tendre, passionnée, voix ronde du grave somptueux aux aigus aisés, timbre velouté, rond, avec des sons filés et des piani émouvants. Les chœurs nombreux sont parfaitement tenus et menés par Pierre Iodice.
Côté dames,
Anne Rodier, Inés, est une suivante de grande classe. En Azucena, la Russe Elena Manistina est une révélation : voix profonde de mezzo grave, égale, ample, puissante, elle semble autant planer vocalement qu’humainement coller à la terre, aux sentiments humains déchirés de fille et de mère, implacable et obsédée dans la vengeance, névrosée mais non folle malgré l’atroce expérience. Malgré un aigu un peu raide dans son premier air, vite corrigé, Adina Aaron est une Leonora de rêve, élégiaque, tendre, passionnée, voix ronde du grave somptueux aux aigus aisés, timbre velouté, rond, avec des sons filés et des piani émouvants. Les chœurs nombreux sont parfaitement tenus et menés par Pierre Iodice.
Malgré la difficile première longue scène avec Inés où les mouvements se répètent (prises de mains), la justesse des rapports des personnages est manifeste dans la série émouvante de duos, notamment ceux qui alternent à la fin où Tamás Pal, qui sait faire rêver la musique avec la plainte de Leonora sous la tour, qui en fait sourdre l’angoisse ténébreuse à d’autres moments, la cisèle, la rend incisive, décisive, haletante, révélatrice dans son urgence de la vérité profonde des sentiments exprimés sous la fiction conventionnelle romantique.
Marseille. Opéra, le 2 mai 2012. Giuseppe Verdi: Il Trovatore, Le Trouvère, 1853. Opéra en 4 actes. Livret de Salvatore Cammarano, d’après le drame espagnol d’Antonio García Gutiérrez (1836). Distribution: Leonora : Adina Aaron ; Azucena : Elena Manistina ; Inés : Anne Rodier ; Manrico : Giuseppe Gipali ; Le Comte de Luna : Carlos Almaguer ; Ferrando : Nicolas Testé ; Ruiz : Carl Ghazarossian ; un vieux gitan : Frédéric Leroy ; le messager : Wilfried Tissot. Orchestre et chœur (Pierre Iodice) de l’Opéra de Marseille. Tamás Pal, direction. Charles Roubaud, mise en scène. Illustrations: Leonora: Adina Aaron (DR)