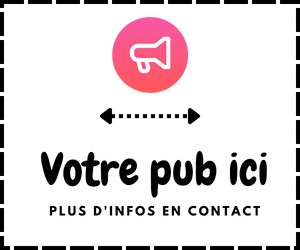Sinon sur les sommets, niveau du moins bien haut : misère non sous les ponts, mais sur les toits de Paris. C’est le pari tenu et gagné par le metteur en scène Jean-Louis Pichon pour cette versicolore Bohème, production de l’Opéra de Monte-Carlo, de l’Opéra Royal de Wallonie et de Saint-Étienne : drame festif pour fêtes de fin d’année.
L’œuvre
Certains s’en sont indignés au nom du soi-disant «vérisme » de Puccini et de cette œuvre qu’on voit en généralement couleur muraille, grisaille et grisette, tristounette. Vériste la musique de Puccini, cela se discute autant que le naturalisme impossible de l’opéra où les gens ne parlent pas mais chantent. Le vérisme n’est donc qu’une convention artistique de choix de sujets proches du quotidien, le seul réalisme étant celui des sentiments, comme d’ailleurs l’exprimait Puccini lui-même :
« Il me faut mettre en musique des passions véritables, des passions humaines, l’amour et la douleur, le sourire et les larmes. »
D’ailleurs, à part la belle scène de jeu et de séduction entre Mimi et Rodolphe, où leurs mains se cherchent en feignant de chercher les clés dans le noir, comment croire, malgré l’exaltation née du désir et du contact, à l’explosion immédiate de leur amour clamé et déclamé ? Nous sommes dans le pacte théâtral qui joue de l’ellipse pour ne pas s’installer dans la durée de la démonstration. Quant aux protagonistes, ces jeunes artistes en attente de célébrité, le poète (Rodolfo), le peintre (Marcello), le philosophe (Colline) et le musicien (Schaunard) partageant une misérable mansarde glacée, comment croire au réalisme social et psychologique de ce « panel » trop délibérément représentatif ? Et brûler allègrement sa pièce de théâtre ou son dernier tableau juste pour faire du feu et des phrases enflammée, qui peut souscrire au réalisme de la scène ? C’est pratiquement du théâtre dans le théâtre : une mise en abyme de l’artifice.
La réalisation
C’est pourquoi l’on sait gré à Pichon de n’avoir pas cédé au chantage chanté de la tradition et de ne pas nous avoir imposé une interprétation vériste du vérisme, surchargée en humidité lacrimatoire et couleurs de névrose misérabiliste. Le réalisme est dans l’excellent travail d’acteurs, les gestes justes, les regards, les rapports des personnages qui semblent quotidiens, avec l’insouciance de la jeunesse, le sourire, le dépit, l’espièglerie de Mimi au début, l’effectisme théâtral de Musette. Quant au drame, il suffit à lui seul et à l’efficace expression musicale et vocale d’une belle distribution pour nous arracher les larmes qu’il n’y pas lieu de retenir à la mort de l’héroïne. Pour le reste, avec quelque signes d’appartenance de classe dans les meubles de ces faux déclassés, il est clair, hier comme aujourd’hui, que pour ces fils de bourgeois qui peuvent se permettre de ne pas travailler pour vivre la vie d’artiste sinon encore vivre de leur art, « la bohème » n’est que les grandes vacances d’enfants gâtés : un luxe de nantis. La seule vraie prolétaire, c’est Mimi la brodeuse, la cousette, la grisette, et sans doute modèle posant nue, Musette, petite muse et amusette, de ces messieurs bien en parenthèses artistiques d’une vie dont on sent qu’elle rentrera dans le rang alors que l’une, phtisique, meurt, et que l’autre, ses appas fanés, sombrera probablement dans la prostitution
 Ce n’est pas un envers du décor que nous présente Alexandre Heyraud (décors), ni les dessous, mais le dessus (et même les pardessus cossus) des mansardes parisiennes, des soupentes vitrées, grises verrières aux armatures d’acier d’exacte architecture industrielle du XIX e siècle, dans la lumière grise et le vague éclat de Paris nocturne dans le premier tableau, au second féeriquement illuminées de couleurs pures, rouge, bleu (Michel Theuil), qui, sauf le vert qu’il détestait, avec les traits noirs horizontaux et verticaux qui les divisent, semblent des tableaux abstraits de Mondrian. Couleurs vives, stridentes, acidulées, qui se retrouvent dans les somptueux costumes irréels (Frédéric Pineau) pour cette terne époque bourgeoise : c’est le psychédélisme des années 60-70 qui éclaire la mercantile et charbonneuse ère industrielle. Dans ce contexte, avec, en arrière-plan un anachronique Sacré-Cœur de Montmartre très Américain à Paris de Minelli, l’air de Musette descendant bien l’escalier assistée de boys stylés, c’est un peu la comédie musicale dans la farce de la coquette à son amant, ou les Folies-Bergères.
Ce n’est pas un envers du décor que nous présente Alexandre Heyraud (décors), ni les dessous, mais le dessus (et même les pardessus cossus) des mansardes parisiennes, des soupentes vitrées, grises verrières aux armatures d’acier d’exacte architecture industrielle du XIX e siècle, dans la lumière grise et le vague éclat de Paris nocturne dans le premier tableau, au second féeriquement illuminées de couleurs pures, rouge, bleu (Michel Theuil), qui, sauf le vert qu’il détestait, avec les traits noirs horizontaux et verticaux qui les divisent, semblent des tableaux abstraits de Mondrian. Couleurs vives, stridentes, acidulées, qui se retrouvent dans les somptueux costumes irréels (Frédéric Pineau) pour cette terne époque bourgeoise : c’est le psychédélisme des années 60-70 qui éclaire la mercantile et charbonneuse ère industrielle. Dans ce contexte, avec, en arrière-plan un anachronique Sacré-Cœur de Montmartre très Américain à Paris de Minelli, l’air de Musette descendant bien l’escalier assistée de boys stylés, c’est un peu la comédie musicale dans la farce de la coquette à son amant, ou les Folies-Bergères.
L’interprétation
La distribution est homogène, crédible physiquement, d’une génération de chanteurs acteurs qui savent vivre la musique, le texte et les situations. Nathalie Manfrino incarne avec beaucoup de vérité et de nuances le rôle trop connu de Mimi, parfois réduit à la guimauve larme à l’œil. Elle est ce pinson parfois à tête de linotte même avec sa jolie coiffe : ce n’est pas une petite dinde innocente, victime d’emblée désignée, priant Dieu assez souvent dans sa chambrette, se faisant seulette la dînette. C’est aussi une coquette coquine et mutine, cousette qui sait piquer, tirer son épingle du jeu et souffler opportunément sa chandelle pour allumer Rodolphe. Cela passe dans l’expression scénique et le chant de Manfrino, évaporée et vaporeuse, qui construit admirablement son grand air comme une petite confidence piano, ménageant un beau crescendo, enflant dans le lyrisme sincère. La voix est moelleuse, ses pianissimi tendres, mais parfois pas assez tendus, au risque de l’instabilité. Elle sait toucher, émouvoir.
À ses côtés, le ténor mexicain Ricardo Bernal est un Rodolfo de belle allure, joli timbre au grain serré mais volume peut-être moindre en rapport de sa partenaire et de la salle ; cependant, ses aigus éclatent avec une magnifique plénitude et un beau fondu dans ces sortes d’apothéoses pucciniennes entre voix à plein et orchestre a tutti.
Personnage à, l’opposé de Mimi, ou revers de la même monnaie, la Musette de Gabrielle Philiponet, remarquée et primée déjà lors du concours de Chant de Marseille, aiguise et acidule son aigu pour ce personnage aussi piquant que tranchant. Sa voix claire et légère de bonne fille garce joue en contraste théâtral avec la sombre chaleur du Marcello baryton, bourru et bon enfant, de Marc Barrard qui joue comme il chante, avec un naturel confondant. Nicolas Courjal, basse noble pour le philosophe Colline, donne une humaine vibration à cet hymne ou marche funèbre, le plus beau des requiems, l’adieu à son adieu à son manteau, sacrifice pieux à la mourante. Baryton plus clair, le Moldave Igor Gnidii est aussi un Schaunard de grande classe dans ce rôle plus léger. Les comparses, chanteurs ou acteurs, sont aussi bien à leur place : François Castel (Benoît), Antoine Normand (Alcindoro), Wilfrid Tissot (Parpignol), François Guitera (un sergent), Frédéric Leroy (un douanier).
Le chef irlandais Mark Shanahan, qui nous avait bouleversés dans Jenufa et ravis dans un concert, tire le mieux de l’orchestre et fait scintiller avec vivacité les harmonies vives et changeantes de la musique à la fois concise et alanguie de Puccini.
Puccini: La Bohème. Scènes lyriques en quatre tableaux (1896).
Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa,
D’après le roman d’Henry Murger Scènes de la vie de bohème (1851)
Opéra de Marseille, le 3 janvier 2012
Opéra de Marseille. La Bohème de G. Puccini: 29 et 31 décembre 2011 ; 3, 5, 8 et 10 janvier 2012. Orchestre et chœurs de l’Opéra de Marseille ; Enfants de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône, Mark Shanahan : direction musicale. Jean- Louis Pichon : mise en scène ; Alexandre Heyraud : décors ; Frédéric Pineau : costumes ; Michel Theuil : lumières.
Distribution : Nathalie Manfrino : Mimi ; Gabrielle Philiponet : Musetta ; Ricardo Bernal : Rodolfo ; Marc Barrard : Marcello ; Nicolas Courjal : Colline ; Igor Gnidii : Schaunard ; François Castel : Benoît : Antoine Normand : Alcindoro ; Wilfrid Tissot : Parpignol ; Un sergent : François Guitera ; un douanier : Frédéreic Leroy.
Illustrations : Christian Dresse