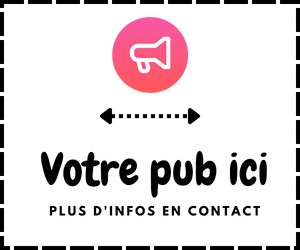Liquider l’expressionnisme post-romantique ?
Déjà un peu plus d’un siècle, cet Erwartung, baigné de psychanalyse implicite, et dans le cercle magique de la Vienne 1900 – « l’Apocalypse joyeuse » – où l’on voit Schoenberg piloté par son beau-frère Zemlinsky et le polémiste du Fackel, l’impitoyable Karl Kraus… Car avec Schoenberg, qui à la différence de son disciple Berg – auteur de ce qu’on a pu nommer les deux derniers opéras de l’histoire musicale, Wozzeck , puis Lulu-, ne composa pas de « vrai » opéra, en tout cas ample et réussi, on reste plutôt du côté de l’oratorio pensant (Moïse et Aaron) ou du monodrame. Situation d’autant plus passionnante que dans ces années 10, le futur inventeur du dodécaphonisme en est encore à « liquider » l’expressionnisme postromantique, et qu’il inscrit cette « expérience lyrique » dans ce que Dominique Jameux nomme « l’incommodité générale, son impénétrabilité » : mais le public, lui, « peut s’identifier avec la figure bouleversée et donc bouleversante d’un être en proie au désarroi, à la solitude amoureuse et à l’angoisse ».
Passionnantes transversalités
On trouvera d’ailleurs, avec les articles du musicologue français dans le livret-programme, de passionnantes « transversalités » entre l’Ecole de Vienne, le bon Docteur Freud, et l’auteure du livret d’Erwartung : la dermatologue Marie Pappenheim, parente de l’Anna O. des Etudes sur l’Hystérie, s’était vu demander par Schoenberg « un livret d’opéra, devenu » texte de monodrame, en l’occurrence conforme à la situation d’un analysant ». Et D.Jameux d’entraîner l’auditeur vers les arcanes d’un « protocole d’analyse » vécu par la femme dans une « forêt opaque traversée comme espérance par la torture ». Ce lecteur-auditeur curieux ne manquera pas ensuite de se diriger, lui, vers les pages éclairantes de D.Jameux dans son tout récent « Opéra, Eros et le pouvoir » »(éditions Fayard, 2012)….
Je cherche l’or du temps
Ce qui frappe l’esprit , le cœur et les territoires souterrains de qui écoute et voit Erwartung, c’est d’abord la perfection d’un langage musical qui pourtant appartient encore, en 1910, au Schoenberg en quête d’un grand Œuvre (Work)in progress. Les spécialistes, tel Alain Poirier, y discernent des « éléments de rythmique, une émancipation (généralisée) de la dissonance, un effacement thématique obtenu par l’alibi du texte, le resserrement de l’harmonie ». « Une unique seconde de la plus intense émotion », dit aussi Schoenberg, contient la « demi-heure de l’œuvre » (quand la femme découvre « l’objet », « das ist er », c‘est lui) : étrange expérience du Temps dans ce cauchemar-énigme, où l’espace de la forêt est parcouru dans un sentiment d’affreuse attente (Erwartung !) d’une vérité qui jamais n’éclatera au jour. « Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique », annonçait André Breton qui au-delà de sa mort physique, continuera dans l’éternité à « chercher l’or du temps ». Sur scène, ici, cette attente est maléfique mais fascinante menace. Il faut donc, pour tenter d’en approcher quelque représentation qui ne la trahisse pas, rigueur d’unicité (la quête solitaire de la femme) et foisonnement de ce qui « l’entoure » (le monde, son propre labyrinthe mental). C’est en cela que la représentation lyonnaise semble tout à fait répondre au questionnement angoissant de ce monodrame, sans céder à un trop de virtuosité que pourrait appeler une conception trop peu intériorisée de l’interprétation. Grâces en soient rendues à « une femme », si « anonyme » et intériorisée, la soprano Magdalena Anna Hofmann, qui porte l’énigmatique errance avec déchirement, douleur et mystère.
Mais aussi à la conception musicale que réinvente Kazushi Ono avec son Orchestre de Lyon : un Schoenberg plongé en toutes ses contradictions de passé et d’avenir, véhément, subtil, toujours surprenant. Et le travail de mise en espace confié à Alex Ollé respecte, là encore sans outrance de spectacle mental qui se déchaînerait au détriment du texte, l’esprit d’interrogation qui préside à cette cérémonie de l’étrange. Au devant du décor d’Alfons Flores, l’ensemble vidéo (Emmanuel Carlier), dont on pourrait craindre un « trop illustratif », emprisonne bien – dans l’immobile huis clos d’objets comme dans le tournoiement de la profondeur forestière – la femme, quelque part entre le romantisme allemand à la Friedrich et un surréel « max ernstien ».
Le doucereux « fratello » du tortionnaire
Ce sont d’analogues qualités qu’on retrouve dans l’autre volet de ce 2nd « justice-injustice », s’inscrivant d’ailleurs plus précisément dans la thématique de la série. Avec Le Prisonnier de Luigi Dallapiccola, on va d’abord à la rencontre d’une partition injustement méconnue, du moins de ce coté des Alpes. Et peut-être même d’un compositeur ici mal connu, ou sous-évalué….En toute hypothèse, ce mini-opéra délocalise le livret de Villiers pour mieux le réinstaller par allusion dans une lutte pour la liberté religieuse ; ces « arrangements » traduisent l’inconfort initial de Dallapiccola visant les persécutions antisémites d’un régime mussolinien qu’il n’approuvait certes plus mais auquel il pensait ne pas pouvoir s’opposer. Mais autant « l’inconfort historique » du compositeur reste sous-jacent, autant son discours musical est fort, parfois même brutal, novateur – dans la continuité du Schoenberg des » deux époques » -, et d’une effrayante subtilité en son leitmotiv du doucereux « fratello » qui susurre à l’oreille du condamné les prémices d’une délivrance. Le déplacement du curseur chronologique n’empêche pas le propos de gagner en universalité….
Je cherchais…
Là encore, le travail de mise en espace, sons et gestes est de haute valeur comme de convaincante sincérité. Le dispositif de « planète centrale tournante » – comme dans Erwartung, mais en plus visible – répartit les séquences, jalonné de portes-symboles qui favorisent le basculement, physique et psychique, dans la fausse évasion ou dans le maintien en prison. C’est cette fois le décor d’Alfons Flores qui constitue le lieu du visible – traducteur d’invisible dans les pensées -, et Alex Ollé en saisit toutes les qualités pour que chaque personnage soit, dirait un philosophe, littéralement enfermé « dans son cercle solipsiste » : chacun croise l’autre, et que tourne la roue du destin cruel, au mécanisme agencé par le manipulateur – l’Inquisiteur, porte-parole doucereux d’une implacable idéologie ! Portée par l’Orchestre et les Chœurs, superbes, de Kazushi Ono, l’interprétation met au jour l’identité certes vocale, mais aussi de la profondeur totale. On songe, devant tant de folie scrutée, aux deux titres d’Artaud : Théâtre de la Cruauté, Le Théâtre et son double…Unicité saisie par l’angoisse et le leurre pour le Prisonnier Lauri Vascar, rôle …dédoublé jusqu’au vertige pour le geôlier/Inquisiteur, Raymond Véry, ombre consolatrice surgi de l’enfance pour la Mère (la même Madgalena Hofmann devenant Femme chez Schoenberg). Tout cela pour aboutir au mystère murmuré de l’interrogation du Prisonnier : «La libertà ? », tout comme l’ultime « Ich suchte » (je cherchais) de la Femme errante et « en attente »…
Un peu de fraîcheur au cou
« Défense de déposer de la musique au pied de mes vers ! », a dit, paraît-il, Victor Hugo. Le Trio Escaich-Badinter-Py connaissait certainement l’avertissement -boutade qui nous vient à l’esprit devant la mise en espace sonore et visuelle de « Claude Gueux » que Hugo avait conçu comme l’une des armes à retourner contre la monstruosité de la guillotine (elle-même, il est vrai, progrès par rapport aux abominables supplices de la peine de mort « à l’ancienne » ; mais rappelons au passage que le bon docteur Guillotin annonçait que l’exécuté ressentirait juste « un peu de fraîcheur au cou »). Partant de ce texte, Robert Badinter a désiré l’enrichir d’une géométrie variable pluri-signifiante : Claude (ex-Gueux, dans le titre) de simple voleur (et même petit voyou dans le fait-divers dont s’était inspiré Hugo) devient un « politique », ex-combattant sur les barricades lyonnaises avec ses camarades canuts. Son « histoire avec Albin », presque tue dans la dimension homosexuelle par le poète – raisons de bienséance qui est aussi pertinence – s’ énonce chez le librettiste 2013 en relation rapidement puis pleinement amoureuse. Et ce qui évoque pour Me Badinter l’enfer de Clairvaux XXe –là où son « échec » d’avocat pour sauver Roger Bontems lui a inspiré son combat contre le crime de la Société (imprescriptible historiquement !) et faire abolir la peine de mort en France-, s’augmente de développements, et même d’expansion socio-économique XIXe (le personnage de l’entrepreneur, recycleur rationaliste d’un « Enrichissez-vous » à la Guizot)… Avec ce Claude tel que le trace pour le musicien un écrivain-avocat, nous sommes certes au cœur de la thématique « justice-injustice » voulue par l’Opéra de Lyon : tout ce que la conscience d’un honnête homme (pas celui du XVIIe, plutôt un indigné qui agit dans le réel et au secours d’une loi non déshumanisée) transmue en cri moral, est à retrouver dans un tel geste d’écriture.
Pas de happy few
Oui mais…. N’est-ce pas trop, tout cela, de surcroit pour un compositeur qui en est à sa première expérience d’opéra ? Thierry Escaich écrit en un style – un agglomérat stylistique ? – qui cherche et atteint avec facile abondance une expressivité propre à toucher le plus large public, et en tout cas répudie l’esthétique du laboratoire, de la tour d’ivoire et du happy few. Sa virtuosité d’instrumentiste et d’improvisateur– à l’orgue –, son goût pour les fresques cinématographiques, l’aident à immerger son écriture dans les flots d’une orchestration spectaculaire. Cette éloquence généralisée a ses mérites éminents, elle peut « communiquer » efficacement, mais court le risque de la dispersion et du butinage compositionnel. L’impression d’ensemble qu’on reçoit – et qui ne s’éclaircit qu’en de rares enclaves – est dans Claude celle d’une surcharge sonore mêlant louables intentions, désir d’insister sur la dramaturgie orchestrale, enchaînement à une rythmique récitative qui d’ailleurs n’entraîne pas la constante intelligibilité du collectif (hormis donc les échanges entre Claude et le Directeur ou Albin).
Le vide ou le trop-plein
On se souvient qu’il avait été demandé au Général de Gaulle : « Ne craignez-vous pas qu’à votre départ ce soit le vide ? », et que la réponse humoristique avait été : « Je crains surtout le trop-plein qui en résulterait. » Oui, Claude manifeste en son parcours un refus du silence, du refuge en poésie – et thémis sait qu’il existe une poésie épique jusque dans les sujets les plus « noirs » !- , car la musique semble avoir là pour but quasi-obsessionnel d’ « expressionner » dans la monotonie d’une démonstration en force. L’écrasement des prisonniers –« stimulé » dans le visuel par la machinerie, efficace et très insistante, de Pierre-André Weitz – s’y traduit par un recours au bruitage (on se croirait parfois en remake sans distanciation d’une Fonderie d’acier par Mossolov dans les années (19)20), qui rejoint des conceptions répétitives ultérieures, mais va aussi du côté de la dramaturgie démonstrative à la John Adams. La tentation pan-orchestrale et de grand métier du compositeur ne résiste même pas au désir de s’y installer avec son cher orgue, comme dans le système théâtral de Tadeusz Kantor le maître polonais logeait toujours sa présence énigmatique…mais celle-là, tellement silencieuse et angoissante…
1909, 1948, 2013
Quelles que soient les références d’histoire musicale plausibles devant ce déferlement en « doubles muscles » sonores– nappage orchestral, cris et vacarme, et quelques répits lyriques comme la comptine « renaissante » n’échappant d’ailleurs pas à une forme de maniérisme -, on reste un peu rêveur en face des dates pour ce « justice-injustice » : un tel Claude en 2013, si longtemps après Le Prisonnier en 1948, et Erwartung en 1909 ! La mise en scène d’Olivier Py tire l’ensemble – très « pro » – dans plusieurs directions : l’éloquence performante (la machinerie tournante de la noria, l’orthogonal des structures métalliques, les cellules vues de face et leur microcosme dérisoire ou amoureux) et symbolique (sont-ce, à l’origine du récit, les trois juges de l’enfer antique, Minos, Eaque et Rhadamante ? les surveillants-chefs ne sont-ils pas habillés et agissant en gardiens de camps nazis ?). Et surtout l’antithèse précieuse – entre extrême brutalité des gestes (bagarres et punitions à grands fracas ; Albin passant du « ping-pong » inscrit dans le livret à un viol collectif en opéra-réality), allusions christiques insistantes et leur détournement vers quelque condamné à la Jean Genet(style : « viens ô ma frégate, une heure avant ma mort »), et une coda où danse en « lac des cygnes » (7e degré ?) la petite jeune fille (celle de Claude ?) sur fond de guillotine.
Contre les lois qui épouvantent la conscience
Au fait, où peut donc ainsi passer une réflexion sur cette ancienne « loi qui épouvante la conscience » ? Et d’une façon plus générale, le spectateur de ce livret si riche, de cette musique si foisonnante mais sans excès de rigueur, de cette mise en scène trop habilement contrastée, a-t-il le loisir et lui reste-t-il le goût de s’interroger ? On ne peut en revanche qu’approuver le travail musical, ici, en cette maîtrise d’un ensemble vocal, choral et orchestral très lourd –conduit par Jérémie Rohrer – qu’on n’attendait pas tellement ici – et la personnalité des interprètes les plus « en vue »…Jean-Sébastien Bou est un Claude admirable de douleur et de révolte, de vaillance aussi, mais qui sait ne pas céder à la virtuosité de son rôle ; son partenaire et ami Albin trouve en Rodrigo Ferreira, très exposé vocalement, bien de l’émouvante tendresse ; et Jean-Philippe Lafont a l’éloquence monolithique et cruelle qui semble convenir à son personnage haïssable.
Et on est malgré tout saisi par l’enthousiasme d’un public en grande partie fort jeune, qui doit découvrir là un monde lyrique aux fils tendus sur « indignation sur aujourd’hui », langage visuel et sonore moderne à sa façon (ou actuel, si on préfère ce vague-à-l’esprit) et convivialité culturelle entre générations. Ce travail de vraie incitation pédagogique depuis longtemps mené par les meilleures institutions culturelles régionales, avec une préparation enseignante fort impliquée, est d’excellent augure pour susciter le débat et esquisser des solutions à l’horizon artistique des années 2015…
Opéra de Lyon, Festival « justice-injustice », 11 et 13 avril 2013. Schoenberg (1874-1951), Erwartung ; Dallapiccola (1904-1975), Le Prisonnier ; Escaich (né en 1965), Claude. Chœurs et Orchestre de l’Opéra de Lyon, solistes, direction Kazushi Ono, Jérémie Rohrer.