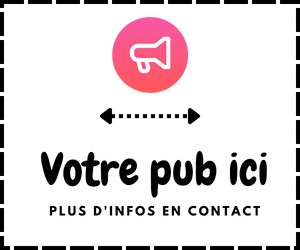Bref mais saisissant moment que peut nous offrir un Orchestre à l’immense tradition, et vision autre : les invitations ont de l’excellence, surtout quand les invités sont appelés à « chanter dans leur arbre généalogique ». Et dès les premières mesures d’un 4e Concerto de Mozart – qui n’est pas en soi immense partition -, on écoute un son spécifique, des violons qui échangent avec leurs partenaires des autres pupitres l’âme dont est dotée de natura leur instrument. « Si c’était un tissu », ne serait-ce pas velours léger, texture et couleurs d’octobre ? Cela ne cessera plus, cette conversation spirituelle – au double sens du terme –, de Mozart en Bruckner, bien que la dimension de l’un et de l’autre paraisse très éloignée. Herbert Blomstedt, – de dos, on évoque William Christie – sait dans Mozart sculpter avec délicatesse quasi-minimaliste, d’une main droite infiniment souple et harmonieuse, des plans sonores qui traduisent l’extrême mobilité de l’écriture, sa disponibilité au sourire, au bonheur de vivre, et tout à coup à l’ombre d’une mélancolie qui passe. Dans le si vaste vaisseau-Auditorium, la substance ne se perd pourtant pas, elle fait converger vers elle une attention assembleuse de parcelles et du scintillement sonores. Et l’accueil y est parfait d’une soliste à l’exigeante élégance, à la simplicité d’allure – véritable distinction, qui ne se distingue qu’en regard de l’intériorité -, à la beauté sonore radieuse : Arabella Steinbacher sait être la jeunesse même, s’identifiant à ce que Wolfgang dut alors rêver de l’existence. Par la subtilité ferme de ses traits, par le rayonnement de son coloris, elle est vraiment dans l’andante essence des Lumières XVIIIe, au-delà de toute agitation du Baroque alors finissant, compagne plutôt d’un Embarquement en arabesques à la Watteau.  Dans le finale – aux ruptures des tons où opère cependant un constant fondu-enchaîné -, les ritournelles avec un rien de nervosité alternent avec un écho de danse populaire et une brillance d’eau de torrent, et tout s’évanouit sans coda. Cela devait être, et ne pouvait être qu’ainsi. C’est cela les Grands Interprètes, ceux qui « prennent la mesure », s’y tiennent, et n’éblouissent que d’un éclat qui ne projette pas d’impuretés égocentriques sur l’œuvre… La violoniste revient pour un bis dont on nous apprendra que c’est partition originale (et non transcription) de F.Kreisler, « op.6 » parsemé d’embûches, de pièges, de changements à vue, dont la soliste se joue avec un bonheur identique à celui de son Mozart.
Dans le finale – aux ruptures des tons où opère cependant un constant fondu-enchaîné -, les ritournelles avec un rien de nervosité alternent avec un écho de danse populaire et une brillance d’eau de torrent, et tout s’évanouit sans coda. Cela devait être, et ne pouvait être qu’ainsi. C’est cela les Grands Interprètes, ceux qui « prennent la mesure », s’y tiennent, et n’éblouissent que d’un éclat qui ne projette pas d’impuretés égocentriques sur l’œuvre… La violoniste revient pour un bis dont on nous apprendra que c’est partition originale (et non transcription) de F.Kreisler, « op.6 » parsemé d’embûches, de pièges, de changements à vue, dont la soliste se joue avec un bonheur identique à celui de son Mozart.
La naissance du Temps
Et puis l’orchestre revient nombreux pour nous emmener dès son premier frémissement – les cordes, bois – imprimer en notre conscience l’un des moments les plus magiques, les plus initiaux du XIXe, voire même au-delà ou en deçà, un appel plusieurs fois réitéré des cors. Comme le début du monde à l’orée de la Tétralogie ? Mais une métaphysique et même une anthropologie plus humaines, plus immergée dans une nature qui permet d’assister à une naissance du Temps. Si on en désire une « représentation » plausible, et malgré le léger décalage chronologique, on peut songer aux « pays » où la peinture d’un autre métaphysicien –allemand- nous emmène : pas dans son « versant » alpin, anguleux, glaciaire, plutôt dans les séries plus collinaires que montagnardes, vertes, bleues et dorées,des Riesengebirge ; ou bien il peut s’agir des tableaux de « dévoilement » où les nuages s’effilochent dans le calme… Tout ce qui n’est pas spectaculairement mystérieux, en somme, et qui correspondrait bien, pour Bruckner, à la réponse que fit le peintre sur la présence partout cachée d’un Dieu irréfutable : « Dieu est partout, dans le moindre grain de sable ; j’ai voulu le représenter une fois aussi dans les roseaux. » Pour le musicien, le plan général de l’œuvre symphonique dit et parfois clame Dieu, mais aussi chaque élément jusqu’à l’infiniment petit de la triple croche, de l’altération ou du soupir…Et si on poursuit la métaphore picturale de Friedrich, voici maintenant le Voyageur-Blomstedt devant les montagnes, image philosophique arrêtée qui se met en mouvement pour atteindre et par moments fixer la durée : mais pour cette éloquence, le chef suédois n’a nul besoin de gesticulation théâtrale, de dessin à grandes brassées d’air. Simplement l’ampleur est venue « depuis » Mozart, mais la familiarité avec un orchestre qu’il a si longtemps dirigé – et sa distinction de tempérament – le font se concentrer sur une désignation quasi-topographique des groupes d’instruments où il isole et fait scintiller des phases où avant la lettre de l’Ecole de Vienne il fait reconnaître des « mélodies de timbres », en les opposant à leur contraire, les blocs de sonorités qu’émettent les cuivres. De même insiste-t-il sur ces caractéristiques de l’écriture brucknérienne – qui ont valu au trop modeste organiste de Saint-Florian les déluges d’une incompréhension à courte vue, et ont entraîné chez lui ce sentiment de culpabilité esthétique redoublant son masochisme catholique : es répétitions (un temps revécu…en temps réel ?), des crescendi débouchant sur le vide, des ralentis puis des accélérations d’une matière-lave en fusion, des chants qui se perdent en innocence rêveuse….Et bien sûr, cette durée conquérante, elle-même héritière de la réflexion schubertienne au piano et à l’orchestre (la IXe Symphonie de Franz, à l’espace lui aussi entrouvert par les cors lointains).
Clos ton oreille physique
 L’andante, d’abord répit qu’on nommerait « pastoral » – une Pastorale sans événement, idéalisée-, sa ponctuation veloutée de pizz marquant l’écoulement heureux des secondes, (quelle douceur poétique le chef n’obtient-il pas là aussi de ses instrumentistes !), et pourtant la montée de crescendi hymniques qui ne tardent pas à s’éteindre, bercé enfin par le dialogue de hautbois (inspirés dans la simplicité !) et des cordes. Le scherzo est certes le mouvement où on se rapproche de façon plausible d’un programme suggéré par le compositeur. Mais n’est-il qu’un hommage à la « bonne Autriche », chasseresse, aux honnêtes réjouissances bénies par le clergé entre église, rivière et plus discrètement cabaret convenable ? Ses petits appels de motifs brefs et incisifs, obstinément réitérés, ne sont pas sans finir par inquiéter, en stéréophonie d’espace ; le tournoiement un peu fou qui saisit l’orchestre, malgré l’éclaircie charmante des trios – ah ! les délicieux dialogues entre bois ! -, respire les empoignades pas si conformistes d’une Kermesse rubénienne en terre de Mittel Europa…Quant au finale, d’une démesure qui…ne se mesure pas à la seule longueur, d’une diversité qui n’exclut pas une unité spirituelle peu visible aux yeux de la construction rationnelle, il rassemble (la fanfare de cors qui cite le début de la Symphonie) et désassemble à la fois. C’est un chaos, où la matière brassée interroge sur le mystère de ce feu qu’elle entretient dans les profondeurs de la terre. Peu à peu et dans ses différents épisodes, il écrit les lettres qui dans la langue allemande composent le maître-mot Warum – ce pourquoi, ce perche, ce why qui ailleurs sonnent sans augurale solennité et prolongement harmonique -. Et il impose à plusieurs reprises la palpable présence d’un Temps suspendu qui a nom Attente, l’un des plus beaux moments de l’aventure humaine, faite de désirs, de craintes, d’élans vers un Absolu de l’amour, divin ou corporel, qu’importe. Sans qu’on le « sache » – même si on croit bien connaître la Symphonie -, on est guidé vers ce qui est bien davantage qu’une coda : l’ivresse d’un Temps supposé perdu mais alors retrouvé en sa totalité, l’énigme enfin conclue. En son paroxysme, on s’aperçoit – noyé dans la folie de l’orchestre déchaîné – que c’est l’œuvre d’art qui scelle mieux que tout la marche en avant vers un triomphe, fût-il provisoire, de la vie sur son contraire…Comme naguère un Günter Wand le montrait aussi en Bruckner, c’est un écho de ce que conseillait Friedrich – et transposons pour le sonore – : « Clos ton oreille physique, afin d’entendre d’abord ton œuvre avec l’oreille de l’esprit. Ensuite fais monter au jour ce que tu as entendu dans ta nuit, afin que son action s’exerce en retour sur d’autres êtres, de l’extérieur verts l’intérieur. » Voilà ce que peuvent un Gewandhaus, un chef inspiré, en une admirable – mais sans emphase ni orgueil – Leçon de musique…
L’andante, d’abord répit qu’on nommerait « pastoral » – une Pastorale sans événement, idéalisée-, sa ponctuation veloutée de pizz marquant l’écoulement heureux des secondes, (quelle douceur poétique le chef n’obtient-il pas là aussi de ses instrumentistes !), et pourtant la montée de crescendi hymniques qui ne tardent pas à s’éteindre, bercé enfin par le dialogue de hautbois (inspirés dans la simplicité !) et des cordes. Le scherzo est certes le mouvement où on se rapproche de façon plausible d’un programme suggéré par le compositeur. Mais n’est-il qu’un hommage à la « bonne Autriche », chasseresse, aux honnêtes réjouissances bénies par le clergé entre église, rivière et plus discrètement cabaret convenable ? Ses petits appels de motifs brefs et incisifs, obstinément réitérés, ne sont pas sans finir par inquiéter, en stéréophonie d’espace ; le tournoiement un peu fou qui saisit l’orchestre, malgré l’éclaircie charmante des trios – ah ! les délicieux dialogues entre bois ! -, respire les empoignades pas si conformistes d’une Kermesse rubénienne en terre de Mittel Europa…Quant au finale, d’une démesure qui…ne se mesure pas à la seule longueur, d’une diversité qui n’exclut pas une unité spirituelle peu visible aux yeux de la construction rationnelle, il rassemble (la fanfare de cors qui cite le début de la Symphonie) et désassemble à la fois. C’est un chaos, où la matière brassée interroge sur le mystère de ce feu qu’elle entretient dans les profondeurs de la terre. Peu à peu et dans ses différents épisodes, il écrit les lettres qui dans la langue allemande composent le maître-mot Warum – ce pourquoi, ce perche, ce why qui ailleurs sonnent sans augurale solennité et prolongement harmonique -. Et il impose à plusieurs reprises la palpable présence d’un Temps suspendu qui a nom Attente, l’un des plus beaux moments de l’aventure humaine, faite de désirs, de craintes, d’élans vers un Absolu de l’amour, divin ou corporel, qu’importe. Sans qu’on le « sache » – même si on croit bien connaître la Symphonie -, on est guidé vers ce qui est bien davantage qu’une coda : l’ivresse d’un Temps supposé perdu mais alors retrouvé en sa totalité, l’énigme enfin conclue. En son paroxysme, on s’aperçoit – noyé dans la folie de l’orchestre déchaîné – que c’est l’œuvre d’art qui scelle mieux que tout la marche en avant vers un triomphe, fût-il provisoire, de la vie sur son contraire…Comme naguère un Günter Wand le montrait aussi en Bruckner, c’est un écho de ce que conseillait Friedrich – et transposons pour le sonore – : « Clos ton oreille physique, afin d’entendre d’abord ton œuvre avec l’oreille de l’esprit. Ensuite fais monter au jour ce que tu as entendu dans ta nuit, afin que son action s’exerce en retour sur d’autres êtres, de l’extérieur verts l’intérieur. » Voilà ce que peuvent un Gewandhaus, un chef inspiré, en une admirable – mais sans emphase ni orgueil – Leçon de musique…
Lyon. Auditorium, le 13 octobre 2010. W.A.Mozart (1756-1791), 4e
Concerto de violon ; Anton Bruckner (1824-1896), 5e Symphonie. Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig, dir. Herbert Blomstedt, Arabella Steinbacher
(violon).