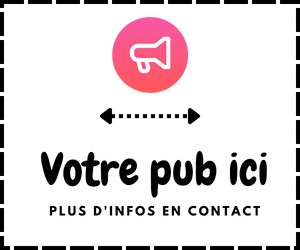Autant son Eugène Onéguine avait été salué (légitimement) comme l’événement lyrique du Palais Garnier en 2008, autant sa lecture de Don Giovanni à Aix cet été, premier essai chez Mozart, suscite les plus vives réserves. Directeur d’acteurs méticuleux (jusqu’à la colère) et scénographe exigeant, même parmi les plus scrupuleux qui soient, Dmitri Tcherniakov (40 ans) nous offre une grille théâtrale et scénographique d’une indiscutable cohérence artistique, mais les options ici développées, sont plaquées sur le chef-d’oeuvre mozartien, créant de bout en bout des décalages à vide, des tensions artificielles, des détournements antimusicales.
Eternel conflit entre la scénographie conviée et la réalité propre des opéras: théâtre visuel ou musique et chant: à chacun de choisir; mais ici, la tension entre les composantes est trop visible, et nuit in fine, à la magie unitaire du spectacle… Elles contraignent même les chanteurs, les réduisant à des individualités en surjeu constant, jamais libres, et d’aucune façon touchés par la grâce ni la pure magie … aixoises.
Le spectacle ainsi créé verrait-il l’avènement des opéras théâtralisés où la vision du metteur en scène atteint même à la temporalité de la partition, à l’écoulement organique et naturel des airs? Ici, Tcherniakov impose un décompte chronologique entre chaque section: 1 mois s’est écoulé entre le temps de l’ouverture dont il fait déjà une action théâtrale (exposition des caractères) et le début du premier acte; 5 autres jours ont encore passé entre l’assassinat du commandeur et la scène (des funérailles) qui suit (apparition d’Elvire); tout cela répond évidemment à une « logique » théâtrale; mais elle ne gênerait pas autant si à chaque fin de tableau, un lourd rideau noir qui tombe sur la scène, ne venait marquer le temps (long) d’une pause (artificielle) afin de préparer le décor de la scène suivante: tout cela ralentit l’action, coupe le fil musical et l’on perd le souffle organique, la vitalité poétique qui naît des enchaînements entre les scènes…
Dans ce Mozart rethéâtralisé, Tcherniakov reprend les ficelles qui avait produit la magie de son Onéguine: il aime les humanités désenchantées, solitaires, usées, trop fragiles, au bord de la rupture et de la folie. Soit. Son Don Giovanni est donc (sans surprise aucune) désincarné, alcoolique, errant, à peine coiffé, mal rasé, hagard, évoluant lui aussi à vide… aucune étincelle de désir dans la scène de séduction avec Zerline (à aucun moment les deux ne se touchent, si ce n’est à la fin du la ci darem la mano: le séducteur est resté raide, froid, lointain, étranger à toute pulsion érotique). Qu’on est loin de la fièvre animale et féline d’un Terfel, de la sophistication inouïe d’un Raimondi chez Losey: Tcherniakov rate une scène essentielle où le héros démontre pourtant au public sa stratégie de conquête, sa force de dévoration pulsionnelle. Ici, Don Giovanni est désabusé et inerte, bouffon et pantin d’un destin déjà fini.
La seule vitalité qui affleure est pour l’air du champagne: mais DG se retrouve seul sous un éclairage de petit matin, puis gesticulant de façon hystérique, debout, sur le fauteuil en cuir! On a compris, nous sommes chez les fous et la scène est celle d’inadaptés aux troubles (nombreux) du comportement.
Un théâtre plaqué sur l’opéra
Dans cette vision cynique et froide, qui épingle toutes les relations sociales (et précisément familiales), le metteur en scène nous impose constamment sa propre conception de l’histoire mais au détriment de l’opéra mozartien qui dès son origine, bénéficie du génie dramatique du librettiste Da Ponte. Tcherniakov imagine la maison de Don Giovanni où chacun se croise comme s’il s’agissait des membres d’une même famille: chez les Giovanni, Elvira est une femme négligée qui rit sans raison (scène du catalogue) et cherche sans objet dans son sac de coquette détruite; Leporello? un ami de la famille; idem pour Anna, Ottavio; Masetto, un caïd maffieux prêt à en découdre… Et pour mieux souligner l’ennui qui ronge l’existence de chaque personnage, Tcherniakov fait de la fameuse scène des masques au I, un manège échangiste où chacun embrasse tout le monde, y compris Ottavio et Masetto! Pourquoi pas… mais qu’apporte ce parti pris dans un fatras de gestes anecdotiques dont on a déjà saisi le sens? La surprise de la candide Zerline peut-être, proie désignée, trop innocente et fragile dans ce jeu de corrompus et d’insatisfaits malheureux. Le sommet de ce décalage entre le sens et l’enjeu des scènes lyriques et ce qu’en donne à voir Tcherniakov, demeure la mort du Commandeur: pris entre les tirs croisés de Don Giovanni et de Leporello, le vieillard vénérable prend un mauvais coup sur la tête (un livre pris dans la bibliothèque?)…
Cette lecture aurait été captivante en Avignon, pour le festival de théâtre: dans Onéguine, Tcherniakov soulignait sans répétition ni emphase à la façon noire et glaciale de Dostoievski, Tchekov ou Strindberg, la solitude impuissante et déchirée des êtres, c’était à la fois grandiose et pudique; mais à Aix, cet éclairage ôte à la partition toute sa sève et sa cohérence, sa poésie comme sa magie. Dommage.
C’est Mozart qu’on assassine
Côté chanteurs, il n’y a guère que Anna (Marlis Petersen) qui sort son épingle du jeu dans ce massacre collectif; le tempérament est fort, parfois hystérique (mais c’est une donnée partagée par tous les chanteurs acteurs répondant aux intentions du metteur en scène). La plupart ne chante pas mais force la voix, ôtant toute nuance et toute finesse au chant mozartien qui pourtant comme chez Bellini, en demande grandement. Saluons aussi le Leporello de Kyle Ketelsen qui apporte une lueur de finesse et de beau chant dans un tableau vocalement bien terne. Bo Skovhus vit son personnage et son chant sans passion: désincarné, impassible. Il ne se passe rien dans ce jeu qui a signé la destruction du personnage et met à mal le charisme de son mythe. Il n’a ni le délire carnassier et félin de Terfel, ni le raffinement pervers et l’attraction virile de Raimondi chez Losey. D’autant que ces derniers ont une voix magnifique et ciselée quand ils chantent Don Giovanni, ce qui est loin d’être le cas du danois au timbre lui aussi usé, au chant sans précision, au jeu étranger.
Que reste-t-il au final? Des décors dignes d’un film d’Almodovar: remarquablement fouillés. Ce salon et sa bibliothèque créent une atmosphère, un cadre, ceux d’une famille à cris et à sang. Tcherniakov fait de Don Giovanni un polar domestique où le cynisme libertaire et sans morale du héros fait imploser l’unité d’une famille déjà divisée…
Dans la fosse, le chef peine à trouver ses marques et sa personnalité dans un spectacle qui est avant tout visuel et trop décalé. Il prendra sa revanche l’année prochaine en dirigeant Natalie Dessay dans La Traviata. L’orchestre est somptueux mais débordant: les cuivres systématiques dans chaque tutti, rappelant dangereusement que l’absence de richesse dynamique, de finesse, de nuances comme d’articulation rayonnent de la scène à l’orchestre. Tout le premier acte est ainsi asséné dans une agitation souvent hystérique: inviter une formation baroque sur instruments anciens est un argument séduisant. Faire sonner Mozart autrement est prometteur. Comme demander à un homme de théâtre d’appliquer son souci cinématograhique du jeu des acteurs, un effet d’annonce qui souscrit à la mode actuelle. Réunir tout cela dans le cadre d’un opéra, dans la réalité de son déroulement, l’espace d’une soirée, est une toute autre chose. L’ennui gagne vite et à aucun moment, la grâce ne s’est invitée dans ce banquet de compétences disparates.
Aix en Provence. Théâtre de l’Archevêché, le 3 juillet 2010. Mozart: Don Giovanni. Bo Skovhus (Don Giovanni), Kyle Ketelsen (Leporello), English Voices (choeur), Freiburger Barock orchester, Louis Langrée, direction. Jusqu’au 20 juillet 2010.